Accueil » Articles publiés par IRASD.SSARI
Archives d’auteur : IRASD.SSARI
Un peu de comptabilité civilisationnelle démontre que l’économie n’est plus rentable…
« Les services rendus par la nature (eau, pollinisation, stabilité des sols, etc.) ont été estimés par des économistes à 125 000 milliards de dollars annuels, soit une fois et demi le PIB mondial. » [1, 2, 3]
« … la Terre a vu ses populations de vertébrés sauvages décliner de 60 % de 1970 à 2014… » [1, 2]
« Mondialement, seuls 25 % des sols sont exempts de l’empreinte de l’homme; en 2050 ce ne sera plus que 10 %, selon les scientifiques de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. » [1, 2]
Il est temps de refaire notre budget civilisationnel. Avec 60% de perte de biodiversité et 75% de perte des sols, on peut estimer une dette moyenne de 67,5% d’emprunt sur les services écosystémiques de la biosphère. Cela correspond à une dette de 84 375 milliards de dollars par année de services rendus par la nature qui sont perdus, vraisemblablement compensés en partie par encore plus d’exploitation des ressources, accélérant d’autant cette perte pour les années à venir.
Selon l’AFP dont la source n’est pas citée par La Presse, le PIB mondial serait estimé à 83 333 milliards de dollars [1], l’humanité serait donc en déficit de 1042 milliards de dollars. Ce qui indiquerait que l’économie n’est plus rentable!
Si on distribuait cette dette à l’échelle de la population mondiale de 7 594 147 910 individus [4], cela représente une dette annuelle de 142$ par personne en 2018. En limitant cette dette à la population des pays développés qui en sont responsables, on arrive à 1 272 000 398 individus [5] avec une dette de 819$ par personne en 2018. À cette échelle, cette dette semble négligeable.
Ayant un sérieux doute sur le chiffre avancé par l’AFP pour le PIB mondial (« …125 000 milliards de dollars annuels, soit une fois et demi le PIB mondial. » [1], j’ai fait une recherche rapide pour corroborer le montant du PIB mondial. Le Fond Monétaire International (FMI) fournit des données bien différentes et modulées par pays [6].
Ainsi, le PIB mondial en 2018 serait plutôt de l’ordre de 84 840 milliards de dollars. Ce qui fait qu’avec la même logique de calcul, nous serions en surplus de 465 milliards et non endetté de 1042 milliards. Ce qui indique que l’économie mondiale pourrait encore surexploiter 465 milliards de ressources naturelles équivalentes en services rendus à la biosphère avant de tomber en déficit. C’est l’équivalent, en 2018, de 61$ de surplus par humain ou de 366$ de surplus par citoyen des pays industrialisés.
Peu importe la source de données pour quantifier le PIB, on constate que l’humanité arrive à un point de rupture entre la valeur de son développement économique monétaire et la valeur de sa dette environnementale. Selon le principe des vases communicants, l’économie étant en croissance infinie et les ressources naturelles en déficit continu, la limite de rentabilité sera inévitablement franchie si elle ne l’est pas déjà.
Le problème est que non seulement la dette écologique n’est pas comptabilisée dans le système économique monétaire, mais en plus, l’humanité ne dispose d’aucun autre moyen pour la rembourser que de décroître l’activité économique pour laisser plus de temps à la biosphère pour se régénérer, ce qui est diamétralement opposé à la conception de l’économie et contraire à toutes les politiques étatiques!
En conséquence, le déficit de services écosystémiques va continuer de croître au même rythme que l’économie, sous la pression démographique et la volonté politique de développement. Sachant que la capacité de régénération des écosystèmes se calcul en échelle temporelle allant du siècle à plusieurs centaines de millions d’années, cette dichotomie mène irrémédiablement à l’effondrement de la civilisation et à une extinction massive de la biodiversité, incluant l’homme et ce sur le très court terme sur l’échelle géologique! L’Anthropocène risque de ne pas durer très longtemps…
La seule solution est donc de stopper l’économie monétaire à l’échelle mondiale et de concentrer nos efforts à combler les besoins essentiels de la population tout en optant pour des stratégies d’architecture sociale durable ayant pour objectif de réduire au maximum l’empreinte écologique de l’humanité.
Je n’ai pas eu le temps de faire les recherches, mais il serait fort intéressant de documenter la valeur du PIB limitée à combler les besoins essentiels de la population mondiale à laquelle on aurait retranché toute activité de développement économique inutile comme la création de nouveaux marchés exclusivement dédiés à la simulation d’une croissance économique monétaire, mais qui ne fait que contribuer à accélérer le déficit écosystémique. Nous pourrions être surpris de documenter la faisabilité de stopper l’économie…
Stéphane Brousseau – Directeur de recherche
B.Sc. Géologie
IRASD – Institut de recherche en architecture de société durable
[1] Catherine Hours. La Terre a perdu 60% de ses animaux sauvages en 44 ans, Agence France-Presse, La Presse, 29 octobre 2018, [En ligne],
[2] Grooten, M. and Almond. Living Planet Report 2018, WWF, R.E.A.(Eds). WWF, Gland, Switzerland, October 2018,
[http://wwf.panda.org/knowledge_hub/all_publications/living_planet_report_2018/]
[3] IPBES. The methodological assessment report on scenarios and models of biodiversity and ecosystem services, 348, Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 2016,
[4] PopulationMondiale.com – World population clock,
[http://www.populationmondiale.com/#sthash.zl8HhVRz.dpbs]
[5] Ined. Population, naissances, décès – Europe et pays développés – Les chiffres, Institut national d’études démographiques, 2016,
[6] IMF. IMF Data Mapper, Datasets, World Economic Outlook (October 2018), Gross Domestic Product (GDP), GDP, current prices, [https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD]
Comprendre les fondements éthologiques de la naissance de l’économie depuis le Néolithique
Depuis la démission de Nicolas Hulot, beaucoup de billets et de chroniques dans les médias répètent l’urgent constat d’action sur le problème de l’économie capitaliste responsable de l’Anthropocène.
Mais on n’explique rien sur les fondements éthologiques de la création de l’économie, alors qu’il est primordial de les comprendre si l’on veux résoudre le problème.
«Qu’il soit humain ou animal, un agent économique doit ajuster son comportement à la façon dont le produit du travail commun est réparti dans son groupe, avec la présence éventuelle de profiteurs. Il favorise ceux qui l’aident le plus et exprime sa désapprobation en cas d’échange déloyal. Une théorie économique véritablement évolutionniste doit prendre en compte l’existence de cette psychologie partagée et intégrer cette réalité : nous appliquons la règle d’or – traite les autres comme tu souhaites que l’on te traite – non par accident, mais parce que nous sommes des primates que leur nature pousse à coopérer.»
«Comment les hommes commercent
Frans de Waal décrit les émotions mises en jeu par les transactions entre animaux vivant en groupes. Elles ressemblent à celles qui agitent les hommes faisant du commerce, ce qui suggère que les interactions économiques humaines se produisent sous l’influence d’émotions très anciennes. De fait, l’étude du comportement animal apporte des briques à la construction d’un nouveau domaine : l’économie comportementale. La naissance de cette discipline remet en question l’idée que les hommes prennent des décisions économiques rationnelles qui constituent le fondement de l’économie classique (pour décrire ces décisions rationnelles, les macro-économistes ont même inventé une espèce idéale nommée Homo economicus). Par exemple, en économie comportementale, les individus tendent à rejeter toute offre qui leur semble déloyale, alors qu’en économie classique, ils sont censés prendre tout ce qu’ils peuvent obtenir.
Le psychologue Daniel Kahneman, de l’Université de Princeton, fondateur de l’économie comportementale, et son collègue Amos Tversky, ont analysé la façon dont les hommes prennent leurs décisions lorsqu’ils sont confrontés au risque et à l’incertitude. Les économistes classiques considèrent les décisions humaines sous l’angle de l’utilité prévisible définie par la somme des gains que quelqu’un pourra tirer de quelque événement futur multiplié par la probabilité que cet événement survienne. D. Kahneman et Tversky ont montré que les gens sont beaucoup plus effrayés par la perspective de pertes qu’ils ne sont encouragés par celle de gains, ce qui explique qu’ils cherchent à suivre les autres. L’éclatement de la bulle du marché des actions en 2000 fournit un exemple de ce phénomène : pour faire comme les autres, les gens se sont débarrassés à la hâte d’actions qu’un investisseur rationnel aurait vendues en moins grand nombre.
Les travaux de Vernon Smith, l’autre fondateur de l’économie comportementale, ont montré qu’en économie aussi des expériences de laboratoire sont possibles, alors que cette science est considérée comme une science non expérimentale entièrement fondée sur l’observation. Il a notamment mis en évidence le fait que les décisions prises sous le coup de l’émotion ne sont pas forcément mauvaises.
Ronald Noë, DEPE (CNRS UMR 7178 & Université de Strasbourg)»
Article de Frans De Waal, éthologue et primatologue à l’Université Emory.
La naissance de l’économie
Dossier Pour la Science N°76, Juillet 2012
Frans De Waal, Publié le 6 juillet 2012
Certains comportements, tels que la coopération, l’habitude de rendre des services ou les réactions de dépit ou de colère face à une attitude déloyale, sont les mêmes chez l’homme et chez certains animaux.
Si je déménageais à l’étranger, mon appartement ne resterait pas vide longtemps. De même dans la nature, le « parc immobilier » évolue en permanence. Les espaces habitables sont très prisés, du trou percé par le pic-vert au coquillage abandonné sur une plage. Un exemple de ce que les économistes nomment la « chaîne des espaces vacants » est le marché du logement chez le bernard-l’hermite. Doté d’un abdomen mou, ce crabe se protège en se glissant dans une coquille, en général celle d’un gastéropode, abandonnée par son ancien propriétaire. Seulement, contrairement à cette coquille, le crabe grandit, de sorte que les bernard-l’hermite sont toujours à la recherche d’une coquille plus grande ; dès que l’un trouve à se loger de façon plus spacieuse, d’autres s’intéressent à la coquille qu’il abandonne.
Ce comportement collectif illustre la loi de l’offre et de la demande. Toutefois, les échanges sont plutôt impersonnels et ne sont guère comparables aux transactions humaines. Chez d’autres animaux plus sociables, la façon de s’échanger des ressources et des services, que nous allons examiner ici, éclaire l’origine et l’évolution de l’économie telle que l’homme la pratique.
Le rôle de l’égoïsme
Les économistes considèrent que les êtres humains cherchent à optimiser leur profit par pur égoïsme. Selon Thomas Hobbes, philosophe anglais du xviie siècle, les hommes aspirent par instinct à ce qui est bon pour eux, et ils recherchent ce qui est juste uniquement pour avoir la paix ou par accident. Selon cette opinion, encore largement répandue, la sociabilité n’est qu’une conséquence, résultant d’une sorte de contrat social que nos ancêtres auraient conclu pour ses avantages, et non par sympathie pour leurs semblables.
Pour le biologiste, cette vision est éloignée de la réalité : nous descendons d’une longue lignée de primates ne vivant qu’en groupes, ce qui implique que nous sommes nécessairement habités par un désir très fort de coopérer dans notre vie et dans notre travail. Depuis l’émergence d’un nouveau courant, connu sous le nom d’économie comportementale, cette approche évolutive gagne du terrain. Pour comprendre comment les décisions économiques sont prises, ces économistes s’intéressent au comportement humain plutôt qu’aux lois abstraites du marché. Ce courant est désormais reconnu, puisqu’il a valu le prix Nobel 2002 d’économie à Daniel Kahneman et Vernon Smith, les deux fondateurs de l’économie comportementale.
Un nouveau champ de recherche – l’étude du « comportement économique » des animaux – a révélé que les comportements de base, telles la réciprocité, la coopération ou encore la répartition des récompenses, n’ont rien de spécifiquement humain. Ces comportements ont probablement été adoptés par divers animaux pour les mêmes raisons : pour que chacun profite au maximum des autres, sans pour autant saper les intérêts communs qui fondent la vie en groupes.
Nous avons ainsi observé au laboratoire, le Centre Yerkes de recherche sur les primates, à Atlanta, une situation qui illustre parfaitement ce type de coopération. Nous avions appris à des singes capucins d’Amérique du Sud comment se procurer une écuelle de nourriture placée sur un plateau à l’extérieur de la cage, en rapprochant le plateau au moyen d’une barre. Seulement, le plateau était trop lourd pour être tiré par un seul singe, et les efforts conjugués des deux étaient nécessaires. Ils avaient ainsi une bonne raison de coopérer (voir la figure page 39).
Lors d’une expérience, deux femelles, Bias et Sammy, devaient tirer sur le plateau. Installées dans des cages mitoyennes, elles réussirent à rapprocher le plateau de façon à mettre à la portée de chacune d’elles une écuelle de nourriture. Toutefois, Sammy se montra si pressée de saisir son écuelle qu’elle lâcha sa barre avant que Bias n’ait pu faire de même. Pendant que Sammy dévorait, le plateau retourna hors de la portée de Bias. Cette dernière se mit en colère et commença à crier ; la crise ne dura pas plus de 30 secondes, car Sammy revint tirer sur sa barre pour aider Bias à rapprocher le plateau. Manifestement, elle n’agissait pas dans son propre intérêt, puisqu’elle savait qu’elle ne tirerait aucune récompense de ce nouvel effort.
Ainsi, les récriminations de Bias avaient modifié le comportement de Sammy. Cette situation ressemble à une transaction humaine, car elle traduit l’existence d’une communication, d’une coopération, le désir de satisfaire une attente, voire le sentiment d’une obligation. Sammy s’est montrée sensible au fait de devoir rendre l’aide qu’elle avait reçue de Bias, ce qui n’a rien de surprenant : la vie en groupes des singes capucins implique le même mélange de coopération et de concurrence que dans nos sociétés.
Il arrive que des animaux (ou bien des hommes) se portent assistance sans bénéfices apparents pour celui qui aide. Comment un tel comportement a-t-il pu se développer ? Quand l’aide est apportée à un membre de sa propre famille, c’est la voix du sang qui parle. Pour les biologistes, les avantages génétiques d’une telle assistance sont évidents : si votre lignée survit, les chances que vos gènes soient transmis à la génération suivante augmentent. En revanche, une coopération entre individus non apparentés n’a aucun avantage génétique immédiat. Dans son livre L’entraide, publié en 1902, le prince russe anarchiste Piotr Kropotkine proposait déjà une justification de telles coopérations : si chaque individu reçoit une aide du groupe, tout le monde en tire un bénéfice et les chances individuelles de survie s’accroissent. Ensuite, il a fallu attendre 1971 pour que Robert Trivers, alors à l’Université Harvard, aux États-Unis, fasse progresser cette question grâce à sa théorie de l’altruisme réciproque.
Selon R. Trivers, tout sacrifice pour un autre n’est payant que si ce dernier retourne la faveur. Une conception de la réciprocité qui pourrait se résumer ainsi : « Tout petit service en vaut un autre. » Les animaux agissent-ils de même ? On observe que les singes et les grands singes font des alliances, par exemple deux individus ou davantage contre un troisième. Un lien manifeste existe entre le nombre de fois où A apporte son soutien à B et celui où B apporte son soutien à A. Toutefois, cela signifie-t-il que les animaux gardent en mémoire les faveurs accordées et celles reçues ? Peut-être répartissent-ils simplement leurs semblables en deux groupes : les « copains », qu’ils préfèrent, et les « non-copains », qui leur sont indifférents. Si de tels sentiments sont réciproques, les relations seront soit une aide mutuelle, soit une absence d’aide mutuelle.
Toutefois, le fait que ces animaux ne mémoriseraient pas les faveurs reçues n’implique pas qu’ils ignorent la réciprocité. La question est plutôt de savoir comment une faveur accordée bénéficie à celui qui l’a accordée. En quoi consiste exactement le mécanisme de réciprocité ? La mémorisation n’est qu’un moyen permettant la réciprocité, mais il n’est pas avéré que les animaux se souviennent des services rendus, sauf les chimpanzés. Ces derniers chassent en groupes les singes colobes. Quand un chasseur attrape une proie, il la partage. Toutefois, il n’y a pas forcément une part pour chacun, et même un mâle dominant pourra quémander en vain un morceau s’il n’a pas pris part à la chasse. Les chimpanzés pratiquent la réciprocité et semblent avoir un sens aigu du rôle joué par chacun d’eux au moment de la chasse, lorsqu’il s’agit de partager les proies.
Les lois du partage
Pour comprendre les mécanismes à l’œuvre chez les chimpanzés chasseurs, nous avons exploité la propension de ces grands singes à partager, même en captivité. Fournissant à l’un d’eux une certaine quantité de nourriture, par exemple une pastèque ou une branche avec des feuilles, nous avons observé comment s’opère le partage. Le bénéficiaire de la nourriture se retrouve rapidement au centre d’un premier groupe ; puis des groupes de partage secondaires se forment autour des singes ayant reçu de la nourriture. Le processus se poursuit jusqu’à ce que chaque singe ait été nourri. Les chimpanzés « respectent » la propriété : ils ne revendiquent pas de nourriture par la force. Ils tendent la main comme le fait un mendiant, tout en gémissant et en se lamentant. Les affrontements sont rares et, en général, sont à l’initiative de celui qui est censé donner, mais qui cherche à exclure certains singes du groupe. Pour cela, il frappe avec une branche sur la tête des individus qui le gênent tout en criant dans leur direction d’une voix aiguë, jusqu’à ce qu’ils partent. Ainsi, chez les chimpanzés, ceux qui sont en possession de nourriture en contrôlent la distribution, quel que soit leur rang.
Nous avons analysé presque 7 000 situations de ce type, étudiant la tolérance de ceux qui détenaient de la nourriture vis-à-vis des quémandeurs, en fonction des services rendus auparavant. Le matin des jours où des tests de nourriture étaient prévus, nous avons noté de façon détaillée les entraides durant l’épouillage. Ainsi, quand le grand mâle Socko avait aidé May le matin, ses chances d’obtenir d’elle quelques branches dans l’après-midi augmentaient (voir la figure ci-contre). Cette influence du comportement passé sur le comportement futur est manifestement un phénomène général. Il ne peut s’expliquer par l’existence de liens privilégiés entre singes (c’est-à-dire par l’existence de « copains »), car les comportements de partage changent de jour en jour. Notre étude fut la première mettant en évidence une corrélation entre faveurs données et reçues. Elle fit aussi apparaître le caractère personnel de ces transactions « épouillage contre nourriture » : May n’a fait profiter de sa bienveillance que Socko, qui l’avait aidée à s’épouiller.
Ce mécanisme de réciprocité requiert non seulement la capacité de mémoriser les bienfaits reçus, mais aussi celle de « colorer » ses souvenirs afin de déclencher des comportements amicaux. Chez l’homme, c’est ce que l’on nomme la gratitude, et il n’y a pas de raison de l’appeler autrement chez les chimpanzés ! On ignore si les singes connaissent aussi la notion d’obligation, mais leur tendance à rendre des faveurs reçues varie suivant la relation en jeu. Ainsi, entre singes qui sont souvent ensemble et s’épouillent les uns les autres régulièrement, l’effet d’une seule séance d’épouillage est minime. Entre ce type de « copains », les échanges quotidiens sont nombreux, et ils ne les mémorisent sans doute pas. En revanche, entre des singes qui ne se fréquentent pas souvent, une aide à l’épouillage mérite récompense : c’est parce que Socko et May ne sont pas des proches, que l’aide offerte par Socko est remarquable.
La gratitude chez les chimpanzés
Le même comportement existe chez les hommes : nous sommes plus enclins à noter une faveur venant d’un étranger ou d’un collègue que d’un proche. En fait, tenir le registre des faveurs données et reçues dans le cadre d’une relation intime serait même un signe de méfiance.
Le choix du partenaire a une importance centrale en économie comportementale. Les transactions entre primates peuvent impliquer plusieurs partenaires disposant de multiples monnaies d’échange, telles que soins, copulation, soutien au combat, nourriture, garde des petits, etc. L’existence de cette « bourse aux services » traduit le fait que chaque individu a simultanément besoin d’être en bons termes avec les individus dominants, de conclure des échanges d’aide à la toilette, et, s’il est ambitieux, de conclure des accords avec les autres ambitieux. Ainsi, certains mâles s’associent pour défier le mâle dominant. Cette tactique est pleine de risques, car une fois installé, un nouveau chef se doit de donner satisfaction à ceux qui l’ont soutenu. Un mâle qui essaie de monopoliser les privilèges du pouvoir, par exemple l’accès aux femelles, risque de ne pas garder sa position bien longtemps…
Quand chaque individu propose ses services tout en cherchant à s’associer avec les meilleurs partenaires, un réseau d’échanges identique à celui d’un marché de l’offre et de la demande s’installe. Ronald Noë, à l’Université de Strasbourg, et Peter Hammerstein, de l’Université Humboldt, à l’Institut Max Planck de physiologie comportementale, à Seewiesen, en Allemagne, ont formalisé cette idée dans le cadre de leur théorie du marché biologique.
Selon cette théorie, qui s’applique à toutes les situations où l’on choisit librement avec qui pratiquer des échanges, la valeur des biens et des partenaires varie en fonction de leurs disponibilités. Cette hypothèse est fondée sur l’observation des forces à l’œuvre au sein de deux marchés biologiques : celui des bébés chez les babouins et celui des « performances professionnelles » des labres nettoyeurs, de petits poissons marins qui se nourrissent des parasites infestant les gros poissons.
Comme toutes les femelles primates, les femelles babouins sont irrésistiblement attirées par les petits – les leurs, mais aussi ceux des autres. Elles émettent à leur vue des grognements amicaux et essaient de les toucher. Toutefois, les mères babouins sont très protectrices et répugnent à laisser quiconque s’intéresser à leur progéniture. Afin de pouvoir quand même approcher un nouveau-né, les femelles épouillent la mère tout en jetant sur le petit des regards furtifs par-dessus son épaule ou par-dessous son bras. La mère tolère alors plus facilement la curiosité de celle qui l’a aidée. La femelle a en quelque sorte acheté du « temps-enfant ». Selon la théorie des marchés biologiques, la contre-valeur en temps-enfant est d’autant plus grande que les nouveau-nés sont peu nombreux dans le groupe, ce qu’ont confirmé Louise Barrett et Peter Henzi, de l’Université de Lethbridge, au Canada : ils ont observé que dans les groupes de babouins chacma d’Afrique du Sud, quand les nouveau-nés sont rares, les mères obtiennent des aides nettement plus longues que durant les périodes de l’année où les petits sont nombreux.
De leur côté, les labres nettoyeurs (Labroides dimidiatus) offrent leurs services dans des « stations » situées sur un récif. Chaque labre a sa propre station et les « clients » viennent se positionner, nageoires pectorales étendues et dans toutes les positions facilitant le travail du labre. Celui-ci avale les parasites présents à la surface du corps de son client, des ouïes et même de l’intérieur de sa bouche, dans un bel exemple de mutualisme. Parfois, le nettoyeur est tellement occupé que les clients (soit des résidents, soit des passants) doivent attendre. Les résidents, dont le territoire est limité, n’ont pas d’autre choix que de s’adresser à leur nettoyeur local. Au contraire, les poissons de passage se déplacent sur de plus vastes distances, ce qui signifie qu’ils peuvent choisir entre plusieurs stations de nettoyage. Ils sont plus exigeants, réclament d’être servis rapidement, un excellent service, et surtout pas de tromperie ! En effet, parfois un labre profite de son travail pour arracher une bouchée de chair à son client. Cette pratique « malhonnête » fait fuir le client.
Redouan Bshary, de l’Université de Neuchâtel, en Suisse, a fait de nombreuses observations en milieu naturel, mais aussi en laboratoire. Il a constaté que si un labre nettoyeur ignore trop longtemps ses clients de passage ou les trompe, ces derniers changent de station de nettoyage. Les nettoyeurs semblent en être conscients et traitent manifestement les passants avec plus d’égards qu’ils n’en ont pour les résidents. Si un poisson de passage et un résident arrivent en même temps, le nettoyeur offre presque toujours ses services au poisson de passage, puisque le résident n’ayant pas d’autre choix attendra. Les prédateurs sont les seuls clients que les nettoyeurs ne trompent jamais, car ceux-ci ont à leur disposition une imparable réplique à la tromperie : avaler le tricheur ! Les nettoyeurs adoptent avec les prédateurs une sage « stratégie de coopération inconditionnelle ».
Les marchés biologiques
La théorie des marchés biologiques offre une réponse élégante au problème des profiteurs, qui a longtemps préoccupé les biologistes, car les systèmes d’échanges sont manifestement mis en danger par ceux qui prennent plus qu’ils ne donnent. Les théoriciens pensent en général que les tricheurs doivent être punis. Une autre option est envisageable : s’il a le choix, un animal cessera d’avoir des relations avec un partenaire qui l’aura trompé et remplacera ce dernier par d’autres qui lui apporteront plus d’avantages. Dans nos sociétés, nous ne faisons pas non plus confiance à ceux qui prennent plus qu’ils ne donnent, et nous avons tendance à les exclure.
Pour évaluer une coopération, on estime l’investissement consenti, on le compare aux efforts des partenaires et on évalue l’effort par rapport aux bénéfices obtenus. Pour savoir si les animaux pratiquent ce genre d’évaluation, nous avons testé le comportement de singes capucins au sein d’un minimarché du travail, lors d’une chasse à l’écureuil géant. Chez les capucins, cette chasse n’est possible qu’en groupes, même si, en fin de compte un seul individu attrape la proie. Si les auteurs de la capture gardaient toujours leurs proies pour eux, on peut imaginer que les autres singes perdraient tout intérêt à coopérer. Les capucins partagent pour la même raison que les chimpanzés (et les hommes) : sinon, il ne pourrait exister de chasse en commun.
Nous avons reconstitué une situation similaire en laboratoire en faisant en sorte que deux singes placés dans des cages mitoyennes puissent faire venir un plateau à eux en tirant des barres. Seul l’un d’entre eux (le gagnant) se voyait récompensé par une écuelle pleine de morceaux de pommes, tandis que l’autre (le travailleur) n’obtenait qu’une écuelle vide. Les singes voyaient si leur écuelle était vide ou pleine, de sorte que le travailleur avait la perspective de ne tirer que pour le seul bénéfice du gagnant. Nous savions cependant, grâce à de précédentes expériences, que le singe qui reçoit de la nourriture en dépose près de la cloison qui le sépare de l’autre singe, allant jusqu’à pousser des morceaux à travers la grille.
Nous avons comparé les comportements des animaux quand ils ont tiré ensemble sur le plateau et quand ils ont tiré seuls. Dans le premier cas, les deux animaux disposaient d’une barre de traction et le plateau était lourd ; dans l’autre cas, l’un des partenaires ne disposait pas de barre et le gagnant manipulait seul un plateau plus léger. Les partages de nourriture ont été plus fréquents après les tractions opérées à deux : les gagnants donnaient quelque chose à leur partenaire en récompense de l’aide reçue. Nous avons aussi constaté que le partage influe sur la coopération ultérieure. Récompenser le travailleur est manifestement une stratégie intelligente, car la proportion de réussites diminue quand le gagnant ne partage pas sa nourriture avec le travailleur.
Cailloux contre grains de raisin
Sarah Brosnan, dans mon laboratoire, a étudié comment les récompenses sont réparties. Elle a donné à un singe capucin un petit caillou, puis lui a proposé une tranche de concombre en échange du caillou. Installé dans une cage voisine, un autre singe a vite compris le principe et a volontiers troqué des cailloux contre des tranches de concombre. Cependant, quand S. Brosnan s’est mise à donner des grains de raisin (que les capucins préfèrent aux concombres) à l’un des singes, le comportement de l’autre a changé. Voyant ce que recevait son voisin, celui qui ne recevait que du concombre a aussitôt commencé une grève du zèle. S’exécutant à contrecœur, il s’est agité, a commencé à jeter les cailloux hors de la cage, voire les tranches de concombre. Il rejetait cette nourriture, qui auparavant l’intéressait.
Caractéristique des hommes comme des primates, le refus des inégalités de traitement contredit les hypothèses de l’économie classique. Si la recherche d’un bénéfice maximal était tout ce qui comptait, chacun prendrait la totalité de ce qu’il peut obtenir et ne laisserait jamais le ressentiment ou l’envie interférer. Les économistes du comportement font l’hypothèse que l’évolution a produit des émotions qui préservent l’esprit de coopération et que de telles émotions influent sur le comportement. À court terme, s’occuper de ce que les autres obtiennent peut sembler irrationnel, mais, à long terme, cela empêche quiconque de prendre l’avantage sur un autre. Décourager toute exploitation est indispensable à la poursuite de la coopération.
Le refus des inégalités
Toutefois, la surveillance incessante des échanges pose des difficultés. C’est pourquoi les humains se protègent des profiteurs et des personnes qui les exploiteraient en s’associant à des partenaires sur lesquels ils peuvent compter, par exemple leurs conjoints ou leurs amis. Une fois que nous avons confiance, nous assouplissons les règles. Avec les personnes qui ne nous sont pas proches, en revanche, nous tenons une comptabilité exacte des échanges et réagissons dès que nous trouvons un comportement déloyal.
Cet effet de distance sociale existe aussi chez les chimpanzés. Comme nous l’avons vu, le donnant-donnant est une forme d’échange rare entre amis, pour qui l’entraide permanente est naturelle, et les relations amicales seraient relativement protégées contre l’injustice. S. Brosnan a mené des expériences d’échange de grains de raisin et de concombres avec des chimpanzés et avec des capucins. Chez les chimpanzés, la réaction a été particulièrement violente chez ceux qui ne se connaissaient pas depuis longtemps, alors que les membres d’un groupe ayant vécu ensemble depuis plus de 30 ans n’ont guère réagi. Quand deux chimpanzés se connaissent depuis peu, leur comportement d’échange varie de jour en jour.
Qu’il soit humain ou animal, un agent économique doit ajuster son comportement à la façon dont le produit du travail commun est réparti dans son groupe, avec la présence éventuelle de profiteurs. Il favorise ceux qui l’aident le plus et exprime sa désapprobation en cas d’échange déloyal. Une théorie économique véritablement évolutionniste doit prendre en compte l’existence de cette psychologie partagée et intégrer cette réalité : nous appliquons la règle d’or – traite les autres comme tu souhaites que l’on te traite – non par accident, mais parce que nous sommes des primates que leur nature pousse à coopérer.
Auteur
Frans De Waal
Frans de Waal occupe la chaire de primatologie comparée à l’Université Emory, aux États-Unis, et dirige le Laboratoire Yerkes de recherche sur les primates.
L’essentiel
– Des comportements des primates préfigurent ceux des humains dans leurs relations avec autrui.
– Par exemple, des singes aident leurs congénères sans rien en attendre. D’autres partagent en fonction de faveurs reçues.
– Dans certaines situations, le choix du partenaire est essentiel au maintien de la coopération. C’est la théorie du marché biologique.
En savoir plus
F. de WAAL, Le singe en nous, Fayard, 2006.
F. de WAAL, Primates et philosophes, Le Pommier, 2008.
V. DUFOUR et al., Calculated reciprocity after all : Computation behind tokens transfers in orang-utans, in Biology Letters, vol. 5, pp. 172-175, 2009.
C. FRUTEAU et al., Supply and demand determine the market value of food providers in wild vervet monkeys, in PNAS , vol. 106, pp. 12007-12012, 2009.
R. BSHARY et al., Pairs of cooperating cleaner fish provide better service quality than singletons, in Nature, vol. 455, pp. 964-966, 2008.
Frans de Waal. La naissance de l’économie, Dossier Pour la Science N°76, Juillet 2012,
[https://www.pourlascience.fr/sd/ethologie/la-naissance-de-leconomie-6876.php]
L’éthologie humaine est-elle le frein évolutif à sa survie face à l’Anthropocène?
Malgré l’Anthropocène, malgré les conséquences irréparables, malgré les risques encourus, malgré l’apathie généralisée, peut-on préconiser de demeurer dans le camp de ceux qui continuent de prétendre qu’il faut agir au seuil de cette crise? Il faut conclure, à l’observation de la démission de Nicolas Hulot et des efforts internationaux pour tenter de la résoudre, qu’il n’existe en ce moment aucune institution dont la responsabilité est d’agir! Il va falloir la mettre en place…
À l’évidence des décisions politiques des dernières décennies, il n’est plus de la responsabilité des états d’exercer la gouvernance du territoire, des infrastructures et des services afin d’assurer la sécurité de la population. On observe indéniablement que les décisions politiques vont toutes exclusivement dans le sens de la gestion budgétaire, du développement économique et de la rentabilité financière. Ce qui s’explique en partie par la dérèglementation du modèle économique et surtout par la déresponsabilisation étatique du contrôle sur l’émission de la monnaie.
Les conséquences du modèle économique sont critiquées aussi loin dans l’histoire qu’au VIIe siècle. La connaissance sur les impacts climatiques des activités industrielles et économiques est connue depuis 1896. [1] Il est donc devenu indéniablement impossible d’ignorer les faits avec l’accumulation de recherches qui font déborder le consensus. Et les nier pourrait bien finir par être associé à des troubles comportementaux que les neurosciences cognitives sont déjà en mesure de démontrer.
Il est gênant pour l’humain d’avouer qu’il a fait fausse route depuis 5000 ans sur certains aspects de son organisation sociale. Mais il faut remettre en perspective que les connaissances scientifiques sur lesquelles appuyer notre conception de société n’étaient pas acquises à cette période de l’histoire.
Il faut également considérer la profusion de croyances farfelues, d’idéologies erronées et de philosophies déconnectées qui s’expliquent par le fait que la cognition humaine ne favorise pas la logique rationnelle neutre et objective, mais une heuristique de jugements rapides basée sur peu de données, résultant de son adaptation sur des millions d’années et qui a si bien servi sa capacité de survie dans un environnement hostile, contre lequel il n’a pas de moyens de défense physiologiques à part son « intelligence ».
L’éthologie humaine serait-elle un frein évolutif à sa survie face à l’Anthropocène? Avant d’entreprendre des démarches pour tenter de sauver l’humanité, il y a une hypothèse en ce moment qu’il faut vérifier. Cette hypothèse relève de l’évolution et des comportements humains inscrits dans sa génétique.
Il y a consensus scientifique que l’Anthropocène résulte des activités de l’espèce humaine. Ces activités résultent de l’adoption de stratégies comportementales déviantes des lois immuables et intransgressibles de la nature que nous transgressons depuis des siècles au nom du progrès et depuis la seconde guerre mondiale au nom de la croissance économique.
Nous pouvons scientifiquement démontrer que plusieurs stratégies comportementales psychosociales humaines découlent de l’adaptation à l’environnement de société, notamment au concept de monnaie et aux mécanismes de l’économie de consommation et de la finance. [2]
Il devient impossible de nier le lien comportemental direct entre ces concepts et mécanismes et les impacts dévastateurs sur l’environnement biophysique; la biodiversité, les sols, le climat, etc. En clair, les activités humaines résultant du développement économique et de la consommation sont directement responsables des symptômes de l’Anthropocène.
Conscients de ce fait, la question qui s’impose est : pouvons-nous résoudre les défis apparemment insurmontables de l’Anthropocène en éliminant les concepts et mécanismes de société responsables de l’adoption de stratégies comportementales déviantes?
Pour y répondre, il faut vérifier l’hypothèse suivante. Les comportements humains de recherche de pouvoir et d’accumulation de biens relèvent-ils d’une adaptation aux conditions environnementales de société ou sont-ils inscrits dans les gènes de notre espèce en tant que réaction de survie?
Si la première option est validée, il suffit simplement de changer les concepts et mécanismes de société afin d’architecturer un nouvel environnement social auquel les citoyens vont inévitablement s’adapter pour adopter de nouvelles stratégies comportementales.
Au contraire, si la seconde option est validée, il faudra adopter un mode de vie thérapeutique avec un soutien constant de la conscience de ces caractères éthologiques en démontrant qu’il est possible à l’humain de survivre tout en inhibant ces pulsions comportementales innées. Mais il faudra quand même changer radicalement nos concepts et mécanismes de société.
Dans le premier cas, l’adaptation pourrait être assez rapide, quelques années. Il suffit de vérifier les études sociologiques sur l’adoption des technologies comme l’automobile, l’Internet, les jeux vidéo ou les tablettes numériques.
Dans le second cas, l’adaptation pourrait exiger des décennies, voir des siècles. Il faudra que les conditions environnementales contraignantes subsistent suffisamment longtemps pour favoriser la sélection naturelle d’une partie de la population qui aura adapté ses stratégies comportementales pour survivre, ce qui pourrait engendrer les mutations génétiques souhaitées.
Sachant que nous avons 50% de chances pour chacune des options et sachant également par les neurosciences cognitives que l’adaptation est très développée chez l’humain, il serait judicieux de passer à l’action en assumant le succès, plutôt que de baisser les bras devant un éventuel échec à sauvegarder l’espèce humaine.
Bien que le défaitisme gagne du terrain et que la collapsologie se développe en parallèle aux recherches sur l’Anthropocène, il serait dommage de sacrifier trop promptement l’espèce humaine, comme si nous l’avions classée comme une espèce nuisible. Bon nombre d’espèces «nuisibles» sont nécessaires dans le biotope, parce qu’elles participent à maintenir des équilibres fragiles, mais importants.
Malgré le fait que le plus important mouvement dans l’univers soit le changement, il est toujours le résultat de la recherche de l’équilibre entre toutes les forces en présence. Nous avons toutes les connaissances pour faire les changements requis afin de recouvrer l’équilibre pour sortir de l’Anthropocène avant qu’il nous sorte par la liste des espèces en péril.
[1] Svante Arrhenius. On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon the Temperature of the Ground, Philosophical Magazine and Journal of Science, Series 5, Volume 41, April 1896, pages 237-276, [http://www.rsc.org/images/Arrhenius1896_tcm18-173546.pdf]
[2] Stéphane Brousseau. L’économie de l’Anthropocène, comment s’en sortir?, Institut de recherche en architecture de société durable (IRASD), 9 aout 2018, [En ligne],
[https://irasd.wordpress.com/2018/08/09/leconomie-de-lanthropocene-comment-sen-sortir/]
L’économie de l’Anthropocène, comment s’en sortir?
Cette analyse n’apporte rien de nouveau qu’on ne sait pas déjà. Elle ne fait que compiler et intégrer de nombreux constats de faits qui peuvent tous se confirmer par l’observation ou la lecture de rapports et de publications sérieuses.
On observe dans les médias une augmentation récente d’articles traitant de la dégradation de la planète au point de mettre à risque la survie de l’espèce humaine. Ce phénomène sociologique a d’intéressant qu’il reflète une réalité qui est en train de se concrétiser. Le risque d’effondrement n’est plus théorique, il s’accroit et même s’amorce sous nos yeux!
L’Anthropocène a de particulier qu’il s’agit officieusement de l’ère géologique qui fait le plus consensus et se définit par les traces indélébiles que laisseront les activités de la civilisation humaine dans les couches rocheuses et dans l’atmosphère terrestre.
L’Anthropocène résulte d’un puissant déni de faits et de responsabilité collective et individuelle dans la population dite «civilisée» des pays «développés» ou en «développement» qui s’inscrit profondément dans la génétique humaine de l’évolution du cerveau, avec ses limitations cognitives et ses stratégies comportementales à prédominance irrationnelle.
Tout au long de l’histoire, l’homme patauge dans des idéologies et des croyances erronées qui comblent sans effort cognitif son besoin instinctif d’expliquer la raison des choses qui l’entourent. Les sciences arrivent bien tard dans ce parcours où le mal est implanté dans la culture populaire et sont longtemps et encore aujourd’hui réfutées parce que leurs révélations ne correspondent pas toujours aux aspirations humaines.
«La vérité peut être déroutante. Un certain travail est nécessaire pour la maîtriser. Elle peut contredire profondément nos préjugés. Elle peut ne pas être conforme à ce que nous souhaitons désespérément être vrai. Mais nos préférences ne déterminent pas ce qui est vrai.»
– Carl Sagan [https://www.csicop.org/si/show/wonder_and_skepticism]
L’organisation des sociétés humaines s’est donc toujours appuyée sur des idéologies ou des philosophies justifiant les concepts et mécanismes qui la constituent et qui ont donné naissance à ses institutions. Au détriment de l’espèce, un septième de la population humaine s’implique activement à entretenir et développer la croissance d’un système dont la conception est complètement déconnectée de l’environnement biophysique : l’économie monétaire.
À l’intérieur de cette population humaine, il n’existe pratiquement aucune activité depuis la naissance jusqu’à la mort des individus qui ne soit pas directement ou indirectement assujettie ou complètement dépendante de cette économie. Et parmi ce groupe de population, tous contribuent obligatoirement de façon volontaire ou involontaire, consciente ou non à participer et à entretenir le maintien et la croissance de cette économie.
L’adaptation de cette population à l’environnement de société qui en résulte a induit l’adoption de stratégies comportementales très spécifiques, souvent déviantes et diamétralement différentes de celles des sociétés dites «primitives». On observe ces comportements chez aucune autre forme de vie! Et le pire est qu’une proportion croissante du reste de la population humaine aspire à se «développer» pour rejoindre la grande secte de l’économie!
L’amplitude grandissante de la pression exercée par les activités humaines liées à l’économie monétaire, constitue la source et la cause directe de l’Anthropocène et des symptômes de dégradation de l’environnement biophysique qui caractérisent cette époque. Pourtant, la capacité de croissance économique est de plus en plus anémique, parce que le système commence à atteindre ses propres limites, en plus de dépasser les capacités de régénération naturelles par son rythme de «développement» insoutenable pour l’environnement biophysique.
L’observation des comportements décisionnels des politiciens, des investisseurs économiques, des acteurs financiers et industriels au cours de l’histoire récente de l’humanité révèle une dissociation complète de la réalité biophysique et une ignorance persistante de ses lois immuables et intransgressibles. Les avertissements de la science sont ignorés et bafoués de manière hypocrite au bénéfice du développement économique.
Toutes les activités humaines responsables de l’Anthropocène se déroulent comme si l’environnement biophysique n’existait pas! Pourtant, il constitue ce qui maintient la vie en fournissant les ressources naturelles nécessaires pour l’alimentation et la reproduction. Mais les fragiles équilibres entre les lois naturelles sont bousculés et transgressés par les activités de la civilisation. Et il n’existe aucune autre planète habitable pour émigrer ni aucune technologie pour l’atteindre!
Poursuivre dans cette direction de «développement» en ignorant les faits et les conséquences largement diffusées par la science et les médias, constitue un acte de déni délibéré qui affiche des caractéristiques d’un trouble du comportement addictif pour lequel il est impossible de nier qu’il mène au suicide collectif.
Tout se passe comme si le développement économique monétaire était une maladie mentale obsessionnelle compulsive qui stimule déni de la réalité factuelle, dissonances cognitives, biais cognitifs, erreurs d’heuristique de jugement, croyances et décisions erronées… Ce cycle s’est amplifié depuis le début de l’ère industrielle, tel que le démontrent les indicateurs de croissance exponentielle de la démographie, de la production et de la consommation de ressources et d’énergies.
Un des grands principes de l’évolution de Darwin s’applique particulièrement bien de manière irréfutable parce qu’il est basé sur l’observation :
«La capacité à croître d’une population est infinie, mais la capacité d’un environnement à supporter les populations est toujours finie. Les populations croissent jusqu’à ce qu’elles soient stoppées par la disponibilité décroissante des ressources dans l’environnement. La compétition pour les ressources résulte de la lutte pour l’existence. Les êtres vivants ont besoin de nourriture pour croître et se reproduire. Lorsque la nourriture est abondante, les populations d’individus croissent jusqu’à ce que leur nombre dépasse la disponibilité locale de nourriture.»
IRASD. Évolution et adaptation, Dossiers de recherche en environnement humain, 2014,
Le concept de monnaie, inventé pour les échanges en remplacement du troc, est un outil post-Néolithique conséquent de l’affranchissement de la dépendance de l’espèce humaine à la nature pour assurer sa subsistance par la chasse et la cueillette. En passant d’un mode nomade au mode sédentaire favorisé par le développement de l’agriculture, une différenciation sociale s’est imposée parmi les individus de la société.
Changement charnière qui a amené les échanges commerciaux parce que la production agricole a favorisé l’adoption de stratégies comportementales différentes de celles des chasseurs-cueilleurs. Producteurs et consommateurs ont érodé les stratégies comportementales de collaboration et de mise en commun. Le partage des efforts communs s’est transformé en commerce des biens et services individuels. Ces mutations sociales altèrent le comportement et le jugement humain par adaptation.
D’un point de vue éthologique, le capitalisme résulte et engendre un trouble comportemental exacerbé par des idéologies philosophiques et des concepts erronées, totalement déconnectées de la réalité biophysique.
La plus grande erreur philosophique de l’humanité est sans doute celle de Descartes. «Nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature» serait, d’après un passage du Discours de la méthode, publié par le philosophe en 1637, ce que les hommes parviendront à faire lorsqu’ils auront développé leur savoir par la connaissance de la science.
L’idéologie erronée de Descartes, «maîtres et possesseurs de la nature», est la pensée magique qui est à la base de l’ère industrielle, des fondements de l’économie et de la politique modernes qui sont responsables de la destruction de l’environnement biophysique et de la déconnexion idéologique entre les concepts et mécanismes de l’environnement de société et les lois immuables et intransgressibles de l’environnement biophysique.
Descartes est le premier à établir un lien mécaniste entre science et technique, entre la connaissance de la nature et les moyens pouvant être mis en œuvre par l’homme pour la maîtriser. Il s’agit d’une erreur d’heuristique de jugement basée sur des biais cognitifs anthropocentristes. Cette «maîtrise» devrait plutôt être une symbiose et ne peut se concrétiser sans la connaissance et le respect des lois biophysiques révélées par les sciences.
Mais la science n’est pas la certitude absolue, elle n’est qu’une des méthodes favorisant de rapprocher la connaissance d’une compréhension des mécanismes du réel. La perfection ne s’y trouve pas. L’homme ne maîtrise pas et ne maîtrisera possiblement jamais suffisamment toutes les connaissances pour transformer la nature sans risque d’effets secondaires, simplement parce que le cerveau humain, d’un point de vue évolutif, neurologique et cognitif, ne le permet pas! Au-delà d’un certain nombre de concepts ou de variables, le nombre de probabilités dépasse la capacité du cerveau humain. Et surtout parce que l’organisation sociale de la civilisation ne favorise pas le temps nécessaire pour atteindre le niveau de compréhension requis avant de commettre des décisions.
Dans l’état actuel de la civilisation, aucun chef d’État ni décideur économique ne mettra jamais en application de mesures vraiment efficaces pour limiter les activités industrielles dégradant l’environnement par surexploitation et stopper les émissions de gaz à effet de serre afin de limiter les changements climatiques parce que cela impliquerait de sacrifier les investissements et la croissance économique des états.
Aucun mouvement populaire de masse efficace n’aura lieu non plus parce que cela impliquerait pour chacun de sacrifier son confort individuel et son avenir en perdant sa sécurité financière et en limitant sa consommation au strict minimum des besoins essentiels.
Toute action pour interrompre les dommages à la planète et améliorer les chances de survie de l’espèce humaine ne peut être péniblement concrétisée autrement qu’en stoppant l’économie et en limitant les activités industrielles au strict minimum des besoins vitaux de la population qui deviendront critiques à cause des changements climatiques. Et toutes les activités humaines doivent s’insérer dans un contexte durable qui tient compte des capacités de l’environnement biophysique à les supporter, par conséquent à les limiter!
Aucune économie monétaire ne pourra tenir dans de telles conditions…
Aucun effondrement de civilisation ne peut se produire d’une cause unique…
L’enjeu et le défi sont titanesques.
Il pourrait exister d’autres solutions menant à d’autres futurs, mais il ne reste plus de temps pour trouver les chemins qui nous y mèneraient peut-être… car plus rien n’est certain dans un système fermé dont on déstabilise les équilibres naturels avec force et insistance.
Le 7e stade du développement moral, une évolution urgente de l’humanité
Selon le modèle psychologique de Kohlberg, le développement moral passe par 6 stades de développement. Les recherches documentaires de l’IRASD tendent à confirmer des constats faisant consensus dans divers domaines scientifiques et correspondants à l’observation des stratégies comportementales humaines, à savoir que les lois et conventions sociales assurant l’ordre et le bon fonctionnement de la civilisation sont appuyées sur des idéologies et philosophies résultant de la cognition humaine et non sur des lois naturelles de l’environnement biophysique faisant consensus scientifique.
Ces idéologies résultent de biais et dissonances cognitives, d’erreurs d’heuristique de jugement et du déni de la réalité factuelle qui sont caractéristiques de l’évolution de la cognition humaine. L’éthologie des stratégies comportementales humaines semble démontrer qu’elles tendent à favoriser l’atteinte et l’amélioration d’un niveau de confort psychologique et physique acceptable pour les individus, afin d’assurer le fonctionnement individuel dans le modèle social de convention décrit par le modèle psychologique de Kohlberg. Autrement, il en résulte de l’instabilité et des conflits sociaux.
Pour atteindre ces objectifs, l’espèce humaine a développé des concepts et mécanismes de société et de nombreuses stratégies comportementales déviantes, tous basés sur des idéologies et philosophies erronées, visant à exploiter à outrance les ressources humaines et naturelles. Les conséquences de cette exploitation ont largement dépassé la capacité naturelle de l’environnement biophysique à les compenser et provoquent avec l’explosion démographique de l’espèce humaine, une nouvelle ère géologique : l’Anthropocène, caractérisée par des traces gravées dans la géologie de la planète que laissent les activités humaines dans la nature.
Au-delà de ces traces, plus grave encore, il y a la déstabilisation des fragiles équilibres naturels entre les environnements biophysique, humain et social. Cette déstabilisation affecte toutes les niches écologiques occupées par l’homme, provoque l’extinction de la biodiversité, la réduction de la capacité du système à supporter la vie, la dégradation de l’environnent et du climat. Par conséquent, la déstabilisation même du système de civilisation et met ainsi à risque la survie de l’espèce humaine.
Cette situation périlleuse ouvre quand même la voie vers un 7e stade du modèle de Kohlberg que l’espèce humaine aurait avantage à atteindre pour accroître ses chances de survie dans un environnement en profonde mutation rapide qui risque de mettre en péril la civilisation et l’espèce humaine. Une profonde prise de conscience devra précéder l’éducation et l’adaptation de l’usage de la cognition humaine pour prendre en compte ses caractéristiques cognitives avec ses biais, ses dissonances et le risque d’erreurs d’heuristique de jugement qui en découle. Ainsi, l’espèce humaine évoluera afin d’assurer sa survie afin de prendre des décisions qui doivent inévitablement être en accord direct avec le maintien des équilibres fragiles assurant le maintien de la vie sur Terre.
Autrement, le temps est compté! Et l’horloge tourne aussi vite que la volonté humaine d’accélérer le développement du modèle actuel de civilisation…
Stade 7
Le stade 7 est orienté vers une remise en question des principes moraux universels qui ne sont basés que sur la cognition humaine sans aucune référence dans l’environnement biophysique. Le raisonnement moral étant basé sur une pensée abstraite qui utilise des principes éthiques, le stade 7 est basé sur les connaissances en neurosciences cognitives, en psychologie cognitive et dans les autres sciences et connaissances des mécanismes de l’environnement biophysique.
Au stade 7, les lois ne sont valables que dans la mesure où elles sont fondées sur les lois immuables de la nature et non sur la justice qui ne fait office que de convention. Il y a une obligation de remettre en question la totalité des lois sociales et même des principes de moralité. Les droits légaux contrevenant aux lois biophysiques sont des nuisances potentielles à la survie de l’espèce humaine, car des contrats sociaux ne sont pas en symbiose avec les lois de la nature. La personne agit parce que cela garantit le confort individuel et non la survie de son espèce. Par conséquent, elle doit se conformer à un système de convention qui met à risque cette même survie, parce que c’est dans le meilleur intérêt du système de conventions et non de l’espèce. C’est seulement en respectant les lois naturelles qu’on assure les équilibres nécessaires à la survie et non en se conformant à ce qui est socialement attendu, légal ou préalablement convenu.
Le stade 7 remet en question toutes les idéologies et philosophies fausses ou erronées issues des nombreux biais cognitifs, dissonances cognitives et erreurs d’heuristique de jugement de l’histoire de l’humanité qui entraînent le déni de la réalité factuelle au bénéfice du confort psychologique et physique de l’humain. Le stade 7 est une application élargie de la zététique.
http://www.psychomedia.qc.ca/psychologie/2015-06-07/stades-developpement-moral-kohlberg
Les 6 stades du développement moral selon le célèbre modèle psychologique de Kohlberg
7 juin 2015
Le modèle du développement moral du psychologue américain Lawrence Kohlberg a dominé la recherche en psychologie de la morale de 1958 à la fin des années 1980. Bien que certains aspects aient été critiqués, son influence est toujours importante.
Il a été développé en soumettant des sujets à une diversité de dilemmes moraux et en analysant leurs formes de raisonnement. Ces dernières ont été classées en trois niveaux se divisant chacun en 2 stades.
Ces stades sont séquentiels, c’est-à-dire qu’ils se développent par étapes successives. Ils sont généralement irréversibles, les régressions étant rares. Ils sont intégratifs, c’est-à-dire qu’une personne ayant acquis un stade supérieur est en mesure de comprendre les raisonnements des personnes ayant atteint les stades précédents. Ils sont transculturels, c’est-à-dire que dans toutes les cultures, le développement moral suit les mêmes étapes. Et, tous les individus ne se rendent pas aux stades les plus avancés.
La moralité préconventionnelle (ou prémoralité)
La moralité préconventionnelle est caractérisée par une perception des règles limitée par l’égocentrisme. Les règles sont extérieures à l’enfant qui les perçoit à travers la punition et la récompense.
- Stade 1
Le stade 1 est orienté vers l’évitement de la punition et l’obéissance à l’autorité. L’enfant est centré sur les conséquences directes de ses actions sur lui-même.
- Stade 2
Le stade 2 est orienté vers l’intérêt personnel. L’enfant intègre les récompenses et les avantages, toujours dans une optique limitée par l’égocentrisme, c’est-à-dire qui manque de perspective sociétale ou relationnelle.
La moralité conventionnelle
La moralité conventionnelle est typique des adolescents et des adultes. Raisonner d’une façon conventionnelle consiste à juger de la moralité des actions en les comparant aux opinions et aux attentes de la société.
La morale conventionnelle est caractérisée par une acceptation des conventions de la société concernant le bien et le mal. À ces stades, une personne obéit aux règles et suit les normes de la société, même quand il n’y a pas de conséquence pour l’obéissance ou la désobéissance. Le respect des règles et des conventions est quelque peu rigide, cependant, et la pertinence ou l’équité d’une règle est rarement remise en question.
- Stade 3
Le stade 3 est orienté vers le maintien des bonnes relations et l’approbation des autres. La personne est réceptive à l’approbation et à la désapprobation comme indices des vues de la société. Elle essaie d’être un « bon garçon » ou « bonne fille » à la hauteur des attentes, car elle a appris qu’être jugée positivement est avantageux. La personne peut évaluer la moralité d’une action par ses conséquences sur ses relations qui incluent le respect et la gratitude.
- Stade 4
Le stade 4 est orienté vers le respect de la loi et des conventions sociales qui sont jugées importantes pour le maintien de l’ordre social. Violer une loi est moralement répréhensible. Selon Kohlberg, les membres les plus actifs de la société demeurent au stade 4 dans lequel la morale est principalement dictée par une force extérieure.
La moralité post-conventionnelle (ou moralité basée sur les principes)
La moralité post-conventionnelle est orientée vers des principes qui se situent au-delà des balises d’une société en particulier. 20 à 25 % seulement des adultes atteindraient ces stades. Les personnes qui se situent à ce stade peuvent désobéir aux règles qui ne sont pas compatibles avec leurs propres principes.
Ces principes concernent généralement les droits fondamentaux de la personne comme la vie, la liberté et la justice. Les personnes qui manifestent une morale post-conventionnelle voient les règles comme des mécanismes utiles, mais modifiables — idéalement, les règles devraient maintenir l’ordre social général et protéger les droits humains. Les règles ne sont pas impératifs absolus qui doivent être respectées sans être questionnées.
- Stade 5
Le stade 5 est orienté vers le contrat social. Le monde est considéré comme incluant des opinions différentes, des droits et des valeurs. Les lois sont considérées comme des contrats sociaux plutôt que des dictats rigides. Celles qui ne favorisent pas le bien-être général doivent être remplacées lorsque nécessaire pour promouvoir le plus grand bien pour le plus grand nombre de personnes.
- Stade 6
Le stade 6 est orienté vers des principes moraux universels. Le raisonnement moral est basé sur une pensée abstraite qui utilise des principes éthiques.
Les lois ne sont valables que dans la mesure où elles sont fondées sur la justice. Il y a une obligation de désobéir à des lois injustes. Les droits légaux ne sont pas nécessaires, car des contrats sociaux ne sont pas essentiels pour l’action morale déontique. La personne agit parce que c’est juste, et non parce qu’elle évite la punition, parce que c’est dans son meilleur intérêt ou parce que c’est ce qui est attendu, légal ou préalablement convenu.
Selon Kohlberg, 13 % de la population adulte atteindrait le stade 6. Il est toutefois difficile, estimait-il, de trouver des gens qui opèrent toujours à ce niveau.
Le modèle de Kohlberg a reçu des critiques selon diverses perspectives et est aujourd’hui relativement discrédité. L’une de ces critiques, provenant de la psychologue Carol Gilligan, est qu’il mettrait trop l’emphase sur la valeur de justice à l’exclusion d’autres valeurs morales telle que le « prendre soin » et qu’il sous-évaluerait ainsi la moralité des femmes. Une autre critique provient d’un courant, recevant aussi son propre lot de critiques, qui estime que le raisonnement moral n’est souvent qu’une rationalisation a posteriori de décisions essentiellement intuitives.
Selon une étude du psychologue Steven J Haggbloom et ses collègues, Kohlberg a été le 16e psychologue le plus fréquemment cité du XXIe siècle dans les manuels d’introduction à la psychologie et le 30e en tenant compte de différents critères tels que les citations dans les articles scientifiques.
- Une explication pour la tendance aux jugements moraux « noir ou blanc »
- L’illusion de supériorité morale : vous en seriez sans doute atteint-e
Source :
La « pensée magique » accélère l’effondrement
La « pensée magique » exacerbe le déni, les biais cognitifs et l’heuristique de jugement. Une démarche d’analyse rationnelle, objective, neutre et intégrée de la compréhension, ouvre la porte vers l’architecture de société.
Chris Hedges: America’s Mania for Positive Thinking and Denial of Reality Will Be Our Downfall
The ridiculous positivism, the belief that we are headed toward some glorious future, defies reality.
By Chris Hedges / Truthdig
May 27, 2015
The naive belief that history is linear, that moral progress accompanies technical progress, is a form of collective self-delusion. It cripples our capacity for radical action and lulls us into a false sense of security. Those who cling to the myth of human progress, who believe that the world inevitably moves toward a higher material and moral state, are held captive by power. Only those who accept the very real possibility of dystopia, of the rise of a ruthless corporate totalitarianism, buttressed by the most terrifying security and surveillance apparatus in human history, are likely to carry out the self-sacrifice necessary for revolt.
The yearning for positivism that pervades our corporate culture ignores human nature and human history. But to challenge it, to state the obvious fact that things are getting worse, and may soon get much worse, is to be tossed out of the circle of magical thinking that defines American and much of Western culture. The left is as infected with this mania for hope as the right. It is a mania that obscures reality even as global capitalism disintegrates and the ecosystem unravels, potentially dooming us all.
The 19th century theorist Louis-Auguste Blanqui, unlike nearly all of his contemporaries, dismissed the belief, central to Karl Marx, that human history is a linear progression toward equality and greater morality. He warned that this absurd positivism is the lie perpetrated by oppressors: “All atrocities of the victor, the long series of his attacks are coldly transformed into constant, inevitable evolution, like that of nature. … But the sequence of human things is not inevitable like that of the universe. It can be changed at any moment.” He foresaw that scientific and technological advancement, rather than being a harbinger of progress, could be “a terrible weapon in the hands of Capital against Work and Thought.” And in a day when few others did so, he decried the despoiling of the natural world. “The axe fells, nobody replants. There is no concern for the future’s ill health.”
“Humanity,” Blanqui wrote, “is never stationary. It advances or goes backwards. Its progressive march leads it to equality. Its regressive march goes back through every stage of privilege to human slavery, the final word of the right to property.” Further, he wrote, “I am not amongst those who claim that progress can be taken for granted, that humanity cannot go backwards.”
Blanqui understood that history has long periods of cultural barrenness and brutal repression. The fall of the Roman Empire, for example, led to misery throughout Europe during the Dark Ages, roughly from the sixth through the 13th centuries. There was a loss of technical knowledge (one prominent example being how to build and maintain aqueducts), and a cultural and intellectual impoverishment led to a vast historical amnesia that blotted out the greatest thinkers and artists of the classical world. None of this loss was regained until the 14th century when Europe saw the beginning of the Renaissance, a development made possible largely by the cultural flourishing of Islam, which through translating Aristotle into Arabic and other intellectual accomplishments kept alive the knowledge and wisdom of the past. The Dark Ages were marked by arbitrary rule, incessant wars, insecurity, anarchy and terror. And I see nothing to prevent the rise of a new Dark Age if we do not abolish the corporate state. Indeed, the longer the corporate state holds power the more likely a new Dark Age becomes. To trust in some mythical force called progress to save us is to become passive before corporate power. The people alone can defy these forces. And fate and history do not ensure our victory.
Blanqui tasted history’s tragic reverses. He took part in a series of French revolts, including an attempted armed insurrection in May 1839, the 1848 uprising and the Paris Commune—a socialist uprising that controlled France’s capital from March 18 until May 28 in 1871. Workers in cities such as Marseilles and Lyon attempted but failed to organize similar communes before the Paris Commune was militarily crushed.
The blundering history of the human race is always given coherence by power elites and their courtiers in the press and academia who endow it with a meaning and coherence it lacks. They need to manufacture national myths to hide the greed, violence and stupidity that characterize the march of most human societies. For the United States, refusal to confront the crisis of climate change and our endless and costly wars in the Middle East are but two examples of the follies that propel us toward catastrophe.
Wisdom is not knowledge. Knowledge deals with the particular and the actual. Knowledge is the domain of science and technology. Wisdom is about transcendence. Wisdom allows us to see and accept reality, no matter how bleak that reality may be. It is only through wisdom that we are able to cope with the messiness and absurdity of life. Wisdom is about detachment. Once wisdom is achieved, the idea of moral progress is obliterated. Wisdom throughout the ages is a constant. Did Shakespeare supersede Sophocles? Is Homer inferior to Dante? Does the Book of Ecclesiastes not have the same deep powers of observation about life that Samuel Beckett offers? Systems of power fear and seek to silence those who achieve wisdom, which is what the war by corporate forces against the humanities and art is about. Wisdom, because it sees through the facade, is a threat to power. It exposes the lies and ideologies that power uses to maintain its privilege and its warped ideology of progress.
Knowledge does not lead to wisdom. Knowledge is more often a tool for repression. Knowledge, through the careful selection and manipulation of facts, gives a false unity to reality. It creates a fictitious collective memory and narrative. It manufactures abstract concepts of honor, glory, heroism, duty and destiny that buttress the power of the state, feed the disease of nationalism and call for blind obedience in the name of patriotism. It allows human beings to explain the advances and reverses in human achievement and morality, as well as the process of birth and decay in the natural world, as parts of a vast movement forward in time. The collective enthusiasm for manufactured national and personal narratives, which is a form of self-exaltation, blots out reality. The myths we create that foster a fictitious hope and false sense of superiority are celebrations of ourselves. They mock wisdom. And they keep us passive.
Wisdom connects us with forces that cannot be measured empirically and that are outside the confines of the rational world. To be wise is to pay homage to beauty, truth, grief, the brevity of life, our own mortality, love and the absurdity and mystery of existence. It is, in short, to honor the sacred. Those who remain trapped in the dogmas perpetuated by technology and knowledge, who believe in the inevitability of human progress, are idiot savants.
“Self-awareness is as much a disability as a power,” the philosopher John Gray writes. “The most accomplished pianist is not the one who is most aware of her movements when she plays. The best craftsman may not know how he works. Very often we are at our most skillful when we are least self-aware. That may be why many cultures have sought to disrupt or diminish self-conscious awareness. In Japan, archers are taught that they will hit the target only when they no longer think of it—or themselves.”
Artists and philosophers, who expose the mercurial undercurrents of the subconscious, allow us to face an unvarnished truth. Works of art and philosophy informed by the intuitive, unarticulated meanderings of the human psyche transcend those constructed by the plodding conscious mind. The freeing potency of visceral memories does not arrive through the intellect. These memories are impervious to rational control. And they alone lead to wisdom.
Those with power have always manipulated reality and created ideologies defined as progress to justify systems of exploitation. Monarchs and religious authorities did this in the Middle Ages. Today this is done by the high priests of modernity—the technocrats, scholars, scientists, politicians, journalists and economists. They deform reality. They foster the myth of preordained inevitability and pure rationality. But such knowledge—which dominates our universities—is anti-thought. It precludes all alternatives. It is used to end discussion. It is designed to give to the forces of science or the free market or globalization a veneer of rational discourse, to persuade us to place our faith in these forces and trust our fate to them. These forces, the experts assure us, are as unalterable as nature. They will lead us forward. To question them is heresy.
The Austrian writer Stefan Zweig, in his 1942 novella “Chess Story,” chronicles the arcane specializations that have created technocrats unable to question the systems they serve, as well as a society that foolishly reveres them. Mirko Czentovic, the world chess champion, represents the technocrat. His mental energy is invested solely in the 64 squares of the chessboard. Apart from the game, he is a dolt, a monomaniac like all monomaniacs, who “burrow like termites into their own particular material to construct, in miniature, a strange and utterly individual image of the world.” When Czentovic “senses an educated person he crawls into his shell. That way no one will ever be able to boast of having heard him say something stupid or of having plumbed the depths of his seemingly boundless ignorance.”
An Austrian lawyer known as Dr. B, whom the Gestapo had held for many months in solitary confinement, challenges Czentovic to a game of chess. During his confinement, the lawyer’s only reading material was a chess manual, which he memorized. He reconstructed games in his head. Forced by his captivity to replicate the single-minded obsession of the technocrat Czentovic, Dr. B too became trapped inside a specialized world, and, unlike Czentovic, he became insane temporarily as he focused on a tiny, specialized piece of human activity. When he challenges the chess champion, his insanity returns.
Zweig, who mourned for the broad liberal culture of educated Europe swallowed up by fascism and modern bureaucracy, warns of the absurdity and danger of a planet run by technocrats. For him, the rise of the Industrial Age and the industrial man and woman is a terrifying metamorphosis in the relationship of human beings to the world. As specialists and bureaucrats, human beings become tools, able to make systems of exploitation and even terror function efficiently without the slightest sense of personal responsibility or understanding. They retreat into the arcane language of all specialists, to mask what they are doing and give to their work a sanitized, clinical veneer.
This is Hannah Arendt’s central point in “Eichmann in Jerusalem.” Technocratic human beings are spiritually dead. They are capable of anything, no matter how heinous, because they do not reflect upon or question the ultimate goal. “The longer one listened to him,” Arendt writes of the Nazi Adolf Eichmann on trial, “the more obvious it became that his inability to speak was closely connected with an inability to think, namely, to think from the standpoint of somebody else. No communication was possible with him, not because he lied but because he was surrounded by the most reliable of all safeguards against the words and presence of others, and hence against reality as such.”
Zweig, horrified by a world run by technocrats, committed suicide with his wife in 1942. He knew that from then on, the Czentovics would be exalted in the service of state and corporate monstrosities.
Resistance, as Alexander Berkman points out, is first about learning to speak differently and abandoning the vocabulary of the “rational” technocrats who rule. Once we discover new words and ideas through which to perceive and explain reality, we free ourselves from neoliberal capitalism, which functions, as Walter Benjamin knew, like a state religion. Resistance will take place outside the boundaries of popular culture and academia, where the deadening weight of the dominant ideology curtails creativity and independent thought.
As global capitalism disintegrates, the heresy our corporate masters fear is gaining currency. But that heresy will not be effective until it is divorced from the mania for hope that is an essential part of corporate indoctrination. The ridiculous positivism, the belief that we are headed toward some glorious future, defies reality. Hope, in this sense, is a form of disempowerment.
There is nothing inevitable about human existence except birth and death. There are no forces, whether divine or technical, that will guarantee us a better future. When we give up false hopes, when we see human nature and history for what they are, when we accept that progress is not preordained, then we can act with an urgency and passion that comprehends the grim possibilities ahead.
Chris Hedges, a Pulitzer Prize-winning reporter, writes a regular column for Truthdig every Monday. Hedges’ most recent book is « Wages of Rebellion: The Moral Imperative of Revolt. »
Notre raison est-elle rationnelle? | CNRS Le journal
Les preuves scientifiques s’accumulent contre la «raison» humaine en faveur d’une cognition génétiquement irrationnelle.
https://lejournal.cnrs.fr/articles/notre-raison-est-elle-rationnelle
Notre raison est-elle rationnelle?

L’adage dit qu’on a toujours deux raisons pour faire quelque chose : une bonne raison et la vraie raison. Des travaux en neurosciences et en psychologie tendent aujourd’hui à montrer que la vraie raison est rarement rationnelle.
Faites entrer l’accusé ! Un tribunal scientifique, présidé par des chercheurs en sciences cognitives, ouvre un procès inédit : celui de notre raison. D’un côté la défense se veut sereine. Les preuves sont là : des centaines voire des milliers d’écrits de philosophes ou encore de longues listes de prix distinguant les plus grands savants qui ont éclairé au fil des siècles la connaissance humaine. La démonstration est irréfutable, triomphante : notre raison célèbre la logique, seule à même d’éclairer nos choix.
De l’autre, l’accusation n’est pas en reste : sur sa table, des piles d’articles scientifiques, des résultats d’imagerie cérébrale, autant d’expériences de psychologie et de neurosciences.
La fonction première de la raison est sociale.
Leur ouvrage, L’Énigme de la raison2, a de quoi semer le doute dans l’assemblée. Fruit d’un travail de longue haleine, ce livre s’oppose avec force et conviction aux tenants de la raison dite intellectualiste : « La fonction première de la raison est sociale », avance ainsi Hugo Mercier.
Logique ou conformisme ?
Allons là où se tranche le débat : dans la tête d’un juré au moment de livrer son verdict. Sa décision finale est-elle le fruit d’un raisonnement personnel, logique et rigoureux, ou le résultat d’un processus plus intuitif et social ? Pour y répondre, le neuroscientifique lyonnais Jean-Claude Dreher3 a réalisé une étude originale publiée en juin 2017 dans la revue Plos Biology4.
Voici comment. Plongez un juré dans un instrument d’imagerie cérébrale fonctionnelle et demandez-lui de statuer sur plusieurs affaires criminelles. Pour chaque cas, une fois son verdict établi, proposez-lui de réviser, le cas échéant, son jugement en fonction des avis des autres jurés. Observez alors ce qui se passe dans son cerveau quand il prend la décision finale.
Résultat : « Nous avons observé que plus la confiance d’un juré en son propre verdict est faible, plus il aura tendance à réviser son jugement et à suivre la décision collective. L’avis du jury pèse d’autant plus sur la décision individuelle que le nombre de jurés est élevé », explique Jean-Claude Dreher. Notre raison serait-elle donc plus conformiste que prompte à affirmer sa propre logique ? « Le biais de conformisme a souvent été invoqué pour expliquer ce comportement. Ici, c’est un mécanisme plus subtil qui est à l’œuvre », nuance le chercheur.
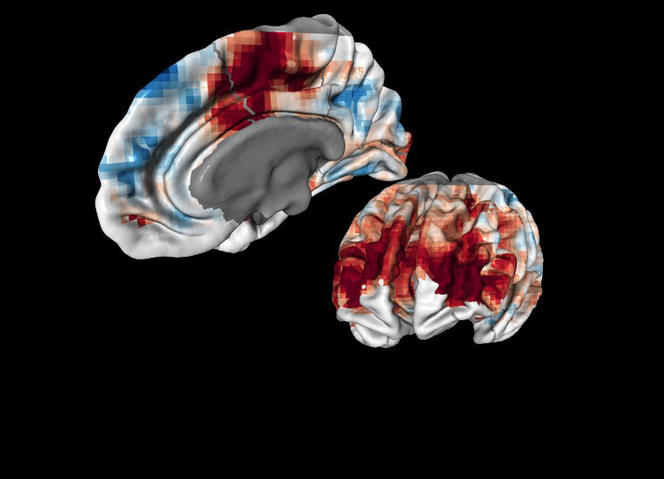 Rendu 3D d’imagerie IRMf montrant la prise de décision au sein du cerveau. Deux régions cérébrales sont impliquées lors d’une décision sociale pondérant la confiance en son propre choix et la crédibilité qu’on accorde à l’information d’autrui : le cortex fronto-polaire (à droite, en rouge) et le cortex cingulaire antérieur (à gauche, en rouge).
Rendu 3D d’imagerie IRMf montrant la prise de décision au sein du cerveau. Deux régions cérébrales sont impliquées lors d’une décision sociale pondérant la confiance en son propre choix et la crédibilité qu’on accorde à l’information d’autrui : le cortex fronto-polaire (à droite, en rouge) et le cortex cingulaire antérieur (à gauche, en rouge).
De l’inférence à la décision
La prise de décision du juré est en effet plus inférentielle que moutonnière. Inférentielle ? En sciences cognitives, on parle de processus d’inférence lorsqu’un mécanisme permet de tirer des conclusions générales, ou des représentations mentales globales, à partir d’un certain nombre d’informations parcellaires. Par exemple, notre système visuel – composé de plusieurs aires du cerveau, des nerfs optiques et des yeux – permet d’inférer la représentation d’une scène visuelle à partir d’un ensemble hétéroclite et non exhaustif d’informations visuelles perçues. Ou bien, lorsque le matin nous ouvrons nos volets et que nous découvrons un ciel gris et menaçant, nous inférons, sur la base de ce constat et de nos expériences passées, qu’il risque de pleuvoir dans la journée.
La raison ne sert pas tant à guider nos choix qu’à inférer des raisons pour les justifier.
Dans le cas de notre juré, Jean-Claude Dreher et ses confrères sont parvenus à localiser précisément les deux régions du cerveau qui réalisent cette inférence. Il s’agit même ici d’une inférence probabiliste, c’est-à-dire que les informations participant à la prise de décision sont pondérées selon leur degré de certitude.
Comment ? Considérons le cortex frontopolaire, dénommé FPC – pour frontopolar cortex en anglais – situé juste derrière nos yeux. Le FPC est connu pour abriter des facultés cognitives spécifiques à la vie en société : des études chez les primates ont ainsi démontré que la densité de matière grise du FPC augmentait de pair avec les interactions sociales. « Cette région évalue la crédibilité des informations que nous recevons des autres, explique Jean-Claude Dreher. Lorsque le juré prend connaissance du verdict des autres jurés, le FPC en évalue la pertinence. Cette donnée sociale est alors intégrée au sein d’une deuxième région, dans la partie dorsale du cortex cingulaire antérieur, qui joue ici le rôle de centre de décision. Celle-ci résulte alors de l’intégration de l’information sociale en provenance du FPC et de l’information individuelle, tout en pondérant chacune des deux sources par son degré de confiance. »
Des intuitions justifiées par la raison
À l’image de la décision du juré, notre raison serait-elle davantage la combinaison d’intuitions et de jugements sociaux que de raisonnements explicites et de logique ? « Les intuitions jouent un rôle clé dans l’expérience que nous avons du monde, confirme Hugo Mercier. La raison sert avant tout à les expliquer et à les justifier. Par exemple, expliciter avec des mots sa propre décision vient souvent après avoir pris la décision elle-même. La raison ne sert pas tant à guider nos choix qu’à inférer des raisons pour les justifier ». La raison produirait donc après coup ses raisons ? Cette tautologie apparente nous en ferait presque perdre notre latin – il faut dire que l’étymologie commune empruntée au latin ratio est elle-même confondante et n’aide pas vraiment à distinguer la fonction cognitive (la raison) de ses « productions » (les raisons).
Pour tenter de retrouver un peu le sens de la raison, reprenons l’expérience de pensée dans laquelle un individu prend son parapluie un matin où le ciel est nuageux. Même si elle n’y a pas explicitement réfléchi au moment où elle l’a prise, sa décision d’emporter le parapluie découle d’une vague intuition: la présence de nuages est généralement annonciatrice de pluie. Supposons maintenant qu’il ait finalement fait grand soleil toute la journée et que, rentrant le soir, l’individu croise un ami qui l’interroge, surpris, sur la présence du parapluie. C’est seulement là, pour justifier la présence désormais incongrue de cet objet, qu’il va fournir une raison explicite (et rationnelle) à sa décision matinale.
À bien y réfléchir, chacune de nos journées est ainsi rythmée par ces situations où nous devons justifier nos propres décisions aux yeux des autres (famille, amis, collègues de travail, etc.) ? Face au jugement des autres, nous nous faisons constamment l’avocat de nous-même. Et notre raison nous aide à étayer nos plaidoiries.
« Les raisons produites par notre raison sont destinées en premier lieu à l’usage social, gage Hugo Mercier. Sa finalité est argumentative afin de nous justifier et de convaincre les autres. » Et à ce jeu subjectif, la raison n’est pas toujours guidée par un principe intrinsèque d’objectivité. Les raisons objectives relèveraient bien davantage de la morale que de la réalité de notre cerveau.
Mais, rassurons-nous, la « raison interactionnelle », comme la qualifient Hugo Mercier et Dan Sperber, n’aboutit pas forcément à la manipulation ou à la tromperie. Le film Douze hommes en colère illustre sur ce point combien l’échange de raisons au sein d’un jury peut sauver un jeune garçon de la chaise électrique. « Le dénouement heureux de cette fiction peut sembler optimiste, mais plusieurs études en sciences cognitives soulignent à quel point le dialogue au sein d’un groupe conduit à de meilleures solutions », souligne Hugo Mercier. L’étude de Jean-Claude Dreher évoquée précédemment révèle également l’influence parfois positive du groupe. Les scientifiques parlent alors de « sagesse des foules ».
 Scène du film «Douze hommes en colère» réalisé en 1957 par Sidney Lumet. Le juré n° 8 (Henry Fonda, debout) expose ses arguments aux autres jurés.
Scène du film «Douze hommes en colère» réalisé en 1957 par Sidney Lumet. Le juré n° 8 (Henry Fonda, debout) expose ses arguments aux autres jurés.
Pourtant, nombreux sont les exemples où une foule fait davantage preuve de folie que de sagesse. Et l’ironie de Pierre Desproges à l’égard des sociétés humaines au sein desquelles « l’intelligence ne s’additionne pas mais se divise », reste toujours aussi mordante et actuelle. La question n’est toutefois pas de faire de cette raison interactionnelle un mécanisme cognitif qui aurait évolué au fil des millénaires au seul bénéfice de la vie sociale.
La théorie de l’évolution ne reconnaît en effet que des avantages sélectifs individuels. Si la société bénéficie des lumières de nos raisons individuelles lorsque celles-ci s’accordent, ces dernières visent bien en premier lieu à promouvoir notre propre intérêt.
« La raison est une adaptation à la vie sociale où la confiance doit être gagnée et demeure limitée et fragile, explique Hugo Mercier. C’est pourquoi nous sommes plus prompts à pointer les erreurs de raisonnement chez les autres qu’à démasquer les nôtres. » En science cognitive, cette mauvaise foi s’illustre au travers de biais cognitifs largement documentés sous les noms de biais de confirmation, effet retour de flamme, dissonance cognitive, etc. « Si la raison, poursuit-il, était avant tout une faculté visant à la construction rigoureuse d’un savoir objectif, comment l’évolution aurait-elle pu sélectionner autant d’imperfections ? » Question d’exigence intellectuelle, pourrions-nous objecter ? Hélas, ces biais ne disparaissent pas non plus des esprits les plus aguerris. L’exemple du prix Nobel de chimie Linus Pauling est sur ce point éloquent. « La qualité de ses travaux scientifiques est incontestable. En revanche, son entêtement à défendre les croyances sur les pouvoirs miraculeux de la vitamine C, censée guérir rhumes et cancers, était totalement irrationnel », rappelle Hugo Mercier.
Il n’y a bien que sous l’hypothèse d’une raison interactionnelle que « ces biais et cette paresse de raisonnement ne sont plus des défauts au regard de l’évolution, souligne le chercheur, mais bien des caractéristiques au service de la véritable fonction de la raison. Nous sommes biaisés vers des raisons qui soutiennent notre point de vue car c’est ainsi que nous pouvons justifier nos actions aux yeux des autres et les convaincre d’embrasser nos idées ».
Faculté distinctive forgée au fil des millénaires, notre raison conjugue autant notre désir de faciliter notre vie sociale que notre crainte légitime envers les esprits malveillants. Dès lors, toute démarche rationnelle nécessite la pleine conscience de notre raison « égoïste » afin de pouvoir en déjouer les biais et les erreurs. C’est dans ce sens que la démarche scientifique s’est instituée : chaque argument y est passé au crible de l’évaluation par la communauté de chercheurs. Au sein de nos multiples interactions sociales, concilier au mieux l’intérêt individuel et collectif demeure encore, sur ce point, un vrai défi pour la raison. ♦
Lire aussi le point de vue du neurobiologiste Thomas Boraud : « Cogitez si vous voulez, les décisions sont irrationnelles »
Notes
- 1.Unité CNRS/Université Claude-Bernard.
- 2.The Enigma of Reason. A New Theory of Human Understanding, Allen Lane, mars 2017, 416 pages.
- 3.Directeur de recherche à l’Institut des sciences cognitives Marc-Jeannerod (CNRS/Université Claude-Bernard).
- 4.« Integration of individual and social information for decision-making in groups of different sizes », S. A. Park, S. Goïame, D. A. O’Connor et J.-C. Dreher, Plos Biology, publié en ligne le 28 juin 2017.
Émissions de CO2 : L’effondrement nutritionnel – l’humanité pourrait ne pas pouvoir se nourrir au cours de la prochaine décennie
L’accroissement du CO2 atmosphérique provenant des sources de combustion affecte non seulement le climat, mais également la capacité des plantes et l’alimentation des insectes polinisateurs en produisant de de la nourriture appauvrie en nutriments pour l’espèce humaine.

Quelques références.
*
Helena Bottemiller Evich. « The great nutrient collapse – The atmosphere is literally changing the food we eat, for the worse. And almost nobody is paying attention », The Agenda, 2017-09-13,
[ https://www.politico.com/agenda/story/2017/09/13/food-nutrients-carbon-dioxide-000511 ]
*
Abdi Latif Dahir. « In 10 years, the world may not be able to feed itself », World Economic Forum, Agenda, 12 Sep 2017
[ https://www.weforum.org/agenda/2017/09/in-10-years-the-world-may-not-be-able-to-feed-itself/ ]
*
Irakli Loladze. « Rising atmospheric CO2 and human nutrition: toward globally imbalanced plant stoichiometry? », Trends in Ecology & Evolution, Volume 17, Issue 10, 1 October 2002, Pages 457-461, https://doi.org/10.1016/S0169-5347(02)02587-9,
[ http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169534702025879 ],
*
Irakli Loladze. « Hidden shift of the ionome of plants exposed to elevated CO2 depletes minerals at the base of human nutrition », eLife. 2014; 3: e02245, 2014 May 7, Max Planck Institute for Chemical Ecology, Germany, doi:10.7554/eLife.02245,
[ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4034684/ ],
[ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4034684/pdf/elife02245.pdf ]
*
Nate Seltenrich. « Estimated Deficiencies Resulting from Reduced Protein Content of Staple Foods: Taking the Cream out of the Crop? », Environ Health Perspect, 22 September 2017, DOI:10.1289/EHP2472,
[ https://ehp.niehs.nih.gov/ehp2472/ ],
[ https://ehp.niehs.nih.gov/wp-content/uploads/2017/09/EHP2472.alt_.pdf ]
*
Lewis H. Ziska, Jeffery S. Pettis, Joan Edwards, Jillian E. Hancock, Martha B. Tomecek, Andrew Clark, Jeffrey S. Dukes, Irakli Loladze, H. Wayne Polley. « Rising atmospheric CO2 is reducing the protein concentration of a floral pollen source essential for North American bees », 13 April 2016, DOI: 10.1098/rspb.2016.0414,
[ http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/283/1828/20160414 ],
[ http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/283/1828/20160414.full.pdf ]
*
Qi Deng, Dafeng Hui, Yiqi Luo, James Elser, Ying-Ping Wang, Irakli Loladze, Quanfa Zhang, Sam Dennis. « Down-regulation of tissue N:P ratios in terrestrial plants by elevated CO2 », 1 December 2015, DOI: 10.1890/15-0217.1,
[ http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1890/15-0217.1/full ],
*
Justin M. Mcgrath, David B. Lobell. « Reduction of transpiration and altered nutrient allocation contribute to nutrient decline of crops grown in elevated CO2 concentrations », Plant, Cell and Environment, Volume 36, Issue 3, March 2013, pages 697–705, Willey, DOI: 10.1111/pce.12007,
[ http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pce.12007/full ],
[ http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pce.12007/epdf ]
L’économie monétaire, un système déficient, incompatible avec l’environnement biophysique
Une excellente analyse de Jean-Marc Jancovici sur le fonctionnement de l’économie monétaire. Une lecture claire pour comprendre pourquoi ce système est déficient. Jean-Marc Jancovici est ingénieur conseil en énergie et en climat, cofondateur de Carbone 4 et des Entretiens deCombloux, président du think tank The Shift Project, auteur et concepteur initial du bilan carbone de l’ADEME, enseignant, conférencier et chroniqueur indépendant.
https://jancovici.com/transition-energetique/choix-de-societe/leconomie-peut-elle-decroitre/
L’économie peut-elle décroître ? • Jean-Marc Jancovici
Question stupide, votre honneur : évidemment que non, l’économie ne peut pas décroître. Sauf à l’occasion d’épisodes aussi brefs qu’indésirables, la vocation de l’économie, c’est de croître, et en général nous croissons bel et bien, non mais sans blague !
Lire la suite ici : https://jancovici.com/transition-energetique/choix-de-societe/leconomie-peut-elle-decroitre/
Un autre système économique et social doit être mis en place
Depuis 2014, l’IRASD effectue des recherches sur l’Antropocène ce qui nous a mené à trouver dans la littérature scientifique de nombreuses références d’études concernant les troubles comportementaux induits par le concept d’argent et ses mécanismes de l’économie monétaire et de la finance. Déni de la réalité factuelle, dissonances cognitives, biais cognitifs, heuristique de jugement, décisions, croyances et jugements erronés sont les pires stratégies comportementales déviantes de l’humanité responsables des dommages irréversibles comme les changements climatiques, la pollution, la surexploitation des ressources humaines et naturelles.
Un article porteur qui va dans le sens des hypothèses ouvertes par l’IRASD sur ces sujets de recherche. Les solutions viables adaptées aux comportements humains demeurent toutefois à élaborer.
Jour du dépassement «Il faut inventer un monde de post-croissance» – Interview de Philippe Bihouix – 01/08/2017
Libération, le 1er aout 2017 : http://www.liberation.fr/planete/20… Pour l’ingénieur Philippe Bihouix, la croissance n’est plus souhaitable. Un autre système économique et social doit être mis en place pour impulser la transition écologique. Philippe Bihouix est ingénieur et auteur de l’Age des low tech, vers une civilisation techniquement soutenable, aux éditions du Seuil. Le jour du dépassement arrive chaque année un peu plus tôt. N’a-t-on pas déjà atteint un point de non-retour ?
Le point de non-retour a déjà été franchi dans plusieurs domaines. Le problème, c’est que nous ne mesurons pas l’ampleur de la catastrophe. C’est le syndrome du décalage du point de référence (ou shifting baselines), théorisé par le biologiste Daniel Pauly. Nous échouons à transmettre d’une génération à l’autre la dégradation de notre environnement, la perte de biodiversité. Mon fils s’extasie quand il voit une grenouille, grenouille que je pouvais encore disséquer en cours de science naturelle, quand mon père, lui, en voyait des centaines. La dégradation de la planète peut encore s’accentuer, via l’exploitation des ressources. Nous pouvons continuer à aller chercher du pétrole, du gaz naturel ou des minerais, moins concentrés et moins accessibles, avec des rendements inférieurs et des conséquences environnementales accrues. La question subsidiaire étant : peut-on inverser la vapeur ? La bonne nouvelle, c’est que nous avons une forte capacité d’adaptation et d’innovation. Mais comment orienter cette incroyable capacité à inventer dans le bon sens et à la bonne vitesse ?
Les innovations et la haute technologie peuvent-elles nous sauver ?
Il y a de nombreuses promesses technologiques. Le problème, c’est que le numérique nous a donné l’impression que les hautes technologies pouvaient nous sauver. Or, nous ne pouvons pas réaliser dans le monde physique les progrès phénoménaux que nous avons connus avec le numérique. Nous nous heurtons d’abord à la question des ressources non renouvelables, de certains métaux comme le néodyme pour les éoliennes ou le lithium dans les voitures électriques. Et puis il y a une seconde contrainte, celle liée à la vitesse de généralisation. On espère ainsi que toute nouvelle technologie va pouvoir être déployée à l’échelle planétaire sur une période de dix ou vingt ans, de la même manière que les réseaux internet. Là encore, c’est un très mauvais calcul. On peut rajouter un macrosystème technique sur un autre, en installant par exemple des antennes pour créer un réseau internet sur un réseau électrique et de transport déjà existant. Et ça fonctionne. Mais quand il s’agit de remplacer un macrosystème par un autre, par exemple de remplacer le moteur thermique par un électrique, on se heurte là à la capacité industrielle de déploiement du réseau énergétique nécessaire.
L’économie collaborative paraît être une bonne solution pour diminuer notre consommation…
Oui, mais elle produit un effet pervers appelé «l’effet rebond». Si trois passagers relient Paris à Strasbourg en covoiturage par exemple, on est tenté de dire que l’on divise par trois la quantité consommée de carburant. Mais dans cette voiture, il y a qui ? Un étudiant qui a saisi l’opportunité de faire Paris-Strasbourg pour aller voir un copain et qui n’aurait pas forcément fait le trajet si le service n’avait pas existé. On a une autre personne qui aurait pris le train mais a préféré la voiture parce que c’était moins cher et c’est difficile de lui en vouloir. Le chauffeur, lui, fait Paris-Strasbourg plus souvent parce que la contribution économique des deux autres lui permet de payer le péage et le carburant. A l’échelle du pays, la consommation de carburant ne baisse pas.
Finalement, sans sobriété, il n’existe pas de solution technologique ?
La croissance n’est plus possible. Elle ne reviendra pas à la hauteur des fantasmes de nos dirigeants. Et elle n’est pas souhaitable, puisqu’on ne sait pas à la fois diviser nos émissions de gaz à effet de serre par quatre et faire de la croissance. La décroissance, ce n’est pas la caricature de l’inverse de la croissance. Mais une volonté de décroître en termes de consommation d’énergie, de matières premières et de production de déchets. D’inventer un autre système économique, social, fiscal, culturel, un monde de post-croissance de plein-emploi, plutôt que continuer à croire au miracle de l’ouragan schumpetérien de la destruction créatrice – alors que toujours plus de gens perdent leur travail.
Comment faire ?
Il n’y a pas d’un côté le décroissant qui fait ses confitures et son compost, et de l’autre l’espoir d’une organisation mondiale de l’environnement. Entre les deux, il y a une gamme incroyable d’actions possibles, au niveau territorial et surtout national, qui permettraient de donner une vraie impulsion à une réelle transition énergétique et écologique.
Comment expliquer le manque d’actions malgré l’urgence ?
On est dans l’injonction contradictoire permanente, dans la dissonance cognitive : d’un côté les mauvaises annonces sur la dégradation de l’état de la planète ; de l’autre des annonces de solutions miracles. Nos dirigeants sont dans une rivalité mimétique – Nantes a un «fablab», Rennes veut le sien – et tentent toujours les vieilles recettes néokeynésiennes : les grands travaux et la relance de la consommation créent les emplois. Cela a bien fonctionné pendant les Trente Glorieuses. Mais désormais la consommation de produits manufacturés ailleurs crée moins d’emplois. Reste alors la politique de grands travaux : il faut faire des aéroports, des LGV, etc. Cela donne des éléphants blancs, qui sont des aberrations dans la forêt économique et environnementale.
Estelle Pattée
L’Antropocène et ses causes, l’oeuf et la poule!
La cognition irrationnelle humaine est le fruit de l’évolution génétique de l’espèce qui a permis sa survie par adaptation aux conditions environnementales biophysiques.
Les causes de l’Anthropocène n’ont pas de liens directs avec la surpopulation, mais avec les stratégies comportementales irrationnelles individuelles et collectives, adoptées par adaptation à l’environnement social, suite à des choix erronés de société commis au fil de l’histoire humaine.
D’une part, ces comportements favorisent des activités qui laissent des traces indélébiles dans l’atmosphère et la géosphère, traces qui seront identifiables dans les futures couches géologiques au cours des prochains millions d’années. D’autre part, ces comportements contribuent à déstabiliser les équilibres de l’environnement biophysique soutenant la vie, qui à son tour va déstabiliser les équilibres des environnements humain et social.
La nature des activités humaines, principalement industrielles, découlent elles-mêmes de l’architecture conceptuelle et fonctionnelle déficiente des sociétés et de la civilisation, qui a mené à l’adaptation des stratégies comportementales de l’espèce humaine pour survivre dans les environnements biophysique et social.
Les concepts et mécanismes choisis instinctivement par l’homme depuis le début de la préhistoire jusqu’au début de l’ère industrielle ont été guidés par la cognition génétiquement irrationnelle de l’espèce humaine, par des idéologies et philosophies erronées, par des carences en connaissances scientifiques, par l’absence d’intégration de ces connaissances rationnelles aux comportements irrationnels et par des changements qui ont modelé continuellement la société, provoquant l’adoption de stratégies comportementales adaptées à la survie en société.
Tant que l’humanité a vécu en symbiose relative avec l’environnement biophysique, il n’y a pas eu trop d’impacts significatifs durant les premiers millions d’années de l’évolution. Il n’est donc pas question d’Anthropocène, puisque les traces sont insignifiantes et négligeables en ne contribuent pas à modifier l’environnement biophysique.
Mais les choix instinctifs que l’homme a faits pour s’organiser en société depuis 100 000 ans ont été ajustés au fil des siècles pour répondre aux nouvelles considérations d’organisations sociales et de changements de stratégies comportementales adoptées qui s’en sont suivies. Elles sont principalement conséquentes aux comportements politiques des décideurs à la tête des nations, des états, modulés par de nouvelles acquisitions de connaissances traitées de manière irrationnelle, ainsi que par la dérive d’idéologies erronées ignorant les réalités factuelles de l’environnement biophysique par carences de connaissances scientifiques et par préséance des comportements cognitifs irrationnels.
Durant la préhistoire, les sociétés ont été guidées par des croyances très connectées aux phénomènes naturels de l’environnement biophysique, ce qui a donné lieu à un respect des forces de la nature – ses lois immuables et intransgressibles – et à une connaissance de base de son fonctionnement, permettant une adaptation suffisante pour assurer la survie et le maintient ou la croissance très lente des populations sans toutefois avoir d’impacts négatifs irréversibles sur l’environnement.
Au néolithique, il y a 10 000 ans, le passage d’un mode de vie « chasseur-cueilleur nomade » au mode de vie « agriculteur sédentaire » a nécessité la mise en place graduelle du concept social de monnaie pour favoriser les échanges de denrées entre les individus de la société. L’invention de la monnaie a favorisé une profonde métamorphose des stratégies comportementales qui se sont mises à dévier radicalement des anciennes en se déconnectant de plus en plus de l’environnement biophysique. L’homme, plutôt que de dépendre de la nature, s’est mis à l’exploiter!
Durant l’antiquité, les sociétés ont été assujetties à des religions mono et poly théistes de plus en plus déconnectées de la nature, avec la complexification des sociétés, pour se connecter sur l’homme et ses comportements sociaux. De nombreuses connaissances de base en sciences sont apparues durant cette période, accompagnées d’idéologies philosophiques relativement rationnelles, possiblement parce que la complexité des sociétés n’influençait pas encore trop les penseurs qui étaient souvent en même temps les découvreurs des sciences.
L’antiquité n’a toutefois pas pu être une période stable de l’histoire de l’humanité parce que le concept erroné d’argent, basé sur la notion irrationnelle de valeur, a favorisé l’adoption de stratégies comportementales déviantes d’exploitation des humains sous forme d’esclavage et d’envahissement de territoires par des guerres, toutes justifiées par des comportements voués à alimenter la croissance de la richesse et la puissance des états. Puissance et richesse étant des notions irrationnelles purement d’origine cognitive humaine tout en étant couplées à la génétique comportementale par les restes préhistoriques de l’instinct de survie.
Au moyen âge, les religions et les croyances ont pris le dessus sur les sociétés pour favoriser l’adoption de stratégies comportementales profondément irrationnelles pendant que les sociétés s’organisaient autour de fortes dépendances à l’état très fragmenté en groupuscules féodaux. Les guerres et conflits pour la richesse ont continué à se multiplier parmi les comportements adoptés parce que les conditions de vie et même de survie étaient loin d’être stables. La croissance des populations et l’absence d’hygiène favorisaient les maladies qui contribuaient à l’adoption de ces stratégies comportementales. Durant cette période, la fracture avec la nature s’accentue au point que l’espèce humaine adopte de plus en plus de comportements orientés vers l’environnement social.
À partir des années 1600-1800, bon nombre de philosophies erronées ont été émises en ignorant totalement les mécanismes les lois naturelles de l’espèce humaine et de l’environnement biophysique parce que les sciences, bien qu’en forte multiplication des découvertes, n’ont pas pu favoriser l’intégration des connaissances factuelles de la réalité avec les pensées philosophiques déconnectées de ces dernières. Les croyances erronées et irrationnelles issues des courants religieux ont également contribué à empêcher l’adoption des connaissances scientifiques par leur réfutation, stratégie comportementale irrationnelle typique.
Lors de l’entrée dans l’ère industrielle, les comportements décisionnels structurants pour la société se sont appuyés sur ces philosophies erronées pour accélérer la progression technique, technologique et même scientifique, basée sur les connaissances des plus récentes découvertes, afin d’exploiter au maximum l’environnement biophysique au bénéfice de la croissance de l’environnement social, principalement l’économie. On assiste à une exacerbation de l’exploitation sous toutes ses formes de l’environnement biophysique au bénéfice du développement des concepts erronés d’argent avec ses mécanismes de l’économie.
Ceci a eu pour conséquence, une croissance exponentielle des techniques, des technologies, de l’économie, de la population et des impacts sur les équilibres entre les environnements biophysique, humain et social. Non seulement l’homme en a été transformé dans son individualité, sa collectivité et ses comportements – adaptation à cette nouvelle société offrant tant de possibilités –, mais la société aussi a été en pleine mutation totalement déconnectée de la réalité biophysique grâce à des idéologies politiques erronées basées sur des philosophies toutes aussi erronées comme celles de Descartes.
Durant toute cette période, la civilisation déstabilisait dangereusement les équilibres de l’environnement biophysique au point de provoquer suffisamment de pollution pour que de nouvelles maladies et troubles de santé apparaissent provoquant des décès par l’utilisation abusive et irraisonnée du charbon qui a précédé les hydrocarbures. Pourtant, on découvrait, à la même époque, les impacts du gaz carbonique sur le climat! Ce qui démontre à quel point l’adaptation des stratégies comportementales déviantes déconnectées des lois immuables et intransgressibles de la nature a prédominé tout au long de l’histoire depuis le néolithique. C’est aussi durant la période industrielle que débute l’Anthropocène.
Depuis l’époque contemporaine, d’autres conséquences des comportements déviants en croissance ont provoqué les deux grandes guerres mondiales. Elles ont été des conséquences de comportements déviants liés au concept erroné d’argent avec ses mécanismes de l’économie. Ces deux grandes guerres ont également favorisé l’explosion de nouvelles technologies qui se sont répandues rapidement dans la civilisation, comme l’automobile avec le pétrole et le nucléaire. Ces technologies, avec la croissance du développement économique et industriel, ont de plus en plus d’impacts sur l’environnement biophysique.
La prise de conscience par l’espèce humaine de ses impacts sur la planète depuis le début du siècle a mené à des réflexions collectives sur le développement qui ont produit la notion de « développement durable ».
Mais cette notion est elle-même erronée en intégrant l’économie comme un pôle du système en tentant d’établir un équilibre avec l’environnement et l’acceptabilité sociale. L’économie étant une composante de la société et non la société elle-même, le modèle de développement durable est conceptuellement déséquilibré et inapplicable. C’est d’ailleurs ce qui a provoqué tous les échecs politiques de tentatives de moderniser la société afin de mettre en application les principes du développement durable.
Un modèle équilibré de développement durable ferait plutôt intervenir un équilibre entre les environnements biophysique, humain et social. Un tel modèle favoriserait une mise en application des principes de développement durable. Il imposerait également des adaptations des stratégies comportementales menant à des activités humaines et à des choix technologiques plus durables et renouvelables.
Aujourd’hui, l’espèce humaine est aux prises avec une société qui, bien qu’elle présente peu de guerres, n’est pas moins exempte de violence et de menaces constantes liées aux stratégies comportementales déviantes des pouvoirs politiques liés au concept erroné d’argent. L’organisation étatique actuelle favorise exclusivement le développement de l’économie monétaire appuyée sur les idéologies gravement erronées du capitalisme et du néolibéralisme.
Cette société est responsable de l’adoption de stratégies comportementales profondément déviantes et de technologies dommageables qui déstabilisent de plus en plus profondément les équilibres de l’environnement biophysique au point de détruire la biodiversité et de mettre à risque la survie même de l’espèce humaine.
Le non respect des lois immuables et intransgressibles de l’environnement biophysique sont favorisés par ces idéologies erronées. L’interaction avec la nature humaine génétiquement irrationnelle des concepts et mécanismes erronés de notre société favorise l’adoption de stratégies comportementales déviantes qui sont toutefois adaptées à notre survie dans ce modèle d’environnement de société.
L’Anthropocène c’est tout cela à la fois! Pour s’en sortir, l’humanité ne pourra pas se contenter d’idéologies déconnectées des sciences ni de comportements approximatifs et irrationnels! Elle va devoir trouver les moyens d’accroître et de généraliser à toute la population d’individus de l’espèce la prise de conscience de cette situation.
Les obstacles psychologiques et neurocognitifs à surmonter sont non seulement politiques, économiques, idéologiques et culturels, mais également génétiques!
On aborde de plus en plus couramment la collapsologie dans les groupes qui réfléchissent à l’Anthropocène. À un tel point que la communauté scientifique elle-même est en train d’adopter un quasi-consensus d’une possible extinction de l’espèce humaine au cours des prochains siècles.
Cette extinction serait provoquée par la déstabilisation des conditions environnementales qui renieraient la vie humaine difficile, sinon impossible. Cette extinction qui, selon certains scientifiques, pourrait ne pas être complète serait toutefois massive. Elle serait précédée par l’effondrement de notre civilisation engendrée par l’impossibilité de la maintenir fonctionnelle parce qu’elle sera elle-même déstabilisée par les nouvelles conditions biophysiques. En bref, l’espèce humaine risque fort bien de ne pas pouvoir s’adapter aux nouvelles conditions environnementales qu’elle est en train de provoquer ni d’adapter sa société pour y faire face.
Si l’irrationnel génétique de la cognition humaine a pu favoriser la survie de l’espèce, l’évolution de sa capacité cognitive ne pêche toutefois pas la réflexion rationnelle et objective. Toutefois, l’espèce humaine n’est pas instinctivement rationnelle et objective. Le cerveau humain ne fonctionne pas ainsi tel que le démontre les neurosciences cognitives. De plus, les limitations sensorielles de l’humain nécessitent des outils technologiques afin de mesurer le réel factuel pour en tenir compte.
Il faut une forte volonté consciente et soutenue pour adopter une cognition rationnelle et objective. Elle ne peut être maintenue ni entretenue sans une acquisition généralisée, importante et continue de connaissances scientifiques qui doivent être appliquées à toutes les stratégies comportementales et décisionnelles individuelles et collectives afin de tenir compte d’un maximum d’impacts des comportements et des choix de société sur les environnements biophysique, humain et social.
Un tel changement de stratégies comportementales n’est possible que si des modifications profondes à notre environnement social en provoquent l’adoption. Le hasard de la cognition irrationnelle ne peut favoriser une telle situation suffisamment rapidement pour assurer une sortie de l’Anthropocène. Exactement comme le hasard de la sélection naturelle, circonscrite aux probabilités des combinaisons génétiques viables, exige du temps dont l’espèce ne dispose plus parce que les changements sont trop rapides et vont s’accélérer tant que les comportements et activités ne changeront pas.
Depuis l’apparition de la vie sur Terre, ses différentes formes ont survécu parce qu’elles ont pu s’adapter aux changements lents et progressifs. Les activités humaines provoquent des changements rapides et soudains. La génétique ne supporte pas cette rapidité! Il n’est donc pas raisonnablement possible d’envisager que la vie puisse réussir à s’adapter dans de telles conditions de changements rapides. D’ailleurs, l’histoire géologique de la planète est jonchée de traces d’extinctions massives qui ont été provoquées par des changements trop rapides.
Les sciences elles-mêmes démontrent qu’aucune technologie ne peut être envisagée pour accélérer l’adaptation qui est assujettie aux lois immuables et intransgressibles de la nature. Par contre, nous pouvons à court terme adopter rapidement de nouvelles technologies qui peuvent réduire l’impact de la civilisation humaine sur les déséquilibres provoqués dans l’environnement biophysique.
Toutefois, il appert que les décisions politiques favorisant l’adoption rapide de ces nouvelles technologies ne sont pas du tout au rendez-vous parce que les stratégies comportementales déviantes influencées par les concepts et mécanismes erronés de l’argent et de l’économie ont préséance sur la raison rationnelle et objective.
Dans cette situation, tant qu’une architecture profondément différente de la société humaine actuelle ne sera pas conçue avec de nouveaux concepts et mécanismes permettant le respect des principes de développement durable avec un modèle équilibré, il sera impossible d’atteindre une pérennité du système.
Une nouvelle architecture de société doit pouvoir provoquer une adaptation qui favorisera l’adoption de stratégies comportementales compatibles avec le respect et le maintien des équilibres entre les lois immuables et intransgressibles de la nature, l’espèce humaine poursuivra sa course pour la croissance économique vers l’effondrement de sa civilisation qui accélérera son extinction.
Jamais, dans toute son histoire, l’humanité, n’a eu à faire face à une situation aussi risquée dont l’ampleur est proportionnelle aux impacts de sa civilisation avec ses stratégies comportementales déviantes qui ne sont que les symptômes de comportements irrationnels, d’erreurs conceptuelles, fonctionnelles et opérationnelles de l’environnement social au fil de l’évolution et de l’histoire de l’espèce.
Il est urgent de concevoir un nouveau modèle de société par une approche rationnelle et objective qui fait fit des philosophies et idéologies erronées pour se concentrer sur des philosophies et idéologies rationnelles et objectives intégrant réellement les connaissances scientifiques cumulées et confirmées récemment par consensus.
Si l’espèce humaine ne réussit pas à tenir compte de la réalité factuelle en délaissant ses comportements irrationnels, le risque d’échec grandira proportionnellement aux efforts pour maintenir la situation actuelle. Pour accomplir ce défi, l’humanité devra contribuer et collaborer aux recherches, au-delà de toutes ses limites et frontières politiques, économiques, idéologiques et culturelles, afin de constituer une compréhension globale et intégrée des causes de l’Anthropocène. Elle devra par la suite faire des choix drastiques pour l’organisation et le fonctionnement de la société. Ces choix ne pourront être approximatifs, ils devront être le résultat d’une architecture de société qui tiendra compte des connaissances, des causes, des impacts, des objectifs et des moyens à disposition afin de provoquer l’adoption de stratégies comportementales durables et pérennes.
L’IRASD a deux ans d’existence
L’IRASD a été mis en place en 2014 pour effectuer les recherches nécessaires à la compréhension profonde et élargie de la phénoménologie humaine et de son éthologie [1] responsables des symptômes actuels reflétés par la dégradation de la planète et l’accroissement des risques d’effondrement de la civilisation et d’extinction de l’espèce humaine.
Nous abordons tous les domaines de connaissances scientifiques pour compiler celles qui nous paraissent essentielles à la compréhension suffisante des causes inhérentes à la situation actuelle de l’humanité [2].
La finalité de ces recherches documentaires est de pouvoir exploiter ces connaissances pour architecturer de nouveaux concepts et mécanismes de société afin de mettre en place les changements requis à l’environnement social de manière à induire chez l’espèce humaine les adaptations comportementales nécessaires à la résolution de la situation pour assurer la pérennité renouvelable de la civilisation et la survie durable de l’espèce. Notre plan de travail s’échelonne sur quelques décennies.
Toutefois, les résultats de recherches cumulées jusqu’à maintenant tendent à démontrer que l’espèce humaine, malgré sa capacité cognitive et d’adaptation, ne semble pas posséder le potentiel évolué nécessaire pour intégrer toutes ces connaissances, généraliser les concepts et les mettre à profit de manière globale dans le but de réformer son modèle de civilisation.
Dans les faits c’est tout le contraire que nous observons au niveau comportemental : fragmentation et limitation des connaissances, spécialisation à outrance au détriment du généralisme, freinage excessif de l’innovation au profit de la croissance économique monétaire, érosion des compétences, accumulation de mauvaises décisions politiques et économiques favorisant l’aggravation accélérée de la situation, etc.
L’écopsychologie nous révèle qu’avec la prise de conscience de ces menaces, l’humain adopte des comportements nuisibles aux solutions et donc à sa survie. Déni, transfert de responsabilité, dissociation et dissonances cognitives sont autant de stratégies comportementales psychosociales observées chez les humains qui prennent conscience du problème environnemental et climatique dont ils participent activement à l’accélération, consciemment ou non [3] et dont l’ampleur dépasse largement leur capacité de compréhension et d’adaptation comportementale.
La « fuite par en avant » est surtout intérieure, psychologique et comportementale – donc réactionnelle, liée au refus d’accepter la souffrance inhérente à notre responsabilité pour la destruction de notre environnement biophysique compte tenu de l’ampleur de la problématique qui dépasse l’entendement individuel et collectif.
Dans ce contexte, pour les individus peu enclins à pouvoir acquérir et maîtriser objectivement les connaissances scientifiques, insister sur les faits ne fait qu’empirer les comportements et la situation.
L’IRASD participe à un groupe rassemblant plus de 2300 chercheurs de la société civile qui partagent des articles et réflexions sur la situation de l’espèce humaine en interaction avec ses environnements biophysique et social. On y échange sur les variables qui influencent et accélèrent l’effondrement de la civilisation et l’extinction de l’espèce humaine.
L’observation des sujets et des comportements dans ce groupe permet à l’IRASD d’estimer la capacité de stabilité psychologique de certains individus. Elle démontre qu’il est possible d’aborder en continu des sujets graves sans tomber dans les pièges comportementaux identifiés par l’écopsychologie.
Dans le scénario « business as usual » observé mondialement par les décisions politiques et industrielles, on ne peut estimer autre cible que l’effondrement d’ici quelques décennies et l’extinction d’ici un siècle. Ce qui suppose qu’il faudra non pas quelques décennies, mais plutôt quelques siècles pour faire évoluer les mentalités, les comportements et l’implication dans les recherches et l’architecture de société afin d’éviter ce qui devient clairement inéluctable de jour en jour.
Nous sommes conscients que le défaitisme n’aide en rien. Face aux changements environnementaux et climatiques qui menacent la survie de l’espèce humaine, il faut être proactif. Pour être proactifs, il faut prendre conscience du réel, cerner, définir et mesurer les externalités, se détacher de notre pensée irrationnelle humaine et transcender nos limitations cognitives en abandonnant nos croyances erronées.
« La vérité peut être déroutante. Un certain travail est nécessaire pour la maîtriser. Elle peut contredire profondément nos préjugés. Elle peut ne pas être conforme à ce que nous souhaitons désespérément être vrai. Mais nos préférences ne déterminent pas ce qui est vrai. » – Carl Sagan
Mais pour être proactif, il faut désormais être hyperactif! L’espèce humaine procrastine depuis des siècles. Elle ne dispose plus de suffisamment de temps pour avoir droit à l’erreur dans les changements gargantuesques qu’elle doit apporter à son environnement social et au fonctionnement de sa civilisation.
Ce qui signifie qu’il est urgent de démultiplier les efforts pour comprendre, documenter et éduquer sur la situation dans toutes ses ramifications de connaissances scientifiques, contribuer à la prise de conscience sociale pour accroître l’effet de levier des changements de comportements et d’implication dans la recherche de solutions afin de participer activement et humblement à l’architecture de société requise pour réformer le système le plus rapidement possible, mais surtout pas n’importe comment tel que l’espèce humaine le fait depuis le néolithique…
La neutralité et l’objectivité permettent d’atteindre un équilibre émotionnel entre la prise de conscience du drame avec son urgence d’agir et l’optimisme presque utopique d’un travail actif sur les solutions. Il faut être le plus conscient et compétent possible pour agir du premier coup en minimisant les erreurs de conception et de décision tout en demeurant saints d’esprit!
Nous sommes à l’heure de l’examen final et il n’y aura pas de reprise en cas d’échec. Si nous n’avons pas suffisamment étudié la situation, nos décisions risquent d’être encore erronées et de nous mener du côté sombre de la collapsologie plutôt que de l’espoir utopique de la survie.
Mais l’utopie, c’est aussi le possible dans l’impossible! [4]
L’espèce humaine possède toutes les connaissances pour facilement réaliser l’utopique. Est-elle suffisamment évoluée pour le faire?
[1] https://irasd.wordpress.com/
[2] https://irasd.wordpress.com/planification/plan-de-recherche/
[3] Pour en savoir plus sur les liens entre comportements psychosociaux et environnement : Michel Maxime Egger. « Soigner l’esprit, guérir la Terre – Introduction à l’écopsychologie », 2015, Labor et Fides, collection Fondations écologiques, Genève, 288 p.
[4] https://irasd.wordpress.com/dossiers/generaux/lutopie-le-possible-dans-limpossible/
L’innovation sociale : rénover la société avec un modèle périmé
« De façon simple, l’innovation sociale met en valeur des idées pour améliorer la société. Elle répond à des besoins liés, notamment, au travail, à la santé, à l’éducation et aux communautés. »
Le centre d’innovation sociale « conseillera les usagers dans différents domaines : comptabilité, droit, mentorat, technologie, etc. »
L’innovation sociale, malgré son nom, ne constitue en fait aucune forme d’innovation que ce soit. L’innovation sociale se contente de trouver des activités d’économie sociale tout en réutilisant les concepts et mécanismes établis à la base du fonctionnement de la société humaine. Or l’économie de la société s’appuie sur le concept erroné d’argent responsable de dommages considérables aux environnements humain, social et biophysique. Le minime apport de l’innovation social se bornera à générer un peu d’activité communautaire.
La première erreur de ce projet d’incubateur d’innovation sociale est qu’il sera financé! Ce qui implique que le projet devra rapporter aux investisseurs d’abord, directement ou indirectement et qu’il pourra rapporter à la société ensuite, généralement encore financièrement. Or, tel est le cercle vicieux actuel de la civilisation humaine : tout doit être rentable et rapporter de l’argent, mais ne respecte aucunement les lois immuables intransgressibles de la nature… La conséquence est qu’aucun développement n’est durable ni renouvelable!
« L’économie sociale emploie 150 000 personnes au Québec. Elle compte 7000 entreprises, composées de coopératives et d’OBNL. […] Ensemble, elles génèrent pour plus de 35 milliards de dollars, soit l’équivalent de 10 % du PIB du Québec. »
L’économie sociale vise donc d’abord et avant tout le développement de l’économie monétaire en utilisant le développement de services comme levier. Elle n’est donc qu’une nouvelle manière d’exploiter un filon de la société afin de générer des revenus et de la rentabilité monétaire et non de la véritable innovation sociale vouée au développement durable des individus et de la collectivité.
Or, l’économie monétaire est la principale responsable des problèmes humains, sociaux et environnementaux! Encourager son développement contribue à accentuer les problèmes et à accélérer l’effondrement de la civilisation et l’extinction de l’espèce.
L’impact psychosocial de l’argent sur le comportement humain est largement documenté [1]. Connaissant les conséquences sur la société, l’humain et l’environnement biophysique, il est inacceptable d’imaginer que de l’innovation sociale puisse encore se faire avec le concept erroné d’argent!
Quant aux lois sociales, la plupart sont basées sur des philosophies erronées résultant de la capacité cognitive irrationnelle du cerveau humain. Ces philosophies prétendent que les ressources humaines et naturelles existent pour être exploitées à l’infini afin de créer de la richesse monétaire. Sachant que ces ressources sont physiquement limitées et qu’elles sont exploitées plus vite que leur taux de renouvellement, leur exploitation ne peut pas être durable ni renouvelable. Au contraire, elle est dommageable!
En conséquence, les lois ne permettent que de soutenir et d’entretenir des comportements déviants et des décisions erronées dont les impacts sociaux, humains et environnementaux accélèrent l’effondrement de la civilisation par la surexploitation des ressources humaines et naturelles.
Contrairement à l’architecture de société, qui vise à concevoir de nouveaux concepts et mécanismes permettant à l’humain d’évoluer en société de manière durable avec ses environnements, l’innovation sociale ne fait que reprendre les concepts établis en tentant de renouveler ce qui ne fonctionne pas dans la société. Cela équivaut à tenter de rénover avec des matériaux périmés!
La véritable innovation sociale ne répète pas les erreurs du passé de l’humanité et ne s’appuie pas sur les concepts actuels de société qui sont la cause de sa déchéance.
« On ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont engendrés. »
– Albert Einstein
La véritable innovation sociale s’appuie sur les principes de l’architecture de société, qui elle-même utilise la démarche et les connaissances scientifiques de tous les domaines cumulées par l’espèce humaine afin d’expliquer les problématiques induites par les concepts et mécanismes actuels de la société et extrapoler les enjeux et les risques de nouveaux concepts et mécanismes de société durable.
« Tant qu’on n’aura pas diffusé très largement à travers les hommes de cette planète la façon dont fonctionne leur cerveau, la façon dont ils l’utilisent et tant que l’on n’aura pas dit que jusqu’ici cela a toujours été pour dominer l’autre, il y a peu de chance qu’il y ait quoi que ce soit qui change. »
— Henri Laborit, Mon oncle d’Amérique
Ce projet d’incubateur d’innovation sociale n’est donc qu’un symptôme de dissonance cognitive. Il ne produira aucune innovation permettant d’éviter l’effondrement de la civilisation ou l’extinction de l’espèce humaine. À moins qu’il puisse financer des activités d’architecture de société. Ce qui constituerait un risque élevé de corruption comportementale en associant ses activités au concept erroné d’argent…
[1] Kathleen D. Vohs et al. The Psychological Consequences of Money, Science 314, 1154 (2006), [http://science.sciencemag.org/content/314/5802/1154]
Stephen E. G. Lea and Paul Webley. Money as tool, money as drug: The biological psychology of a strong incentive, Behavioral and Brain Sciences / Volume 29 / Issue 02 / April 2006, pp 161- 209, [http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=420982&fileId=S0140525X06009046]
Srinivas Durvasula, Steven Lysonski. Money, money, money – how do attitudes toward money impact vanity and materialism? – the case of young Chinese consumers, Journal of Consumer Marketing Volume 27, Issue 2, [http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/07363761011027268]
Paul K. Piffa, Daniel M. Stancatoa, Stéphane Côté, Rodolfo Mendoza-Dentona, and Dacher Keltnera. Higher social class predicts increased unethical behavior, PNAS, March 13, 2012 vol. 109 no. 11, [http://www.pnas.org/content/109/11/4086.abstract?sid=4ba330da-a740-43b9-bfa4-43d357e496dc]
***
http://plus.lapresse.ca/screens/a520ff24-f249-42fe-88e3-4e87b4cc02e3%7C_0.html
ÉCONOMIE SOCIALE
Une Maison d’innovation sociale à Montréal
RÉJEAN BOURDEAU
LA PRESSE
De grands partenaires s’apprêtent à lancer une Maison d’innovation sociale à Montréal, a appris La Presse.
L’annonce se fera, en présence du maire Denis Coderre, lors du Forum mondial en économie sociale, qui se tiendra dans la métropole du 7 au 9 septembre. On y accueillera quelque 1400 participants provenant de plus de 50 pays et de 400 villes.
La Fondation Mirella & Lino Saputo et celle de la famille J.W. McConnell, l’Université Concordia, HEC Montréal et le Chantier de l’économie sociale participeront, selon nos informations, à la création de la Maison d’innovation sociale. Les ordres de gouvernement fédéral, provincial et municipal sont aussi impliqués dans ce projet original évalué à plus de 10 millions.
CONCEPT UNIQUE
Ce type d’établissement existe déjà dans certaines villes, dont Toronto. Mais Montréal se distinguera par la nature de ses activités, indiquent des sources.
Ainsi, la Maison n’offrira pas d’espaces collaboratifs pour les travailleurs autonomes. Son but n’est pas de concurrencer des firmes spécialisées dans la location d’espaces de travail partagé. Ni dans d’autres domaines. Elle rassemblera plutôt les compétences présentes dans l’écosystème pour développer des projets d’innovation sociale. On y déploiera des expertises pour « passer de l’idée à l’impact ».
De façon simple, l’innovation sociale met en valeur des idées pour améliorer la société. Elle répond à des besoins liés, notamment, au travail, à la santé, à l’éducation et aux communautés.
SOUTENIR ET PROPULSER
La nouvelle initiative s’adressera aux citoyens et aux entrepreneurs collectifs (coopératives et OBNL) et privés. De même qu’aux forces intellectuelles, technologiques, étudiantes et financières. Elle gardera aussi une présence significative à l’extérieur de Montréal, grâce à des antennes régionales.
Plusieurs services seront offerts aux utilisateurs. D’abord, un centre de référencement et d’expertise accompagnera et conseillera les usagers dans différents domaines : comptabilité, droit, mentorat, technologie, etc.
Ensuite, il y aura un générateur d’innovation sociale. Des experts de tous les horizons proposeront des pistes créatives en innovation ouverte, fondées sur le partage et la collaboration.
Enfin, un laboratoire de recherche offrira des cours, des stages et des recherches appliquées.
La Maison est le fruit d’un projet-pilote mené de novembre 2015 à mars dernier. Il s’adressait à sept entreprises d’économie sociale de Montréal et de l’Outaouais.
La Maison d’innovation sociale ouvrirait ses portes dans la prochaine année, selon nos sources. Le projet avance bien, mais des détails restent à négocier.
FORUM MONDIAL
Le Forum mondial de l’économie sociale, ou GSEF 2016, est organisé par la Ville de Montréal et le Chantier de l’économie sociale, un organisme voué à la promotion de l’entrepreneuriat collectif dans les coopératives et les organismes à but non lucratif (OBNL).
Il s’agit de la troisième édition de cette conférence internationale, née à Séoul, en Corée du Sud, en 2013. Cette année, le thème central porte sur la collaboration entre les gouvernements locaux et les acteurs de l’économie sociale et solidaire pour le développement des villes. Plus de 30 ateliers, des possibilités de réseautage et des visites de terrain à Montréal et en région seront offerts.
L’économie sociale emploie 150 000 personnes au Québec. Elle compte 7000 entreprises, composées de coopératives et d’OBNL. Elles sont présentes dans les secteurs économique, social et culturel. Ensemble, elles génèrent pour plus de 35 milliards de dollars, soit l’équivalent de 10 % du PIB du Québec.
Comportements réels adaptés à un environnement irréel
Voici une observation intéressante qui démontre clairement la capacité d’adaptation humaine à ses environnements. Dans le cas précis, il s’agit d’adaptation à l’environnement social virtualisé par les outils informatiques des réseaux sociaux.
Dans cet exemple, l’humain adopte des comportements réels adaptés à un environnement irréel. Ces comportements ne seraient probablement pas adoptés dans un environnement social réel, ils ne seraient pas les mêmes.
Il ne subsiste donc aucun obstacle théorique permettant de démontrer que l’humain puisse adapter ses comportements à des concepts et mécanismes de société réels mais erronés…
Lorsque les comportements commencent à mettre à risque la capacité de survie de l’espèce en déstabilisant les équilibres nécessaires à l’intégrité de l’espèce ou au maintient de l’environnement biophysique qui soutiennent la vie, on parle de comportements déviants.
Lorsque le jeu se prolonge, y a-t-il une probabilité de transposition des comportements du monde irréel vers le monde réel? Y a-t-il probabilité de reporter des stratégies comportementales adaptées à des concepts erronés dans un environnement naturel? Les réponses semblent bien évidemment affirmatives.
Plus de recherches sont nécessaires à ce stade afin de déterminer le taux de rétention et la capacité de discernement d’un environnement a un autre.
.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/473256/papa-maman-facebook-et-moi
Papa, maman, Facebook et moi
redaction (Julie Rambal)
« Nous créons du contenu familial chaleureux et avons plus de 15millions defollowers sur le Web, et des milliards de vues. Notre but est de nous amuser et de faire sourire autant de monde que possible», annonce fièrement l’« Eh Bee Family » sur son site. Dans cette tribu youtubeuse américaine, il y a Andres, le père de 38 ans, celui qui tient toujours le téléphone intelligent, « Maman Bee », 36 ans, et leurs deux enfants, surnommés « Monsieur Singe », 9 ans, et « Mademoiselle Singe », 11 ans. Des petits singes savants ? Presque. Car chaque vidéo des Bee tient du zoo intime.
Dans celle postée le 17 février 2016, et intitulée « Concours de danse surprise » (256 206 vues), on peut voir Monsieur Singe se faire couper les cheveux, Mademoiselle Singe chez la pédicure, Maman Bee à la gym, avant une chorégraphie improvisée dans le salon. Chaque séquence est copieusement commentée par le géniteur des prétendus primates. Son fils a obtenu une sucette chez le coiffeur ? Débauche de « Wouaah ! » paternels. Il tarde à réagir quand le mobile est braqué sur lui ? «Parle! Dis quelque chose!» L’oeuvre étant destinée à la postérité numérique, les Bee semblent avoir cessé de se regarder. Même lorsqu’ils se parlent, leurs yeux restent braqués vers le téléphone qui alimente en continu Facebook, Instagram, Twitter, Vine et Snapchat. Des efforts payants : le petit zoo intime est aujourd’hui commandité par Disney, Pepsi, Samsung, Nestlé…
Téléréalité domestique
Ces vlogues (blogues vidéo) familiaux, façon téléréalité domestique, sont majoritairement américains et existent par centaines sur YouTube. Les plus connus sont les « Shaytards » et leurs cinq enfants, « Ellie et Jared », deux garçons en bas âge, et Judy Travis, dont la seule vidéo d’accouchement en direct a eu 17 266 619 vues.
Bien sûr, l’exhibition de descendance n’est pas toujours aussi sophistiquée. C’est parfois une simple photo qui fait la fierté parentale, postée ici et là. Et qui vient gonfler les statistiques : le Wall Street Journal estime qu’à 5 ans, un enfant a déjà 1000 portraits sur Internet. Ce phénomène a gagné son nom : le «sharenting», contraction de «share» (partager) et «parenting» (parentalité). «Le basculement s’est fait avec l’accès aux abonnements illimités, constate Catherine Lejealle, sociologue du numérique. Une quasi-gratuité qui a bouleversé la manière dont chacun documente son quotidien, du plat qu’il mange à sa toilette dans la salle de bain. Autrefois, la photo était une mise en scène des grandes occasions: mariage, baptême, anniversaire. Aujourd’hui, chaque seconde est mise en scène, et n’a de valeur que partagée. Nous sommes dans l’ère de l’euphorie du partage d’existence.» Et dans l’extimité triomphante, une intimité entièrement tournée vers le dehors. «Longtemps, nous avons cru que Big Brother serait une puissance totalitaire. Finalement, chacun accepte d’être son propre bourreau. Et montrer ses enfants devient un élément majeur de cette réalisation de soi dans une existence où le travail n’est plus épanouissant, où les couples éclatent souvent…»
Le « kid shaming » sur Instagram
En 2014, on estimait à 1,8 milliard les photos mises en partage dans le cosmos 2.0. En 2016, grâce à la prolifération des applications sociales, plus de 100 milliards de clichés seront partagés, selon le site Coupofy. Bref, toujours plus d’égoportraits, de clichés de plats sur le point d’être ingérés… et d’enfants. Le sharenting possède même ses sous-genres narratifs : de la première échographie livrée sur Facebook aux millions de photos d’allaitement en libre accès sur Instagram, des petites demoiselles déguisées en princesses, entonnant une comptine sur Vine (une appli de vidéos de 6 secondes) aux jeunes turbulents qu’il devient courant de moquer, selon la nauséabonde tendance (américaine, encore) du «Kid Shaming», ou l’humiliation d’enfant.
Là, une fillette agrippe de ses doigts potelés la pancarte : «J’ai vomi dans mon nouveau siège enfant». Ici, un bébé dort avec une feuille posée sur son ventre précisant : «Je memets à hurler dès que maman s’assied pour dîner», tandis qu’une autre fillette de moins de 6 ans affiche : «Je peux mentir en regardant droit dans les yeux.»
«Embarqués dans le mouvement du virtuel, l’immédiateté du clic, beaucoup perdent toute faculté de jugement, constate la philosophe et psychanalyste Elsa Godart, auteure de Je selfie, donc je suis (Albin Michel). Or montrer ses enfants est dommageable dans la mesure où ils sont chosifiés, on s’approprie leur devenir, la possibilité pour eux de raconter leur propre histoire ultérieure.» Sans oublier que chaque portrait est désormais scanné par les algorithmes, et les applications permettant d’obtenir, à partir d’une simple photo, une biographie personnelle (anniversaire, adresse, goûts, mauvaises habitudes…) seront bientôt légion. «En communication, on dit déjà qu’une photo vaut mille mots, prévient Catherine Lejealle. Et même si la Cour européenne vient de valider le droit à l’effacement, c’est-à-dire la possibilité de réclamer à Google et autres de déréférencer une donnée embarrassante, on sait aujourd’hui qu’on n’efface rien. On peut seulement essayer de rendre une donnée moins visible. De toute façon, personne ne souhaite effacer ses traces. Tout le monde répond que construire son identité est un tel investissement, un tel travail pour exister, qu’il n’y a aucune raison de disparaître.»
Éduquer les parents
Au nom de la légende numérique parentale, les photos d’enfants continuent donc de proliférer. Stéphane Werly, le préposé cantonal à la Protection des données et à la transparence (PPDT) de Genève, constate : «Le fait d’être photographié est une atteinte au droit à l’image, et nous sommes d’ailleurs là pour vérifier qu’il n’existe aucune dérive… mais seulement dans le cadre scolaire. Nous pouvons prévenir les enseignants des risques de mettre en ligne des clichés d’enfants, réclamer des mots de passe, mais les parents ne relèvent pas de notre compétence. Il faudrait sûrement en éduquer quelques-uns. D’ailleurs, chaque individu est protégé par la loi: quiconque estime que sa personnalité est atteinte par une photo, un commentaire, peut saisir les tribunaux, et se retourner, même contre ses parents…»
C’est un signe, Facebook, multinationale qui gagne pourtant des milliards en exploitant chaque donnée personnelle, vient d’annoncer réfléchir à une notification d’alerte pour les personnes s’apprêtant à publier une photo d’enfant. La peur de l’inévitable retour de bâton ?
Consultations publiques sur le climat et le développement durable au Canada
Le gouvernement canadien consulte ses citoyens sur deux aspects importants et inextricablement indissociables même s’il semble avoir séparé les démarches : le climat [1] et le développement durable [2].
Ces consultations sont des occasions pseudodémocratiques pour les ONG environnementales, les regroupements sociaux et les citoyens de déposer des projets structurants pour les politiques, les législations, l’économie et toutes les orientations nationales, mais aussi à l’échelle internationale et locale.
L’IRASD s’est déjà positionnée sur les questions du climat [3] et continuera de le faire. Quant au développement durable, des travaux de recherche en architecture de société ont démontré que le modèle actuel est inutilisable.
Le modèle de développement durable, tel que défini et modulé par les états à partir du rapport Brundtland, est totalement déséquilibré. En effet, les trois pôles de ce modèle devant mener à un équilibre durable du développement sont actuellement l’environnement, le social et l’économie.
Ce modèle fait en sorte que les efforts ne misent que sur la durabilité du développement économique dont les concepts et mécanismes induisent des stratégies comportementales déviantes et des décisions erronées [4]. Les conséquences sont bien documentées scientifiquement : dégradation des équilibres nécessaire à l’intégrité des environnements [5].
Ces trois pôles ne correspondent pas du tout à la réalité. Un modèle équilibré devrait s’appuyer sur l’environnement biophysique, l’environnement humain et l’environnement social. L’équilibre entre ces trois pôles assure le fonctionnement durable du système.
Il ne s’agit toutefois plus essentiellement de développement économique, simple aspect fonctionnel de la société, mais d’équilibre durable pour assurer l’intégrité de l’environnement biophysique, le développement humain et le progrès social tout en assurant l’évolution du système sans dégradation.
À l’opposé, il est démontré à profusion que l’économie monétaire est un puissant vecteur de déséquilibres biophysiques, humains et sociaux. Le fait que l’humain accorde autant de préséance au développement de l’économie est considéré comme un comportement déviant parmi les stratégies comportementales de l’espèce [4].
On comprend mieux dès lors pourquoi aucune tentative sérieuse de la part des états n’a jamais abouti pour implémenter le développement durable avec des résultats significatifs. Dans le modèle Brundtland, l’aspect humain est confondu dans l’aspect social et l’aspect société n’est considéré que sur son volet économie monétaire.
Depuis 3 ans, l’IRASD travaille à documenter son modèle de développement durable qui s’appuie exclusivement sur des bases biophysiques, humaines et sociales. Notre dossier n’étant pas prêt, nous demeurons disponibles pour répondre aux questions.
Il n’en demeure pas moins primordial que les organisations, regroupements et citoyens participent activement et de manière éclairée à ces deux consultations du gouvernement canadien. Et cet éclairage nécessaire pour analyser ces problématiques de climat et de développement durable ne peut se faire en ignorant la recherche et l’analyse en sciences naturelles et sociales.
Le nombre d’aspects et de variables impliquées dans ces deux sujets est tel que sans intégration minimale des solutions aux environnements biophysique, humain et social, les solutions risquent d’accroître les problématiques plutôt que de les résoudre.
L’IRASD invite donc les participants à faire preuve d’esprit analytique, de neutralité, d’objectivité et à se documenter par des recherches afin d’éviter de s’impliquer trop superficiellement dans ces démarches de consultation.
Stéphane Brousseau – Directeur de recherche
B.Sc. Géologie
Analyste et architecte en technologies de l’information et des communications Chercheur en Anthropocène et architecture de société durable
[1] Climat : https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/action-pour-climat.html
[2] Développement durable : http://www.parlonsdurabilite.ca/intro
[3] Stéphane BROUSSEAU, Les émissions de GES des sables bitumineux. – Contribution du Canada et du Québec au réchauffement climatique. 2016, Institut de recherche en architecture de société durable (IRASD), division Enjeux énergies et environnement, [En ligne], [http://wp.me/P4eYN3-zTt]
[4] Stratégies comportementales psychosociales déviantes : https://irasd.wordpress.com/lexique/strategies-comportementales-psychosociales-deviantes/
[5] http://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html
Santé mentale et pression fiscale : de l’endettement à la dépression
Une très intéressante analyse de l’IRIS qui pose l’hypothèse du lien direct entre la pression fiscale croissante de l’économie monétaire et la dégradation de la santé mentale des individus soumis à cette pression dont le symptôme qui se multiplie le plus est la dépression et l’échec « social ».
« Cette pression sur les individus fragilise leur santé mentale. Pourtant, on leur fait souvent porter la responsabilité des problèmes qui s’en suivent, tant dans les causes qu’on leur prête que dans les solutions préconisées, qui relèvent généralement de l’auto-prise en charge. Cela a l’effet paradoxal d’intensifier encore davantage la pression que subissent les individus. Notre incapacité à considérer la santé mentale comme un problème social apparaît on ne peut plus clairement dans une publication du Mouvement santé mentale Québec. »
Pour l’IRASD, cette problématique est directement liée aux défauts conceptuels et opérationnels de l’environnement social. En effet, toutes les activités nécessaires au fonctionnement de la société humaine se focalisent essentiellement sur le développement économique monétaire et non sur le développement de l’individu.
Dans ce contexte, il n’y a pas que les pressions fiscales de l’économie monétaire qui s’exercent sur l’individu, mais tout une sommes complexe de pressions induites par les influences du marketing et des mouvements de masse impliqués dans la consommation de biens et services.
Lorsque le point de rupture individuel est atteint, la force de décrochage du système devient insoutenable. Si elle perdure, c’est le burnout et la dépression qui surviennent. Et la multiplication des individus en dépression ne peut qu’entraîner tôt ou tard tout le système en dépression par atrophie des ressources humaines.
.
http://iris-recherche.qc.ca/blogue/le-fardeau-individuel-de-l-endettement-a-la-depression
LE FARDEAU INDIVIDUEL : DE L’ENDETTEMENT À LA DÉPRESSION
Le niveau d’endettement public est l’argument principal derrière les coupes dans les services publics. Or, à mesure que l’État se désengage de son rôle de protection sociale et que les salaires stagnent, les individus sont forcés de se tourner vers l’endettement individuel pour faire face aux évènements malheureux de la vie, comme la maladie ou le chômage [1].
On observe ces tendances simultanées dans les deux graphiques suivants. Le premier graphique semble complexe, mais il montre simplement que la dette du Québec a cessé de croitre et s’est stabilisée. Le second montre le décollage fulgurant de la dette des ménages au tournant des années 2000.

Note : la ligne jaune démontre la stabilisation de la dette du Québec en pourcentage de la richesse; la dette brute est en pourcentage du PIB; la hausse soudaine à la fin des années 90 est due à une réforme comptable.

Il faudra bien que les artisans et artisanes de l’austérité finissent par reconnaitre que leurs mesures ne diminuent pas l’endettement dans l’absolu, puisqu’il est tôt ou tard transféré de l’État vers les particuliers.
L’IRIS a également montré, par le calcul du déficit humain, que malgré l’adoption d’une loi contre la pauvreté au tournant des années 2000, l’État québécois a plutôt choisi de ralentir la croissance de ses revenus et de ses dépenses en abandonnant à elle-même une part grandissante de la population.
Or, cette individualisation de la responsabilité, typique du néolibéralisme, s’observe également au sujet d’un tout autre enjeu : la santé mentale. Les transformations sociales à l’ère néolibérale se traduisent par une pression accrue sur les individus, notamment les travailleurs et les travailleuses, alors qu’on brandit la menace du chômage et qu’on démantèle les syndicats ainsi que la législation du travail. À l’échelle du lieu de travail, on individualise les objectifs et les récompenses afin d’instaurer une compétition entre les employé·e·s et espérer ainsi aller chercher leur performance maximale.
« Intérioriser » les problèmes
Cette pression sur les individus fragilise leur santé mentale. Pourtant, on leur fait souvent porter la responsabilité des problèmes qui s’en suivent, tant dans les causes qu’on leur prête que dans les solutions préconisées, qui relèvent généralement de l’auto-prise en charge. Cela a l’effet paradoxal d’intensifier encore davantage la pression que subissent les individus. Notre incapacité à considérer la santé mentale comme un problème social apparaît on ne peut plus clairement dans une publication du Mouvement santé mentale Québec.
À la question « Pourquoi la santé mentale est-elle si importante pour les organisations? », on répond que c’est parce que « [c]haque jour, 500 000 Canadiens s’absentent du travail en raison de problèmes de santé mentale » et que « [l]es dépenses engagées par une entreprise pour un employé en congé d’invalidité de courte durée en raison d’une maladie mentale s’élèvent à près du double d’un congé d’invalidité attribuable à un problème de santé physique ». La dépression deviendra d’ailleurs la deuxième cause d’invalidité dans le monde d’ici 2020.
Le chat sort du sac. Si le Mouvement nous enjoint à « créer des liens », « agir », « ressentir » et « se ressourcer », ce n’est donc pas tant parce que l’on veut notre bien, mais plutôt celui de l’entreprise. Car un travailleur ou une travailleuse en burn out ou en dépression, ce n’est pas un travailleur ou une travailleuse qui produit!
Parmi les sept astuces mises de l’avant dans la campagne annulle, aucune ne questionne réellement la responsabilité de l’entreprise dans l’épidémie qui touche à l’heure actuelle le Canada, alors que les diagnostics de troubles de l’humeur ont grimpé de 168 % seulement entre 2003 et 2014 [2].
En lisant que pour prendre soin de son équilibre mental, il faut « reconnaître la valeur des collègues et des employé tout en leur permettant d’apprendre de leurs erreurs », « être ouvert à différents points de vue, à de nouvelles idées » et « favoriser les échanges, la réflexion, le soutien et y participer », on croirait que l’épuisement au travail résulte d’une somme de malentendus et de bêtes conflits interpersonnels.
À une telle vision des choses, il faudrait opposer un cadre d’analyse critique du néolibéralisme, de la flexibilisation de la main-d’œuvre qu’il entraine et de la pression à la performance qu’il cause, même en dehors de la sphère du travail.
Les solutions « extériorisées »
Est-ce le travailleur et la travailleuse qui doivent « changer de rythme pour décompresser, récupérer », ou est-ce l’employeur·e qui doit diminuer ses exigences? On s’évertue à tourner vers l’intérieur la culpabilité d’avoir craqué, questionnant les habitudes de vie de chacun·e, regardant avec suspicion ceux et celles qui ne ressassent pas hebdomadairement leur enfance sur un divan. Toutefois, il faudrait au contraire retourner la suspicion vers l’extérieur, afin de faire de la santé mentale un enjeu de société plutôt qu’un trouble individuel.
Les employeurs et les employeuses en font-ils assez pour respecter les limites à la productivité de leurs employé·e·s? Il ne s’agit pas de faire de la méditation sur l’heure du midi ou forcer le personnel à prendre des formations extracurriculaires sur l’estime de soi, reportant ainsi sur leurs épaules la responsabilité de leur équilibre psychologique. Il s’agirait plutôt d’offrir des mesures de conciliation travail-famille, d’accorder plus de deux semaines de vacances par année, de ne pas imposer d’heures supplémentaires, de ne pas les rejoindre en dehors des heures de travail, voire même (soyons fous) de diminuer le temps de travail.
Les mesures d’austérité ne pourront rien faire pour améliorer cette situation. Bien au contraire, elles augmenteront la précarisation et la détresse psychologique, tout en rendant plus difficile l’accès aux soins de santé appropriés. À cet égard, un sondage de l’Association des psychologues du Québec révélait récemment que les compressions budgétaires avaient érodé les services psychologiques du réseau public.
En cette Semaine nationale de la santé mentale et au lendemain de la Fête des travailleurs et des travailleuses, il importe de pointer les projecteurs sur les déterminants sociaux des problèmes de santé mentale, en questionnant notamment le rôle de l’entreprise, et de rappeler conséquemment l’importance de les prendre en charge collectivement.
La dépression et le burn out sont plus durs à quantifier que l’endettement des ménages, notamment parce qu’ils restent encore aujourd’hui très tabous. On peut néanmoins les lier eux aussi aux aléas du durcissement socio-économique néolibéral.
Céline Hequet
Guillaume Hébert
Les auteur·e·s tiennent à remercier Benjamin Gingras pour ses commentaires.
[1] Statistique Canada, Tableau 105-0501 Profil d’indicateurs de la santé, estimations annuelles, selon le groupe d’âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires (limites de 2013) et groupes de régions homologues, CANSIM (base de données), version mise à jour le 22 avril 2016, http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a05?lang=fra&id=1050501 (consulté le 3 mai 2016).
[2] Johnna MONTGOMERIE, « America’s Debt Safety-Net », Public Administration, vol. 91, n° 4, 2013, p. 871-888.
Stratégies d’enseignement et d’apprentissage
Un dossier intéressant sur la psychologie de l’apprentissage.
Des méthodes d’enseignement efficaces – Cerveau&Psycho

Certaines façons de travailler facilitent l’apprentissage, d’autres non. Quelles sont les plus intéressantes ?
John Dunlosky, Katherine Rawson, Elisabeth Marsh, Mitchell Nathan et Daniel Willingham
L’enseignement est souvent centré sur un sujet précis, par exemple l’algèbre, les éléments du tableau de Mendeleïv ou la conjugaison. Mais, encore plus qu’emmagasiner des connaissances, apprendre à apprendre est essentiel. On peut ainsi assimiler plus de connaissances, plus vite, et les retenir pendant des années. Depuis plus de 100 ans, les chercheurs en psychologie cognitive et en sciences de l’éducation ont développé de nombreuses méthodes d’enseignement et les ont évaluées. Elles vont de la relecture des notes prises pendant les cours aux résumés, en passant par les autoévaluations. Certaines stratégies répandues améliorent les résultats des étudiants, d’autres sont chronophages et inefficaces. Pourtant, ces conclusions ne sont jamais entrées dans les salles de classe ; les enseignants ignorent ces méthodes étayées par des résultats expérimentaux, et on ne les enseigne pas aux étudiants. En fait, les deux stratégies d’apprentissage que les étudiants utilisent le plus – le surlignage et les relectures multiples – diminueraient même les chances de réussite…
Comment expliquer ce paradoxe ? La quantité de données disponibles sur les méthodes de travail est gigantesque, de sorte que les éducateurs et les étudiants ne savent pas identifier les plus efficaces. Nous l’avons fait pour eux ; nous avons compilé plus de 700 articles scientifiques traitant des 10 méthodes d’enseignement les plus utilisées. Nous nous sommes limités aux stratégies faciles à utiliser et assez efficaces.
Une technique est considérée comme efficace si elle s’applique à plusieurs conditions d’apprentissage, par exemple seul ou en groupe, et si elle est utile quels que soient l’âge de celui qui s’en sert, ses capacités et son niveau préalable de connaissances. En outre, elle doit avoir été testée en situation réelle. Ceux qui en ont bénéficié doivent être plus performants que les autres, et les connaissances acquises doivent être mieux comprises et mieux mémorisées.
Ces critères nous ont permis d’identifier deux méthodes pertinentes dans de nombreuses situations et produisant des résultats à long terme. Nous recommandons trois autres techniques avec quelques réserves, et en avons identifié cinq qui sont inefficaces, soit parce qu’elles sont utiles dans un nombre trop restreint de situations, soit parce qu’il n’existe pas assez de données permettant de les valider. Les chercheurs continuent à explorer ces méthodes, mais élèves et enseignants peuvent s’y fier tout en restant prudents.
Alors pourquoi les étudiants n’utilisent-ils pas des méthodes d’apprentissage plus efficaces ? Les enseignants ne leur apprennent pas les meilleures stratégies, peut-être parce qu’ils ne les connaissent pas eux-mêmes. Nous avons étudié six livres de cours de psychologie de l’éducation, et une seule technique – les mots-clefs mnémotechniques – est abordée dans chaque ouvrage. Aucun livre ne traite de l’utilité, de l’efficacité et des limites des différentes façons d’apprendre.
Les élèves doivent apprendre à apprendre
En outre, le système éducatif met l’accent sur l’enseignement de contenus et des capacités de raisonnement. On passe peu de temps à enseigner comment apprendre. En conséquence, les étudiants qui s’en sortent bien les premières années quand l’apprentissage est surveillé de près se trouvent souvent en difficulté quand ils sont supposés gérer seuls leurs études, au lycée ou à l’université.
On ignore encore à quel âge commencer une technique et à quelle fréquence il faut s’entraîner. Mais les enseignants peuvent déjà utiliser les meilleures démarches dans leurs cours pour que les étudiants les adoptent ensuite. Par exemple, avant de changer de thème, un enseignant peut demander aux étudiants de faire un test d’entraînement couvrant les concepts importants de la session précédente, et leur fournir une correction immédiate ; les étudiants peuvent introduire de nouveaux problèmes au milieu d’exercices similaires ; les enseignants peuvent présenter des concepts importants dans des cours distincts, et inciter les étudiants à s’interroger.
Ces méthodes d’apprentissage ne sont pas la panacée. Elles sont efficaces pour les plus motivés. Mais nous pensons qu’elles augmentent les performances des étudiants en cours, aux examens et… toute leur vie.
1. L’autoévaluation. S’interroger sur ce que l’on vient d’apprendre
Comment ça marche ? L’étudiant réalise des tests d’évaluation de façon autonome, en dehors de la classe. Ce ne sont pas des tests de connaissances. Par exemple, il peut utiliser des cartes d’apprentissage (sous forme papier ou numérique) pour se remémorer des informations, ou répondre aux questions proposées à la fin des chapitres de ses livres de cours. Des centaines d’expériences montrent que l’auto-évaluation améliore l’apprentissage et la mémorisation.
Dans une étude, on demandait à des étudiants en licence de retenir des paires de mots, dont la moitié réapparaissait ensuite dans un test de rappel. Une semaine après, les étudiants se souvenaient de 35 pour cent des paires de mots pour lesquelles ils avaient été testés, mais seulement de 4 pour cent des paires absentes du test de rappel. Les tests d’entraînement déclencheraient une recherche dans la mémoire à long terme, ce qui active diverses informations associées. Plusieurs voies mnésiques seraient sollicitées, processus qui facilite l’accès à l’information.
Quand l’utiliser ? Tous les « élèves », de la maternelle à la fin de l’université, voire les adultes, augmentent leurs performances avec des tests d’entraînement. Ils peuvent être utilisés pour tout type d’information, y compris l’apprentissage du vocabulaire des langues étrangères, l’orthographe et la mémorisation des différentes parties d’une fleur. Ils améliorent même la mémoire de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Des tests courts et fréquents sont les plus efficaces, notamment quand l’utilisateur s’autocorrige. Les effets bénéfiques de ces autoévaluations durent des années.
Est-ce pratique ? Oui. L’auto-évaluation demande peu de temps, et peu ou pas d’entraînement.
Comment faire ? Les étudiants peuvent s’autoévaluer avec des cartes d’apprentissage ou en utilisant le système Cornell : pendant la prise de notes en classe, on fait une colonne en marge de la page, où l’on inscrit des mots-clefs ou des questions. Ensuite, on peut se tester en reprenant ces notes et en répondant aux questions (ou en expliquant les mots-clefs).
L’autoévaluation est donc très utile. Les tests d’entraînement sont efficaces quels que soient les informations à retenir, l’âge du sujet et l’intervalle entre les cours.
2. La pratique distribuée. Étaler l’apprentissage dans le temps
Comment ça marche ?
Les étudiants regroupent en général toutes leurs heures de travail – ils bachotent. Pourtant, répartir l’apprentissage dans le temps est bien plus efficace. Dans une étude, des étudiants apprenaient la traduction anglaise de mots espagnols, puis révisaient. Un groupe faisait les révisions juste après l’apprentissage, un autre le lendemain et un troisième après 30 jours. Ce sont les étudiants du troisième groupe qui se souvenaient le mieux des traductions. En analysant 254 études comprenant plus de 14 000 participants, nous avons constaté que les étudiants mémorisent mieux après un apprentissage étalé dans le temps qu’après un apprentissage regroupé.
Quand l’utiliser ? Dès trois ans et à tout âge. La pratique distribuée est efficace pour apprendre le vocabulaire d’une langue étrangère, des définitions, et même les mathématiques, la musique et la chirurgie.
Est-ce pratique ? Oui. Bien que les livres de cours regroupent en général les problèmes par thème, on peut décider de les disperser. Il faut planifier à l’avance ce que l’on va étudier et éviter la procrastination.
Comment faire ? Plus l’intervalle entre deux sessions est long, plus l’apprentissage est efficace. Dans une étude réalisée sur Internet, on a constaté que les performances sont meilleures quand le temps entre deux sessions d’apprentissage correspond à 10 à 20 pour cent du temps de mémorisation – temps pendant lequel on doit retenir l’information. En d’autres termes, pour retenir quelque chose pendant une semaine, les sessions d’apprentissage doivent être espacées de 12 à 24 heures ; pour s’en souvenir pendant cinq ans, elles doivent être séparées de 6 à 12 mois. Contrairement à ce que l’on pense, on retient bien les informations pendant de si longues périodes, et on réapprend vite ce que l’on a oublié. C’est ainsi que l’on mémorise les concepts fondamentaux.
La pratique distribuée est donc très utile. Elle est efficace à long terme quels que soient l’information à retenir et l’âge du sujet. Elle est facile à mettre en œuvre et a été utilisée avec succès dans un grand nombre d’études.
3. L’auto-interrogation. Se poser les bonnes questions
Comment ça marche ?
Nous sommes sans arrêt en train de chercher des explications du monde qui nous entoure : plusieurs données suggèrent aussi qu’inciter les étudiants à répondre à la question « pourquoi ? » facilite l’apprentissage. Avec cette technique, nommée l’auto-interrogation, les utilisateurs répondent, par exemple à des questions telles que : « Pourquoi est-il cohérent que… ? » ou « Pourquoi est-il vrai que… ? ». Dans une étude, des étudiants lisaient des phrases, par exemple : « L’homme qui avait faim monta dans la voiture. » On demandait ensuite aux sujets d’un premier groupe d’expliquer pourquoi, tandis qu’à ceux d’un autre groupe, on proposait une explication, par exemple : « L’homme qui avait faim monta dans la voiture pour aller au restaurant. » Un troisième groupe lisait simplement les phrases. Lors du test, on demandait aux sujets de rappeler qui faisait quoi (« Qui est monté dans la voiture ? »). Le premier groupe répondait correctement dans 72 pour cent des cas, contre environ 37 pour cent pour les deux autres groupes.
Quand l’utiliser ? Si vous souhaitez apprendre des faits précis, notamment si vous avez déjà des connaissances sur le sujet. Plus vous en savez dans le domaine, plus la méthode est efficace. Par exemple, des étudiants allemands étaient plus performants sur les Länder allemands que sur les provinces canadiennes. Les connaissances préalables permettraient aux étudiants de produire des explications plus appropriées.
Cette technique semble efficace quel que soit l’âge, du CM1 jusqu’au premier cycle universitaire. L’auto-interrogation améliore la mémorisation des faits, mais il est peu probable qu’elle facilite la compréhension. On ignore aussi combien de temps dure le bénéfice.
Est-ce pratique ? Oui. Cette méthode demande peu d’entraînement et peu de temps. Dans une étude, le groupe pratiquant l’auto-interrogation accomplissait une tâche de lecture en 32 minutes, alors que celui qui lisait seulement prenait 28 minutes.
L’auto-interrogation est donc utile dans certains cas ; il est probable qu’elle ne fonctionne pas pour des données complexes. Ses bénéfices seraient limités. Des travaux supplémentaires seront nécessaires pour établir si cette méthode s’applique à diverses situations et à différents types d’information.
4. L’autoexplication. Comprendre ce que l’on a appris
Comment ça marche ? Les utilisateurs expliquent ce qu’ils ont appris, explorant leurs processus mentaux avec des questions du type : « Quelle information la phrase m’apporte-t-elle ? » et « En quoi cette information est-elle liée à ce que je sais déjà ? » Comme l’auto-interrogation, l’autoexplication permettrait d’intégrer des informations nouvelles à des connaissances antérieures.
Quand l’utiliser ? Elle est efficace de la maternelle aux premiers cycles universitaires. Elle aide à résoudre des problèmes de mathématiques et de raisonnement, et à apprendre des textes et des stratégies aux échecs. L’autoexplication permet aux enfants de se souvenir des fondamentaux. Elle améliore la mémorisation, la compréhension et la résolution de problèmes. Mais la plupart des études ont mesuré ses bénéfices après seulement quelques minutes de pratique ; on ignore si la méthode a des effets durables et si elle nécessite des connaissances antérieures.
Est-ce pratique ? Ce n’est pas certain. La plupart des utilisateurs ont besoin de peu d’instructions et d’un entraînement court (bien qu’une étude réalisée avec des élèves de 3e ait montré qu’en l’absence d’entraînement, les jeunes paraphrasaient au lieu d’expliquer). Toutefois, quelques études montrent que cette technique est chronophage, augmentant le temps d’apprentissage de 30 à 100 pour cent.
L’autoexplication est donc modérément utile. Elle fonctionne pour différents sujets, mais des recherches supplémentaires doivent établir si ses effets sont durables et si elle ne prend pas trop de temps à mettre en œuvre.
5. La pratique variable. Mélanger les torchons et les serviettes
Comment ça marche ? Les étudiants travaillent souvent entièrement un sujet avant de passer au suivant. Mais de récents travaux de recherche montrent que la pratique variable est efficace : les étudiants alternent différents types d’information ou de problèmes. Par exemple, dans une étude, des étudiants de licence apprenaient à calculer les volumes de quatre formes géométriques. Le premier groupe finissait tous les problèmes pour une forme avant de passer à la suivante. Pour le deuxième groupe, les problèmes étaient mélangés. La semaine suivante, le groupe ayant appliqué la pratique variable réussissait mieux le test de calcul. L’alternance encourage les étudiants à sélectionner la meilleure procédure et à comparer différents types de problèmes.
Quand l’utiliser ? Quand les problèmes sont assez similaires, peut-être parce que le fait de les juxtaposer facilite l’identification de ce qui les distingue. Réaliser à la suite tous les items d’une catégorie serait plus efficace quand les problèmes sont différents.
Il est possible que la pratique variable ne soit utile qu’à ceux ayant déjà un certain niveau de compétences. Les performances dépendent aussi du contenu. La méthode améliore la résolution de problèmes d’algèbre. Dans une étude, des étudiants en médecine ont aussi mieux interprété des enregistrements utilisés pour diagnostiquer des troubles cardiaques. Mais deux études portant sur l’apprentissage de vocabulaire en langue étrangère ont montré que la pratique variable n’a pas d’effet. Néanmoins, c’est une stratégie intéressante pour les mathématiques.
Est-ce pratique ? Oui. Un étudiant motivé utilise facilement la pratique variable sans instruction. Les enseignants pourraient aussi l’appliquer en classe : ils introduisent un problème (ou un thème) et travaillent sur ce sujet ; puis ils en présentent un nouveau et le mélangent à des exemples du thème précédent. L’apprentissage prendrait alors un peu plus de temps, mais il serait plus efficace et les élèves auraient de meilleurs résultats.
La pratique variable est donc modérément utile. Elle améliore l’apprentissage, la mémorisation de données mathématiques et stimule d’autres capacités cognitives. Peu de travaux évaluent cette technique et plusieurs résultats sont négatifs. Mais les études portant sur l’apprentissage moteur soulignent l’intérêt de cette pratique. La méthode ne fonctionnerait pas systématiquement ou elle ne serait pas toujours utilisée de façon appropriée.
Les méthodes qui ne fonctionnent pas
Ces méthodes ne sont pas utiles, car elles sont inefficaces, coûteuses en énergie ou en temps, ou ne sont bénéfiques que pour quelques apprentissages et pour de courtes périodes. La plupart des étudiants relisent et surlignent ce qu’ils font. Pourtant, ces techniques n’augmentent pas les performances et détournent les étudiants des stratégies plus efficaces. D’autres méthodes citées ici sont simplement chronophages.
Surligner
Les étudiants soulignent, surlignent ou marquent, avec des symboles par exemple, ce qu’ils apprennent. C’est simple et rapide, mais cela n’améliore pas les performances. Dans différentes études, surligner s’est révélé inefficace pour des stagiaires de l’armée de l’air, pour des enfants, pour des étudiants en licence. Souligner est aussi inutile quels que soient la longueur des textes et le sujet. En fait, ces techniques seraient même délétères pour certaines tâches. Une étude a montré que le fait de souligner diminue les capacités de raisonnement par inférence pour des étudiants en histoire ; cette tâche attirerait l’attention sur des items particuliers, et non sur le lien entre les données.
Que faire à la place ? Surligner ou souligner peut être une première étape, si l’information marquée est ensuite transformée en cartes d’apprentissage ou en autoévaluations. Comme les étudiants continueront d’utiliser cette technique, il faudrait leur apprendre à la faire de façon plus efficace – c’est-à-dire plus judicieusement, en surlignant moins de choses et en associant une autre méthode d’apprentissage.
Relire
Selon une enquête réalisée auprès des étudiants d’une université américaine, 84 pour cent d’entre eux relisent plusieurs fois leurs livres ou leurs notes quand ils étudient. Cela ne nécessite aucun entraînement, prend peu de temps, et quelques bénéfices ont été rapportés avec des tests de rappel ou des tests de textes à trous.
Pourtant, aucune étude n’indique que relire améliore la compréhension, et l’effet du niveau préalable de connaissances ou de compétences reste inexploré. Seule la seconde lecture est bénéfique, les avantages diminuant pour les répétitions ultérieures. Et aucune étude n’a évalué cette technique pour des contenus de cours réels.
Que faire à la place ? Ne perdez pas votre temps, appliquez d’autres stratégies telles que l’auto-interrogation, l’autoexplication et l’autoévaluation. Relire donne des résultats médiocres.
Trois autres méthodes, moins utilisées, ont obtenu de piètres résultats lors de notre évaluation ; « L’imagerie mentale pour l’apprentissage de textes » doit être mieux étayée avant d’être recommandée ; les résumés et les mots-clefs mnémotechniques semblent inefficaces et chronophages.
Avec la technique des résumés, les étudiants identifient les points importants du texte et éliminent le reste. Il est difficile de dire si cette technique fonctionne, car elle est hétérogène ; on ignore s’il est efficace de résumer de petites parties d’un texte ou plutôt de longs passages, ni si la longueur, la facilité de lecture ou l’organisation du contenu sont importantes.
Avec la technique des mots-clefs mnémotechniques, l’imagerie mentale augmenterait la mémorisation. Ainsi, un étudiant anglophone apprenant le mot français dent utilise par exemple le mot anglais à consonance similaire dentist pour former une image mentale d’un dentiste tenant une molaire. Les méthodes mnémotechniques semblent utiles pour le vocabulaire d’une langue étrangère, les définitions de mots et la terminologie médicale, mais elles ne seraient pas efficaces à long terme ; les efforts investis pour produire des mots-clefs seraient une perte de temps.
Une autre méthode utilisant des images mentales permet aux étudiants d’apprendre des textes : ils créent des images pour chaque paragraphe lu. Les études scientifiques de cette technique donnent des résultats contradictoires, avec peu d’effets à long terme. Les enseignants pourraient suggérer aux étudiants d’essayer avec des textes faciles à mettre en images, mais rien ne prouve que c’est utile.
Marasme économique et effondrement de la civilisation
Force est de constater les dommages de plus en plus considérables et souvent irréversibles aux environnements biophysique et humain documentés par d’innombrables analyses publiées quotidiennement.
Ces impacts, qui sont perpétrés par des individus de l’espèce humaine, proviennent de stratégies comportementales déviantes induites par des concepts et mécanismes de société erronés qui interagissent avec la nature humaine.
Les recherches de l’IRASD à l’échelle de la planète s’appliquent à l’échelle locale actuelle pour l’observation et l’étude des stratégies décisionnelles chez l’humain. Ces recherches tendent à démontrer que les concepts et mécanismes de l’économie monétaire induisent des comportements déviants [1] chez l’être humain. Ce qui permet de prétendre que ces concepts sont erronés car incompatibles avec la nature humaine!
Avec l’étude anthropologique des Premiers Peuples [2], on peut comprendre que l’argent n’existait pas dans les sociétés, ce qui a inhibé l’apparition du concept de « propriété » durant des millénaires.
L’évolution de l’espèce humaine, bien que complexe, est facile à comprendre [3]. Ce qui ressort de l’analyse anthropologique, comportementale et psychosociale de l’histoire et du progrès de l’humanité c’est que l’espèce a commis une longue suite d’erreurs sociales graves en toute ignorance des effets de ces décisions, simplement parce que les connaissances scientifiques n’étaient pas suffisamment développées!
Aujourd’hui, l’espèce commence à peine à prendre conscience qu’elle est la cause première de la dégradation de la Terre-Mère par ses stratégies comportementales psychosociales, économiques, politiques et industrielles. Le système de société établi par l’homme au fil de son évolution et de son histoire est erroné parce qu’il induit des comportements déviants [1].
La question qui se pose est : allons-nous réussir à progresser d’un bond pour sortir du marasme ou continuer à accélérer notre course vers l’effondrement au rythme de la volonté de faire croitre un modèle économique monétaire au détriment d’un modèle social humain?
Pour plusieurs chercheurs [4], il est déjà trop tard, et il faut nous préparer dignement à l’effondrement de notre civilisation afin d’éviter le chaos [5].
[1] https://irasd.wordpress.com/lexique/strategies-comportementales-psychosociales-deviantes/
[2] http://www.amazon.com/Les-Enfants-dAataentsic-LHistoire-Peuple/dp/2891113640
Lecture : Survivre à l’offensive des riches
Un nouveau livre de Roméo Bouchard, citoyen engagé avec sa conscience incisive et réaliste des enjeux de notre civilisation et des risques encourus par notre espèce si on ne change rien à notre modèle de société.
.
https://www.facebook.com/romeo.bouchard36/posts/10155034355113849
SURVIVRE à l’offensive des riches
Roméo Bouchard
Écosociété, collection Résilience
En librairie aujourd’hui, 12 avril
En entrevue à Paul Arcand jeudi matin à 9h20
et à CIBL-Montréal mercredi matin 8h35.
Salon du livre de Québec, vendredi et samedi prochains.
« Pour mes 80 ans, je me permets un nouveau livre qui est une sorte de témoignage, de testament et d’appel.
Nous entrons dans l’ère de la survie
J’ai de plus en plus l’impression que nous avons perdu le contrôle de tout , que nous roulons dans un train fou, vers un déraillement certain, qui met notre survie comme espèce en danger. De combat en combat, d’étude en étude, je suis parvenu à la conviction que notre civilisation ne pourra éviter un effondrement au cours des prochaines décennies.
Il ne s’agit pas de vagues prophéties mais de faits qui font l’objet d’un large consensus dans la communauté scientifique internationale. Les changements à opérer pour éviter l’effondrement sont si énormes, le contrôle des banquiers et des multinationales sur les décisions collectives est si puissant et le temps qui nous reste pour agir est si réduit, une quinzaine d’année tout au plus, qu’il est d’ores et déjà certain que nous allons très bientôt être contraints de vivre dans une société de plus en plus désorganisée et un environnement de plus en plus hostile. Nous ne pourrons pas faire marche arrière sur le
-réchauffement du climat,
-la déforestation,
-la destruction de la biodiversité et des ressources non renouvelables,
-la pollution généralisée,
-la dépendance à la technologie,
-les inégalités sociales,
-l’obsession de la croissance et surtout,
la dictature des riches qui en est la cause.
Nous avons perdu le contrôle
Au cours des dernières décennies, les riches ont progressivement mis en place tous les outils qui leur permettent de s’assurer une accumulation et une concentration de la richesse de plus en plus insoutenable :
-la croissance du PIB élevé au rang de fétiche,
-le contrôle de la monnaie par les banques privées,
-la spéculation boursière,
-les organismes de contrôle économique internationaux,
-l’abolition des frontières nationales par les ententes de libre-échange et les entreprises multinationales,
-les paradis et abris fiscaux,
-l’endettement des états et des particuliers,
-les agences de notation,
-le contrôle des élections et des parlements,
-le démantèlement de l’état redistributeur par les programmes d’austérité et la privatisation des services,
-la robotisation,
-le contrôle des esprits par les médias et la publicité,
-une culture de consommation, de gaspillage et de déchet qui nous a conduit au bord de l’extinction.
La dictature des riches, comme un rouleau-compresseur, écrase tous nos liens sociaux et nos liens avec la Nature.
Nous préférons ne pas y croire
Nous commençons à comprendre que la fête de la croissance tire à sa fin et que nous allons bientôt devoir payer très cher ce déchaînement programmé et insensé de production et de consommation. Le système financier est au bord de l’éclatement en raison de la spéculation et de l’endettement; le réchauffement du climat et la surexploitation irresponsable sont sur le point de compromettre la satisfaction de nos besoins essentiels en nourriture, en eau, en énergie, en logement, en vêtement; les inégalités sociales et les migrants menacent l’ordre social mondial. Mais nous préférons ne pas y penser, ou croire qu’on exagère, ou faire confiance au progrès, à la technique et à la capacité d’adaptation des humains, à l’économie verte. Pourtant, quand on pousse l’analyse un peu plus loin, rien de tout cela ne pourra nous éviter l’effondrement.
Un guide de survie
Dans ce plaidoyer, je ne démontre rien : je constate, j’accumule, je presse, je démasque la mécanique des riches, je combats le déni, je dénonce notre dépendance à la drogue de la consommation, je plaide pour une prise de conscience, pour un projet de survie axé sur la démocratie citoyenne et la restauration du pouvoir des citoyens, sur l’affranchissement de la croissance à tout prix, sur une économie circulaire respectueuse des besoins réels et de notre environnement, sur une société de proximité et de solidarité, sur le bien-vivre et le retour à la Nature.
Pas des solutions…ni des moyens d’éviter le désastre…mais tout juste des façons de nous préparer à survivre au dérèglement de notre système économique et des écosystèmes de notre planète.
Relocaliser. Renaturaliser. Regrouper. Recommencer. Réapprendre. Ralentir. Réduire. Récupérer. Recycler. Restaurer. Reconstruire. Bienvenue dans l’ère de la survie! »
Roméo Bouchard
.
http://ecosociete.org/livres/survivre
Survivre à l’offensive des riches
À l’aube de ses 80 ans, Roméo Bouchard livre ici un testament politique clair et magistral sur la crise écologique et la crise de civilisation qu’elle entraîne, au Québec comme partout ailleurs dans le monde.
La démocratie, les services publics, la solidarité sociale, le français, les médias, les régions éloignées, l’agriculture, le climat, l’environnement : tout est en péril… sauf le pouvoir des riches, qui semblent bien déterminés à sucer le sang de cette planète jusqu’à la dernière goutte. Pour cette oligarchie, tout se déroule en effet comme prévu : le peuple, pris au piège de la consommation, est réduit à une sorte d’esclavage par le travail et l’endettement. Comment survivre à cette offensive des riches? Comment s’affranchir du joug de la croissance économique illimitée qui menace les équilibres naturels indispensables à la survie de l’espèce humaine sur Terre? Pour ce militant de longue date, il faut avant tout restaurer la démocratie et la souveraineté du peuple par l’exercice d’une assemblée constituante.
À la lumière d’une vie d’engagement social et politique, Roméo Bouchard débroussaille les chemins de la résilience collective pour l’avenir de la planète, notre seule maison commune.
L’abrutissement économique de la société humaine
Nous réagissons ici à l’excellente analyse des constats faits par Roméo Bouchard dans l’article qui suit au sujet des divertissements médiatiques qui dispersent la capacité cognitive d’innovation sociale.
Il faut prendre conscience que, non seulement la télévision est devenue prétexte a l’abrutissement des populations, mais aussi toutes les activités assujetties à la pression fiscale induite par la croissance du système économique monétaire, incluant l’éducation au profit de la productivité et la science au profit de l’application industrielle.
Cette pression est inévitable, elle est systémique et symptomatique. Elle continuera de s’exercer jusqu’à ce que le système implose parce qu’il aura tout consumé des ressources naturelles qui sont de moins abondantes et des ressources humaines de moins en moins en mesure d’utiliser leur intelligence cognitive pour réagir et décider correctement des graves problématiques humaines et sociales qui empirent de jour en jour.
Seule l’élimination du concept d’argent, qui induit des stratégies comportementales déviantes, permet d’architecturer un modèle de société durable. Le modèle économique qui en résulte doit être basé sur la valeur de l’apport individuel à la collectivité en misant sur l’éducation du et la valeur du citoyen, au lieu de miser sur la valeur des biens et services pour l’enrichissement d’une élite privilégiée.
Car dans la réalité sociale, ce sont 99% des individus qui composent la collectivité sociale, pas exclusivement le 1% de l’élite. Mais au fil des millénaires de l’évolution comportementale et du progrès social de l’homme, nous avons tranquillement créé une société de « zombies » à l’éducation limitée pour mieux favoriser le contrôle de la masse par des élites au pouvoir politique et surtout économique.
Cela dure depuis des siècles mêmes si le modèle s’est transformer pour le rendre plus attrayant et acceptable en apparence avec des loisirs et divertissements de plus en plus sophistiqués. On a même fait du travail une forme de divertissement et d’épanouissement pour le rendre plus acceptable même s’il n’apporte que bien peu ou rien du tout au progrès collectif et à l’épanouissement personnel.
Tant qu’on ne fera aucun effort pour changer cet état de fait, les initiatives citoyennes démocratiques seront ralenties, absorbées et annihilées par ce phénomène qui croit au rythme de la nécessité de croissance économique.
Tout est lié dans le système Terre-homme-société.
.
http://www.ledevoir.com/culture/television/467578/raz-le-bol-des-emissions-de-vedettes
Ras le bol des émissions de vedettes!

J’accuse les médias de sombrer dans le divertissement futile et le vedettariat. Ce n’est plus seulement une tendance, c’est devenu une calamité, une politique délibérée de désinformation, un détournement de démocratie, une autre stratégie de l’offensive des riches pour s’enrichir sans avoir les citoyens dans les jambes. La formule est vieille comme le monde : régner tranquillement, en offrant du pain et des jeux au petit peuple.
La plupart des émissions de télévision et même de radio, à part peut-être les bulletins d’information bien-pensants qu’on nous repasse en boucle du matin au soir, sont conçues désormais non plus en fonction de leur utilité ou de leur intérêt public, mais en fonction de leur coût et de leur rentabilité en cotes d’écoute, et donc, en publicité. Pour ce faire, on a recours aux artistes, humoristes et cuisiniers les plus populaires, et donc les plus « payants », on potine sur leur vie et leur travail, on les fait participer à des séances de jeux et de farces de plus en plus grossières et insignifiantes. Ça donne des émissions banales, animées par des vedettes, qui invitent d’autres artistes et humoristes et se parlent entre eux, et souvent tous ensemble, de tout et de rien.
Même des émissions qui avaient à l’origine un contenu ouvert, comme Tout le monde en parle, Pénélope, Les enfants de la télé, etc., sont atteintes de ce virus du divertissement à tout prix. Au retour de Pénélope, qui était à l’origine une émission de divertissement léger d’été, nous avons eu droit ces jours-ci à la couleur du rouge à lèvres de Véro, aux secrets du gazon de Charles Lafortune, aux choix de chemise d’Alex Perron, aux « bitchages » de Jean-Sébastien Girard et de Jean-René Dufort, et rien d’autre.
Le Québec, c’est plus que ce circuit fermé des artistes, des humoristes et des cuisiniers connus. Si brillants soient-ils, ils sont surexposés et finissent par n’avoir plus grand-chose à dire, si ce n’est figurer pour les cachets. Les pièces de théâtre, les spectacles, les entrevues d’auteurs ou de penseurs, le monde ordinaire, tout est disparu des écrans. Il n’y a plus que des vedettes.
Offre différente
Il y a pourtant des gens partout au Québec, même hors de Montréal, qui publient des livres remarquables, pas juste aux éditions de La Presse ou de Québecor, mais à Écosociété, à Lux, à Septentrion, à Atelier 10, aux Trois-Pistoles ; il y a des gens qui font, qui inventent des choses étonnantes et créent des projets magnifiques ; il y a des gens qui luttent pour sauver leur travail, leur village, leur vie, leur environnement ; il y a des gens qui ont des choses à dire et qui n’ont jamais accès aux médias nationaux ; il y a des drames humains et sociaux dont on ne parle jamais. La vision du Québec et du monde que projettent ces médias est de plus en plus hors de la réalité. C’est un détournement de conscience, de fonds et de moyens lourds de conséquences. On est loin des leçons de politique de René Lévesque à Point de mire, des grandes entrevues de Fernand Séguin au Sel de la semaine, des grands questionnaires de Raymond Charette à Tous pour un, des télé-théâtres de Marcel Dubé aux Beaux dimanches, des émissions dont on se souvient encore cinquante ans plus tard.
Pour les gens de Montréal, pour la jeune génération surtout, c’est peut-être un moindre mal, car la télévision généraliste et la télévision en général sont de plus en plus remplacées par diverses plateformes numériques et par le foisonnement culturel et politique de la grande ville. Mais pour les plus âgés et pour les gens des régions éloignées, ces options ne sont guère accessibles, et les gens y sont captifs de ce lavage de cerveau abrutissant et aliénant.
Les médias d’information ont une grande responsabilité : ils sont un outil essentiel pour une vie démocratique en santé. Présentement, ils sont devenus une drogue empoisonnée qui nous détourne de notre réalité et nous enferme dans l’insignifiance et l’inaction. Quelqu’un pourrait-il dire aux responsables que nous en avons ras le bol de ces émissions de vedettes médiocres et mercantiles ?
L’homme, une espèce irrationnelle
Le processus cognitif humain serait principalement irrationnel
« Les fondements de notre civilisation occidentale reposent sur le postulat que nos décisions sont parfaitement rationnelles et raisonnées. Or, rien n’est moins sûr. Depuis le milieu du XXe siècle, de nombreuses expériences de psychologie expérimentale et d’économie mettent en évidence que la rationalité de l’espèce humaine est souvent prise en défaut! »
« … si la rationalité est un leurre, c’est que notre cerveau n’est tout simplement pas conçu pour penser rationnellement. »
« La grande majorité des sujets testés, qu’ils soient humains, singes, chacals ou pigeons, se comportent de manière irrationnelle. »
Selon cette étude et de nombreuses autres citées dans l’article, il semblerait que le processus cognitif de l’espèce humaine soit irrationnel, comme celui de nombreuses espèces observées. Mais le consensus ne semble pas être absolu, comme nulle part en science rationnelle d’ailleurs…
En effet, la cognition est inévitablement plus complexe et doit être étudiée en tenant compte d’une foule d’aspects dont l’évolution de l’espèce, la croissance de l’individu, le contexte culturel et psychosocial, son cheminement d’apprentissages, la capacité plastique de son cerveau, sa génétique individuelle et une foule d’autres facteurs qu’aucune recherche n’a encore pu identifier parce qu’elle doit intégrer plusieurs domaines des sciences. Et peu de scientifiques procèdent de manière intégrée avec les autres sciences dans leurs recherches…
De plus, les graves défauts conceptuels de l’environnement social agissent comme des limitations, voire des freins aux efforts de recherche qui pourraient contribuer à faire avancer la science dans ce domaine. En effet, plus la pression fiscale de la croissance économique monétaire capitaliste est forte, plus la science est déviée vers la science appliquée ou corrompue au bénéfice des corporations.
Le ralentissement du progrès scientifique qui en découle provoque une augmentation des risques de survie de l’espèce par ignorance des faits, ce qui favorise d’autant les comportements irrationnels!
Comment un environnement social supposément rationnel peut-il fonctionner adéquatement si la population qui compose la société est irrationnelle?
Nos observations à l’IRASD tendent à démontrer effectivement que non seulement l’environnement social n’est pas totalement rationnel, mais qu’il fonctionne de manière aussi irrationnelle que les humains qui l’ont conçu!
On peut alors se demander par quel miracle un environnement social partiellement rationnel peut-il avoir été conçu par des individus irrationnels?
En analysant les jalons historiques qui ont contribué à établir graduellement les fondations de l’environnement social humain, on constate que les individus qui ont amené les principaux concepts et mécanismes de société semblent avoir eu une cognition rationnelle plus développée que la moyenne.
Toutefois, la carence généralisée chez l’homme à la cognition intégrée ne lui a pas permit d’être totalement rationnel, ce qui explique l’échec total de l’intégration de l’espèce humaine en symbiose avec son environnement biophysique.
Ces constats permettent de supposer que seul un environnement social conçu spécifiquement pour contraindre les extrêmes d’irrationalité peut endiguer les écarts décisionnels observés qui mettent actuellement en péril la pérennité de la civilisation et la survie de l’espèce humaine.
La conception architecturale d’un tel modèle de société ne peut se faire qu’en adoptant une démarche extrêmement rationnelle inspirée de l’approche scientifique et faisant intervenir les connaissances démontrées comme fiables cumulées par l’humanité.
Ce processus implique une recherche très exhaustive et de longue haleine et la collaboration de nombreux chercheurs de tous les domaines des sciences naturelles et sociales pour constituer une compréhension suffisamment large du système terre-homme-société.
Seule cette compréhension peut ouvrir la porte à une démarche d’architecture rationnelle pour l’élaboration de concepts et mécanismes de société favorisant un environnement social rationnel qui permet un progrès durable de la civilisation et une évolution équilibrée de l’espèce tout en maintenant les équilibres entre l’humain, sa société et son environnement biophysique.
.
http://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2016/03/matiere-decision
Matière à décision
[Thomas Boraud coprésidait le 16e Forum international Science et société de l’Acfas, en novembre 2015, à Montréal. Il participait, entre autres, à l’atelier Cerveau et libre arbritre, y a-t-il un pilote dans l’avion? Nous avons profité de sa présence pour l’inviter à nous présenter son dernier ouvrage dans la présente rubrique.]
Les fondements de notre civilisation occidentale reposent sur le postulat que nos décisions sont parfaitement rationnelles et raisonnées. Or, rien n’est moins sûr. Depuis le milieu du XXe siècle, de nombreuses expériences de psychologie expérimentale et d’économie mettent en évidence que la rationalité de l’espèce humaine est souvent prise en défaut !
J’ai décidé d’écrire ce livre pour apporter un substrat neurobiologique aux explications éthologiques généralement avancées pour expliquer ce constat : si la rationalité est un leurre, c’est que notre cerveau n’est tout simplement pas conçu pour penser rationnellement.
Tester l’irrationalité
Imaginez que je vous demande de choisir entre deux machines à sous de ma fabrication. Je vous explique qu’avec chacune, vous avez une probabilité de gagner 1 euro à chaque essai. Cette probabilité, que vous ignorez, est fixe pour chaque machine et différente d’une machine à l’autre (par exemple l’une a une probabilité de 0,3 de vous faire gagner, l’autre de 0,6). Vous avez le droit de jouer une trentaine de fois. Quelle sera votre stratégie? Il y a fort à parier que vous choisirez d’abord au hasard ou sur des critères non pertinent (la bleue, par exemple, parce que c’est votre couleur préférée) et ensuite, en vous basant sur les gains obtenus pendant les premiers essais, vous choisirez préférentiellement celle qui vous a rapportée le plus.
Tout l’intérêt de cette étude résulte dans ce terme préférentiellement. À la fin de l’étude, vos gains seront supérieurs à ce qu’ils seraient si vous aviez choisi au hasard : vous aurez appris. Mais de temps en temps, vous continuerez à choisir l’autre machine alors que la raison voudrait que vous vous concentriez sur la machine qui rapporte le plus souvent. Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas seuls. La grande majorité des sujets testés, qu’ils soient humains, singes, chacals ou pigeons, se comportent de cette manière « irrationnelle ». Ce comportement sous optimal n’est qu’un des multiples exemples des limites de la rationalité que l’on peut mettre en évidence expérimentalement.
«La grande majorité des sujets testés, qu’ils soient humains, singes, chacals ou pigeons, se comportent de manière irrationnelle ».
Les Lumières n’ont pas tout éclairé…
Depuis l’Antiquité, l’opposition entre le cœur et la raison est au centre des préoccupations de la philosophie occidentale. Mais le débat n’a vraiment pénétré la société qu’assez tard. Jusqu’à l’époque moderne, l’homo occidentalis se différenciait peu de ses congénères des autres cultures en se pensant guidé par des forces supérieures (Fortune, destin, foi, etc…). C’est l’avènement des Lumières au XVIIIe siècle et son aspiration à l’universalité qui va contribuer à la propagation de la rationalité. Pendant les deux siècles suivants, les occidentaux ont acquis ainsi progressivement le statut d’individus rationnels et raisonnés qui légitime, entre autres, leur indépendance politique.
Or la rationalité est elle à peine élevée comme principe fondateur de notre civilisation que ce bel édifice est mis à mal vers le milieu du XXe siècle. En utilisant des approches différentes, économistes et psychologues expérimentaux ont convergé vers le constat que les principes qui régissent les processus de décision ne sont pas complétement rationnels. Ce phénomène peut prendre plusieurs formes. Maurice Allais, à titre d’exemple, a montré que les sujets ne choisissaient pas entre plusieurs loteries de façon cohérentes (et même des prix Nobel d’économie se sont laissé avoir à son désormais célèbre paradoxe). Plus tard, Tversky et Kahneman ont montré que les sujets ne choisissent pas la même option si le problème est présenté différement (phénomène de cadrage). Récemment Tali Sharrot a mis en évidence que nos capacités d’apprentissage étaient perturbées par un incorrigible optimisme. Il ne s’agit ici que de trois exemples parmi de nombreuses mises en évidence de ce constat qui désole les économistes : l’homme n’est décidément pas rationnel dans ces choix. Il n’est d’ailleurs pas le seul puisque que le protocole des bandits-manchot, que j’ai décrit à travers l’exemple des machines à sous, consacre l’irrationalité de l’ensemble du règne animal.
Un problème, trois approches
Pour les comportementalistes, l’explication est à chercher dans les comportements d’exploration : la pression évolutive aurait sélectionné les conduites qui anticipent d’éventuelles modifications des conditions environnementales. Le sujet échange ainsi un peu d’efficacité immédiate contre de l’information qui peut lui servir plus tard. Pour les économistes la réponse est plus complexe. Il s’agit d’une incapacité à appréhender la totalité des options du problème, associée à des biais qui obscurcissent le jugement.
Mais la vraie réponse est à rechercher dans le substrat de nos décisions : le cerveau. Dans cette optique, j’aborde le problème en le réduisant à une question fondamentale : « Qu’est ce que décider à l’échelle du tissu nerveux? ». C’est là se poser la question de l’émergence du processus de décision.
«Qu’est ce que décider à l’échelle du tissu nerveux? C’est là se poser la question de l’émergence du processus de décision».
La neurodécision et le hasard
Pour étudier la décision à l’échelle des réseaux de neurones, il nous faut réduire sa définition à l’essentiel : un choix entre deux ou plusieurs options. Grâce à cette approche volontairement réductionniste, nous pouvons mettre en évidence les principes qui permettent au système nerveux de produire des décisions.
Ces principes reposent sur des processus de compétitions entre plusieurs populations de neurones, chacune permettant de produire un comportement. La sélection de l’un de ces processus aux dépens des autres se fait par l’activation de certaines populations et l’inhibition de d’autres. Mais rien ne serait possible sans le hasard.
De fait, le moteur initial qui permet au système de basculer vers une décision ou une autre repose sur un processus aléatoire. L’apprentissage permettra ensuite de favoriser la décision la plus intéressante en fonction du contexte, mais il ne contrebalancera jamais totalement cette part d’aléatoire qui est intrinsèque au système de décision. On a constaté, par exemple, que ce système comporte beaucoup plus de bruit que le cortex moteur ou visuel. Il en résulte un système sub-optimal, si l’on s’en tient à des critères purement économiques, qui est incapable d’optimiser ses choix. Mais un système bruité est-il nécessairement un inconvénient?
Une mise en perspective évolutionniste permet d’identifier le réseau qui gère des décisions très élémentaires, dès les premiers vertébrés. Ce réseau se complexifie ensuite au fur et à mesure de l’évolution. L’apparition du cortex chez les mammifères et son extraordinaire développement chez les grands singes aboutissent à des capacités d’abstraction qui culminent chez l’espèce humaine. Cependant, cela ne modifie pas l’architecture initiale du réseau de la décision, et le processus conserve sa nature stochastique, ce qui limite la capacité de l’homo sapiens à raisonner de façon rationnelle.
Paradoxalement, cette prétendue irrationalité, une sorte de neuro-principe d’incertitude, n’est peut-être pas si désavantageuse qu’on pourrait le croire, car elle permet de basculer aisément d’un état à l’autre, et de modifier une décision promptement. De fait, il s’agit du prix à payer pour conserver une grande capacité d’adaptation qui est la principale marque de fabrique de l’espèce humaine.
«Paradoxalement, cette prétendue irrationalité, une sorte de neuro-principe d’incertitude, n’est peut-être pas si désavantageuse qu’on pourrait le croire, car elle permet de basculer aisément d’un état à l’autre, et de modifier une décision promptement».
Thomas Boraud, directeur de recherches au CNRS, est un neurobiologiste spécialiste de l’activité neuronale. Il dirige une équipe de recherche à l’Institut des maladies neurodégénératives de l’université de Bordeaux dont les travaux portent sur l’identification des substrats neurobiologiques des processus de prise de décision.
Lecture : Manuel de reconstruction pour le XXIe siècle
Lecture en lien direct avec les recherches de l’IRASD.
« Le problème majeur auquel les survivants [d’une apocalypse] devront faire face, écrit Dartnell, est intrinsèque à l’organisation de nos sociétés : le savoir humain est collectif, disséminé dans l’ensemble de la population. Aucun individu pris isolément ne connaît suffisamment de choses pour perpétuer seul les processus essentiels de toute une société. »
Lewis Dartnell. Petite encyclopédie du savoir minimal pour reconstruire le monde. Traduit de l’anglais par Sébastien Guillot, JC Lattès Paris, 2015, 456 pages
http://www.ledevoir.com/culture/livres/465307/manuel-de-reconstruction-pour-le-xxie-siecle
Manuel de reconstruction pour le XXIe siècle – Le Devoir

La sécurité civile ne se lasse pas de planifier le pire. Après le Québec se préparant à une attaque de zombies (sans blague !), c’était au tour de l’Île-de-France de sombrer théoriquement sous l’eau cette semaine. Qu’elle surgisse d’un virus, de cataclysmes ou d’une attaque, de quels savoirs aurions-nous besoin pour redevenir une civilisation en cas d’apocalypse ? Petit ABC du progrès.
Diderot voyait en sa magistrale Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des arts et des métiers (de 1751 à 1772) LE livre permettant de sauvegarder l’intégralité du savoir humain de l’époque, et de le transmettre. Le vulgarisateur scientifique Lewis Dartnell, aussi chargé de recherche à l’Agence spatiale britannique à la ville, s’est amusé avec humour et ambition à refaire l’exercice, façon XXIe siècle dans À ouvrir en cas d’apocalypse (JC Lattès). En creux, l’ouvrage expose l’absurdité de l’individualisme de l’humain contemporain qui, seul, n’est rien et ne peut à peu près rien.
L’apocalypse, et après ? C’est par cette boutade catastrophico-je-m’en-foutiste que ce diplômé de l’Université d’Oxford démarre son exercice mental aussi amusant qu’instructif. «Le problème majeur auquel les survivants [d’une apocalypse] devront faire face, écrit Dartnell, est intrinsèque à l’organisation de nos sociétés: le savoir humain est collectif, disséminé dans l’ensemble de la population. Aucun individu pris isolément ne connaît suffisamment de choses pour perpétuer seul les processus essentiels de toute une société.»
L’auteur rappelle à notre mémoire l’essai Moi, le crayon (1958), où l’économiste Leonard Read illustrait la métaphore de la main invisible : «Avec la dispersion des matières premières et des méthodes de production, il n’existe pas une seule personne à la surface de la Terre qui possède les compétences et les ressources nécessaires pour fabriquer même le plus simple des outils.» L’explosion depuis des communications, des transports et des échanges commerciaux a compliqué les choses, et des millions de petites mains anonymes se sont ajoutées pour tisser la toile de notre économie de marché.
Résultat ? Même les survivialistes les plus entraînés seraient fort désarmés s’ils devaient repartir de zéro, comme Thomas Thwaites en avait fait le pari en 2008 en tentant de fabriquer, à partir de rien, un objet aussi simple qu’un grille-pain. Imaginez alors reconstruire toute une société. Le bouquin, en plus de survoler une petite histoire des découvertes, propose un «b.a.-ba de la science et de la technologie qui, alors même que le savoir se spécialise toujours davantage, nous paraît souvent de plus en plus inaccessible».
Les solutions proposées par Dartnell obligent souvent à remonter le temps ; à adopter non pas les technologies les plus récentes, trop complexes ou miniaturisées, mais celles d’avant, qui ne demandent que des connaissances de base et sont moins énergivores. Une régression technologique, croit le spécialiste en astrobiologie, serait en effet un détour obligé.
Comme l’a fait la Moldavie, lors de la chute de l’Union soviétique, quand ses habitants ont récupéré les machines, devenues artefacts dans les musées (rouets, métiers à tisser, barattes) pour regagner leur autonomie. Un événement qui a aussi privé Cuba d’équipements et de combustibles fossiles, forçant le pays à redévelopper rapido sa « puissance animale » pour contrer une crise du transport et de l’agriculture mécanisée.
Plus récemment, pendant la guerre de Serbie, dans la ville de Gorazde, assiégés pendant trois ans, les habitants ont construit des installations hydroélectriques de brousse : «Des plateformes flottant sur la Drina amarrées aux ponts de la ville, agrémentées de roues à aubes improvisées actionnant des alternateurs de voiture.» Un système D, semblable aux moulins flottants médiévaux, apparus en plein milieu des années 1990.
Pour un exercice radical, Lewis Dartnell propose de se propulser, postapocalypse, au-delà de la période de grâce, une fois que les épiceries, pharmacies, magasins, entrepôts et réservoirs d’essence auront été pillés, une fois les réserves épuisées. Comment refaire de zéro ? D’abord, en se réunissant. Il faudra être légion, autant pour aspirer à repeupler la Terre que pour avoir assez de bras, afin que certains s’occupent de la production agricole pendant que d’autres travaillent à la restauration technologique. «Une population initiale d’environ 10000 individus regroupés dans une même zone», estime l’auteur, serait le minimum requis. Pour le Québec, cela équivaudrait à un taux de survie nécessaire de 1,21 %.
Les essentiels
L’agriculture devra forcément être une priorité. «Sans surplus de nourriture, aucune société ne sera en mesure de progresser, de se recomplexifier, rappelle l’essayiste. Quand faire pousser de quoi manger demeure une priorité absolue — quand c’est sa vie même qui en dépend —, on est en général beaucoup moins disposé à expérimenter de nouvelles solutions. Nombre de nations pauvres sont d’ailleurs de nos jours engluées dans ce piège.»
Deux bras pour nourrir dix bouches, permettant à 20 mains de s’activer ailleurs, semblerait un ratio productif. On comprend pourquoi Dartnell estime que la moissonneuse-batteuse reste une des inventions les plus importantes, puisqu’elle libère et allège le labeur et le labour des champs.
N’en déplaise aux gourmands, manger n’assure pas un retour à la civilisation, et les besoins sont forcément plus variés. Nombreux et urgents. Lewis Dartnell aborde, outre l’agriculture, le choix d’un lieu (oubliez les villes, visez la proximité des points d’eau), la nourriture (oubliez le café, pauvres drogués légers ; déjà le sel, le sucre et le vinaigre, essentiels à la conservation des aliments, vous demanderont bien des heures de travail), les vêtements, les substances (l’essentiel savon, qui évitera d’attraper tout ce qui passe comme virus, exigera que vous fassiez des alcalis, la potasse et la soude étant les plus faciles à produire), les matériaux (ne négligez pas le verre, vous en aurez besoin pour fabriquer votre protomicroscope, afin de relancer la médecine…), la médecine (retour à l’herboristerie à coups d’essais-erreurs, et à l’horreur des accouchements même avec vos forceps maison…), la puissance (roue à aubes, machine à vapeur, électricité, etc.), les transports, les systèmes de datation et de localisation (car il n’est pas si simple de savoir répondre au si classique « où suis-je ? »), les systèmes de mesure. Entre autres.
C’est en croisant toutes les trouvailles que cette nouvelle société créera sa propre histoire. Nos machines «complexes se résument au bout du compte à un assemblage d’éléments mécaniques de base, d’origines extrêmement diverses, mais disposés selon une configuration inédite permettant de résoudre» un nouveau problème.
Lewis Dartnell s’amuse à en faire la démonstration en démontant les principes d’une automobile. «Si vous décollez la peau d’une toute nouvelle voiture de sport, le genre à représenter pour vous le top de la technologie moderne, vous trouverez dessous tout un méli-mélo d’éléments dont l’époque de conception ne vous rajeunira guère: les roues de potier, les scieries romaines, les marteaux à bascule, les tours à bois et les clepsydres», écrit-il.
L’auteur rappelle dans la foulée que les ères de grandes avancées, où les technologies se croisent et évoluent, restent en larges parts inexplicables. Comment la Chine, avec l’invention du collier de cheval moderne, la brouette, le papier, les caractères d’imprimerie, la boussole de navigation et la poudre à canon a-t-elle pu atteindre, vers la fin du XIVe siècle, un niveau que l’Europe ne connaîtrait pas avant le XVIIIe ? Part de génie, part de hasard, part de chance.
Et, présume l’auteur, même avec les connaissances de base de notre civilisation, il est à peu près impossible qu’une nouvelle humanité reprenne le même chemin que celui qui a été emprunté. Les découvertes se feraient autrement, leurs arrimages aussi. Impossible de réécrire l’histoire, même en gardant les ingrédients et certaines recettes, car les circonstances, favorables ou non, seraient immanquablement différentes.
Toute civilisation s’érige grâce à l’accumulation, semble sous-tendre le propos de Dartnell. Accumulation de réserves alimentaires, qui laisse du temps pour penser. Accumulations de savoirs, de techniques, qui, se mariant, en produisent de nouveaux. Mais quelle est la limite ? Celle au-delà de laquelle une société chavire et passe soudainement des provisions au trop-plein, des réserves à la surconsommation létale ? À nous, peut-être, un à un et par légion, de répondre.
Pourquoi il faut en finir avec le capitalisme
Une excellente analyse à lire!
http://www.concoursphilosopher.com/pourquoi-il-faut-en-finir-avec-le-capitalisme/
Pourquoi il faut en finir avec le capitalisme
Par Simon Tremblay-Pepin, chercheur à l’IRIS

Simon Tremblay-Pepin
Le mouvement Occupy Wall Street, celui des Indignados en Espagne et la mobilisation étudiante de 2012 au Québec sont, chacun à leur façon, des exemples de remises en question du capitalisme. Ce texte parvient également à la conclusion, après évaluation, que le capitalisme doit être remisé au profit de nouvelles avenues. Après avoir établi la nécessité de critères pour juger du capitalisme, je considère son efficacité (déficiente) de l’angle de la production, de la consommation, de la répartition des ressources et de la viabilité écologique.
Juger le capitalisme est complexe pour deux raisons. Tout d’abord, ce système économique se confond avec l’ensemble de notre société : il façonne notre mode de vie, nos pensées, nos interactions et notre identité. Ensuite, nous ne connaissons pas d’autres systèmes économiques attrayants qui ont été implantés dans toute une société. Une évaluation comparative du capitalisme exigerait donc de périlleuses comparaisons historiques. Malgré ces deux difficultés majeures pour poser un jugement réfléchi sur le capitalisme, il est possible d’en mesurer l’efficacité en le comparant à la conception théorique de ce que devrait permettre un système économique.
En l’absence d’autres systèmes économiques avec lesquels comparer le capitalisme, il est possible de comparer sa réalité concrète à des objectifs théoriques que nous souhaiterions qu’un système économique atteigne. En effet, dans l’objectif de répondre aux besoins des êtres humains, l’économie doit permettre de (1) produire des biens, (2) les consommer et (3) d’allouer les ressources de façon à réduire les pertes lors de ces deux activités. L’efficacité du capitalisme dans l’accomplissement de chacune des « tâches » d’un système économique est cruciale pour porter notre jugement.
L’actuelle crise écologique, soulignée à nouveau lors de la récente Conférence de Paris, suggère un quatrième critère qui n’est apparu que récemment en théorie économique : la pérennité environnementale. Notre système économique, notre façon d’organiser l’économie, ne peut parvenir à répondre à nos besoins à long terme s’il met en danger notre capacité de survie. Portons maintenant un jugement sur l’efficacité du capitalisme sur la base des quatre critères que nous venons de présenter.
Le capitalisme n’organise pas la production de façon optimale. La propriété privée des moyens de production est l’un des fondements du capitalisme. Certaines personnes possèdent des outils (ordinateurs, marteaux, caisse enregistreuse) et des lieux de travail (usine, tour à bureau, boutique) et embauchent d’autres individus pour réaliser la production. La grande majorité d’entre ces derniers n’ont que peu de possibilités d’influer sur la façon dont est organisée la production et, donc, leur travail quotidien. En dernière instance, la décision revient au patron et tout le monde le sait bien.
Cette absence de démocratie dans les milieux de travail a plusieurs conséquences négatives sur la production. D’abord, la dévalorisation des travailleuses et travailleurs du fait qu’on ne tienne pas compte de leur opinion les empêche de se réaliser pleinement dans leur emploi. Elles deviennent donc malheureuses. Conséquemment, on dépense des ressources inutilement à employer des cadres, des patrons et des surveillants qui sont payés, non pas pour des tâches productives, mais bien à surveiller l’exécution du travail des autres qu’on soupçonne de fainéantise. Ensuite, les idées et projets de la vaste majorité des personnes qui travaillent n’ont pas l’occasion d’être réalisés, et l’humanité ne bénéficie pas de leur diversité et de leur créativité.
Le capitalisme ne permet pas une consommation adaptée à la réalité sociale des êtres humains. Les êtres humains sont des animaux sociaux. Non seulement ils vivent en bande, mais en plus ils appréhendent leur réalité grâce à des institutions sociales : le langage, la politique, la ville, la monnaie, etc. Or, la consommation au sein du capitalisme est complètement individualisée. Nous pensons à nos moyens et à nos besoins en terme strictement individuels, déliés de rapports sociaux : comment vais-je faire pour réaliser tout ce que je désire avec mon chèque de paie? Ainsi, tout le monde pense séparément à satisfaire ses besoins de façon individuelle, alors que des solutions collectives seraient plus efficaces.
Le transport est un bon exemple. On peut se dire au sein du capitalisme : je dois me rendre au travail, j’ai donc besoin d’une voiture. Tout le monde arrive à la même conclusion, et on se retrouve bloqué dans la circulation à polluer et à arriver en retard à nos rendez-vous parce qu’il y a trop de voitures. Une approche alternative serait de réunir toutes les personnes qui habitent un quartier pour qu’elles conçoivent, avec l’aide d’experts, un système de transport en commun qui permette à tout le monde de se rendre au travail sans avoir de circulation, sans polluer et sans que qui que ce soit ne soit en retard à ses rendez-vous. Le capitalisme ne permet pas une telle consommation collective. L’État tente de compenser en jouant ce rôle, mais il le fait généralement d’une façon technocratique et non démocratique, ce qui fait que les besoins réels des gens ne trouvent pas là non plus un espace où être exprimés.
Le capitalisme ne permet pas d’allouer les ressources de manière à combler les besoins de tous et toutes. Le moteur du capitalisme est l’accumulation de l’argent. Il s’accumule en exploitant des ressources et le travail des individus pour produire des marchandises qu’on vend à d’autres à profit. On ne produit pas des biens d’abord parce qu’ils seraient utiles, ou nécessaires ou importants, on les produit d’abord parce qu’il existe une demande et que la clientèle potentielle est prête à payer un prix suffisant pour dégager un profit. Ce qui compte pour les entreprises au sein du capitalisme c’est l’argent que les individus peuvent investir pour se procurer une marchandise et non son utilité pour l’humanité.
En effet, le capitalisme ne permet pas de différencier les besoins prioritaires des désirs secondaires ni, en conséquence, d’allouer les ressources de manière à combler les besoins de base de tous et de toutes. Les famines dans certains pays en développement couplées au gaspillage alimentaire dans le monde occidental sont une démonstration suffisante de l’inefficacité du capitalisme dans la répartition des ressources.
Le capitalisme met en danger la survie des êtres humains. De toute évidence, le bilan environnemental du capitalisme est très mauvais : les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie pétrolière causent un réchauffement climatique qui s’annonce dévastateur tant pour la faune et la flore que pour les collectivités côtières. Deux solutions sont proposées par les tenants du capitalisme. D’une part, les vertues présumées de ce système pour l’innovation pourraient être mises à profit pour développer de nouvelles technologies qui éliminent la pollution. Par exemple, les CFC des réfrigérateurs ont été remplacés lorsqu’il a été démontré que ces gaz étaient à l’origine du trou dans la couche d’ozone. D’autre part, les coûts de la pollution pourraient être internalisés de manière à rendre moins profitables les biens et services qui polluent.
Toutefois, ces « solutions » – dont ont pourrait débattre la valeur intrinsèque – ne résolvent pas la contradiction fondamentale du capitalisme. La production de bien n’y est pas réalisée comme une fin en soi, mais bien comme un moyen de faire plus d’argent. Chaque entrepreneur·e est poussé à faire plus de profit pour éviter de périr aux mains de son concurrent, collectivement les entrepreneur·e·s ont une soif infinie de profit. Ils vont toujours vouloir en faire plus pour se battre entre eux. Or, les ressources planétaires dont ils ont besoin pour continuer à entrer en compétition les un·e·s contre les autres sont, elles, limitées. Il est contre la nature même du capitalisme de planifier collectivement comment nous utiliserons les ressources pour mieux les préserver. Exiger cela du capitalisme, c’est demander à un tigre de devenir végétarien. Si nous ne l’arrêtons pas, si nous succombons encore et toujours à son appétit pour l’accumulation, il rendra cette planète invivable pour plusieurs d’entre nous et provoquera famines, guerres et catastrophes.
Bref, quel jugement devenons-nous porter sur le capitalisme? À la lumière des quatre critères de fonctionnement d’un système économique que nous avons établi (la production, la consommation, la répartition des ressources et la viabilité écologique), le capitalisme est un système inefficace. Comme nous l’avons fait pour d’autres systèmes économiques qui l’ont précédé dans l’histoire de l’humanité, il vaut mieux maintenant le laisser derrière nous avant qu’il ne nous emporte.
Des options de remplacement à ce système ont germé en lui depuis suffisamment longtemps pour que nous puissions nous en saisir et les réaliser : des milieux de travail démocratiques comme les coopératives de travail, des organismes facilitant la consommation collective comme les coopératives de consommation et des budgets participatifs pour assurer la meilleure répartition des ressources selon les besoins de la collectivité. Ces options démocratiques et écologiques doivent être mieux pensées, plus souvent mises en pratique et approfondies, mais elles existent et sont plus prometteuses que de continuer avec ce système économique dysfonctionnel.
Note : Je tiens à remercier Marie Léger-St-Jean pour son aide avec ce texte, sans elle il n’aurait jamais eu les quelques qualités qu’une lecture généreuse pourra lui trouver.
Le « burnout », une conséquence des concepts et mécanismes erronés de la société
Le burnout* est un ensemble complexe de conséquences psychologiques découlant de problèmes comportementaux individuels ayant ses origines dans l’éducation, la culture et la société. Ces comportements déviants sont induits par la combinaison de concepts et mécanismes de société erronés dont le travail, la recherche de performance ou d’objectifs promotionnels, le besoin de satisfaire les autres et la pression fiscale de l’économie monétaire en sont quelques-uns des principaux.
Une des hypothèses de recherche de l’IRASD est que l’espèce humaine ne pourra jamais s’adapter complètement à son environnement social. D’une part parce que l’environnement social est incompatible avec l’environnement humain et d’autre part parce qu’il évolue plus rapidement que la capacité d’adaptation comportementale de l’espèce.
La principale cause viendrait du fait que les concepts et mécanismes qui définissent la société humaine sont incompatibles avec ceux de l’environnement humain. Ces concepts et mécanismes erronés qui changent constamment dépassent la capacité d’adaptation comportementale et les possibilités génétiques de l’espèce humaine.
On observe donc des tentatives chez l’humain d’adaptations à son environnement social qui se font de manière erronée ou incomplète ce qui résulte en des stratégies comportementales déviantes avec les problèmes psychologiques qui découlent des oppositions conflictuelles entre des obligations sociales inventées de toutes pièces et la capacité de maintenir l’équilibre fonctionnel naturel de l’individu.
En conséquence, il n’y a absolument rien de flou dans le burnout*, au contraire! Ce qui demeure flou, c’est le consensus que la communauté scientifique doit adopter afin de définir les causes et facteurs qui déclenchent les symptômes et conditions du burnout* afin de pouvoir classifier cet ensemble comme une « maladie » ou une « condition » psychosociale anormale requérant des soins particuliers.
Inversement, les travaux de recherche de l’IRASD visent à identifier les concepts et mécanismes de société erronés qui interagissent avec la nature humaine pour induire des stratégies comportementales déviantes. Il est évident que d’innombrables concepts et mécanismes erronés ou combinaisons nocives induisent de telles stratégies comportementales.
Il est plausible de s’attendre à un accroissement du nombre de cas d’individus atteints par le « burnout ». En effet, la dégradation de l’intégrité de l’environnement social, provoquée par les concepts et mécanismes erronés qui le constituent, est les causes directes des déséquilibres psychosociaux et des déviances comportementales induites chez l’humain.
Si on peut identifier et soigner le burnout, on ne réussira jamais à éradiquer cette maladie psychosociale découlant de stratégies comportementales déviantes induites par des concepts de société erronés. L’architecture de société est une des seules avenues qui doit être envisagée pour concevoir de nouveaux concepts et mécanismes de société qui puissent induire des adaptations comportementales favorisant un meilleur équilibre entre les environnements humain, biophysique et social.
* https://www.google.ca/search?q=burnout&safe=strict&gws_rd=cr,ssl&ei=PIfEVrH4CoWzePTkrJgC
.
Le burn-out, un concept flou que l’Académie de médecine veut préciser
L’Académie de médecine a réclamé mardi 16 février 2016 davantage de recherches sur le burn-out, un concept flou non reconnu à ce jour comme une pathologie médicale, alors même qu’il donne lieu à des symptômes désormais bien connus comme l’épuisement émotionnel ou la dépersonnalisation. « L’expansion du terme « burn-out » est une source de confusion en raison des limites imprécises de cette réalité », relève l’Académie de médecine dans un rapport publié sur ce sujet, avant de faire une série de propositions pour améliorer la prévention et la prise en charge du phénomène. « C’est une grande souffrance dont l’ampleur est très mal évaluée (…). On n’a pas une idée de son importance, beaucoup de chiffres ont été cités », relève pour sa part le psychiatre Patrick Légeron, l’un des auteurs du rapport.
30.000 personnes touchées par le burn-out ?
Les estimations qui circulent vont de 30.000 personnes touchées par le burn-out, selon l’Institut de veille sanitaire (InVS), à trois millions, selon un cabinet spécialisé dans la prévention des risques professionnels. Il est en outre difficile de faire la part des choses entre des symptômes comme la fatigue ou le mal-être au travail et ce qui relève d’une « vraie maladie » nécessitant la prise de médicaments, ajoute le Pr Légeron. A ce jour d’ailleurs, aucun pays n’a encore reconnu le burn-out comme une maladie. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) établit pour sa part une distinction entre la détresse psychologique, non pathologique, et les troubles mentaux.
Pour jouer un rôle plus efficace dans la prévention du burn-out, l’Académie préconise le développement de programmes spécifiques de recherche, une meilleure collaboration entre la direction des entreprises et les médecins du travail, ainsi que la mise en place d’une structure rassemblant les ministères concernés et notamment le ministère de la santé, resté silencieux sur cette question jusqu’à présent.
Vers la reconnaissance d’une maladie professionnelle ?
L’Académie relève également qu’au-delà des risques psychosociaux liés au travail, il existe des risques de burn-out inhérents à chaque personne (surinvestissement dans le travail, antécédents psychopathologiques) et que les antidépresseurs ne sont pas forcément la solution. Ils peuvent être prescrits pour des dépressions d’épuisement, mais pas forcément pour un état de stress prolongé, les deux maladies qui se rapprochent le plus du burn-out aujourd’hui. « Même si ce n’est pas pour demain, on peut imaginer qu’un jour, lorsqu’on aura davantage de connaissances sur le burn-out, on pourra peut-être le reconnaître comme une entité précise au sein de troubles psychiatriques » ou encore comme une « forme particulière de dépression », note le Pr Légeron. Cela permettra notamment de le faire reconnaître comme une maladie professionnelle, ce qui n’est pas le cas actuellement « puisqu’il n’a pas été identifié comme une maladie », ajoute-t-il.
L’engagement : satisfaction, croissance personnelle et apprentissages
En cette fin d’année 2015, l’IRASD souhaite que les individus engagés dans la lutte et la recherche ne perdent pas espoir et soient inspirés à renouveler leurs engagements chacun à sa manière dans la mesure de ses capacités en tant que citoyen actif contre les déviances comportementales induites par les concepts et mécanismes erronés de notre civilisation.
Il est essentiel de ralentir la croissance dommageable de la civilisation humaine dont l’environnement social prend le dessus sur les environnements humain et biophysique en altérant dangereusement les équilibres naturels qui garantissent le maintien de la vie.
Ce ralentissement de la croissance permet de gagner du temps précieux pour préparer la modernisation réformatrice de la civilisation humaine appuyée sur l’architecture de société.
- La première étape est de comprendre ce qui a mené l’espèce humaine à évoluer et progresser jusqu’à sa situation actuelle.
- La seconde étape est d’architecturer des concepts et mécanismes de société durables intégrés à ces connaissances.
- La troisième étape est de planifier et réaliser la transition vers un nouveau modèle de société durable adapté aux lois naturelles immuables et instransgressibles des environnements humain et biophysique.
Ce programme s’échelonne sur quelques décennies. L’espèce humaine ne dispose pas de ce temps pour le réaliser si des individus ne s’engagent pas ou ne maintiennent pas leur engagement. La lutte contre l’assimilation psychosociale des comportements par les concepts et mécanismes de l’environnement social est donc essentielle.
L’IRASD remercie tous les individus engagés et encourage tout nouvel engagement en confirmant qu’il apporte une satisfaction, une croissance personnelle et des apprentissages dignes de l’espèce humaine qui sont indispensables pour notre survie et notre évolution.
http://www.journaldemontreal.com/2013/12/27/lengagement-rend-heureux-quon-se-le-dise
L’engagement rend heureux, qu’on se le dise
Lettres
LAURE WARIDEL, COFONDATRICE D’ÉQUITERRE
Vendredi, 27 décembre 2013 20:58MISE à JOUR Vendredi, 27 décembre 2013 21:07
Le bonheur. Nous sommes tous à sa recherche plus ou moins consciemment. Nous le souhaitons à ceux et celles que nous aimons. Surtout maintenant.
Et si nous nous souhaitions aussi d’être plus «engagés»? De consacrer davantage de notre temps et de nos talents pour construire ensemble un Québec plus juste, plus généreux, moins pollué? Celui dont nous rêvons pour nos enfants et petits-enfants. Et si, de surcroît, ces gestes posés pour le bien commun augmentaient notre «bonheur intérieur brut par habitant»?
ACTION CITOYENNE
De nombreuses études en psychologie et en sociologie établissent un lien positif entre l’engagement social et le bonheur. Quel que soit l’âge, le statut économique ou le sexe, il semble en effet que la participation sociale de chaque individu influence positivement son niveau de satisfaction dans la vie. Que l’on soit impliqué bénévolement au sein d’un comité de citoyens, une organisation environnementale, une association sportive, une coopérative, un syndicat, un parti politique, une fondation ou autre, il s’y crée des liens qui favorisent l’épanouissement. Se sentir utile fait du bien.
L’implication citoyenne entraînerait aussi une meilleure intégration sociale et contribuerait à prévenir la dépression. Rien de moins! Toutes ces conclusions sont tirées d’articles publiés dans des journaux scientifiques aussi variés que le Social Science & Medicine, la Revue québécoise de psychologie et le Journal of Health and Social Behavior.
Ces phénomènes s’observent clairement sur le terrain de l’action citoyenne. J’y ai vu beaucoup d’yeux briller… Je pense à ceux de Laurent, au Saguenay. Ce «travailleur de l’Alcan» a senti un grand vide quand la retraite est arrivée. Heureusement, il y a eu les réparations à la chapelle. Boîte à lunch dans une main et coffre à outils dans l’autre, Laurent a pu repartir le matin. Cette fois pour rejoindre d’autres bénévoles pour restaurer cette chapelle qui est devenue une magnifique salle de concert. Ensuite, il y a eu la Coop de solidarité du Lac-Kénogami, où Laurent continue de «s’engager».
CONTESTATION
Je pense aussi à Louise, qui a fondé La Guilde du Pain d’Épices dans Lanaudière. Ses délicieux biscuits bioéquitables sont en fait un prétexte pour donner le goût de lire et d’apprendre aux enfants. Je pense à Loulou, qui a commencé à travailler à La rue des Femmes à Montréal comme bénévole en y servant des repas. Elle y œuvre maintenant comme intervenante. Je pense à Hélène, qui était mon entraîneuse d’athlétisme au secondaire. Elle a évité à combien de jeunes de décrocher?
Et je pense à tous ces gens qui s’impliquent de mille façons, parfois aussi dans la contestation. On ne se fait pas que des amis en s’opposant fermement à un système qui carbure à l’exploitation environnementale et sociale. Cela demande beaucoup de courage d’être un David contre Goliath. Et de colère aussi. Mais surtout d’amour…
À vous toutes et tous qui vous «engagez», je profite de cette tribune pour vous dire: Merci d’exister!
L’architecture de société peut éviter l’effondrement de la civilisation
Les recherches en Anthropocène pour comprendre la réalité humaine ouvrent la porte aux applications en architecture de société pour éviter l’effondrement de la civilisation.
L’effondrement de la civilisation humaine est prévisible depuis plusieurs décennies, mais les modèles appuyés sur des données scientifiques (https://irasd.wordpress.com/2015/08/05/synthese-des-donnees-planetaires-adrastia/) sont encore très récents et associés aux recherches sur l’Anthropocène. L’Association Adrastia (http://adrastia.org/) travaille depuis un peu plus d’un an à préparer l’humain à cet effondrement pour qu’il soit vécu avec dignité.
Les modèles prévisionnels permettent de calculer avec une forte probabilité que l’effondrement de la civilisation humaine se produira si rien n’est changé. Or, l’espèce humaine s’adapte à ses environnements et ne peut absolument rien changer aux lois immuables et intransgressibles de l’environnement biophysique. Par contre, il est théoriquement possible et parfaitement envisageable de modifier drastiquement les concepts et mécanismes de la société humaine pour forcer l’adaptation des stratégies comportementales de l’espèce.
En conséquence, l’IRASD a choisi de poursuivre ses recherches en Anthropocène afin de décrire les environnements humain, biophysique et social pour comprendre leurs interactions afin d’identifier les concepts et mécanismes qui induisent par adaptation chez l’humain des stratégies comportementales déviantes.
Cette compréhension ouvre la porte à un monde de possibilités d’applications concrètes pour architecturer de nouveaux concepts et mécanismes de société favorisant des adaptations psychosociales menant à l’adoption de stratégies comportementales favorables au maintien des équilibres vitaux entre les environnements humain, biophysique et social.
Toutefois, le temps qui s’écoule et le manque d’implication des chercheurs pour accomplir les travaux de l’IRASD contribuent à accroître la probabilité de l’effondrement de la civilisation humaine parce que l’accélération de la croissance s’oppose à la lenteur du processus de l’IRASD.
En l’absence d’un freinage important de la croissance de la civilisation humaine, ce qui implique le démantèlement de l’économie monétaire et de la politique représentative, et sans une accélération importante des travaux de l’IRASD, il devient de moins en moins envisageable que les résultats de recherche puissent être applicables à temps dans une démarche d’architecture de société durable afin d’éviter l’effondrement de la civilisation et l’extinction de l’espèce humaine.
L’inertie considérable de l’espèce humaine et sa très lente évolution par adaptation de ses stratégies comportementales vient du fait que l’humain est presque exclusivement adapté à son environnement social, que ses comportements altèrent les équilibres entre l’environnement humain et l’environnement biophysique en dépassant de plus en plus les limites vitales de l’écosystème et que l’environnement social ne change pas pour corriger cette situation.
Au contraire, la société humaine surfe sur la vague virtuelle de la croissance de son économie monétaire et de son progrès technique, ce qui induit chez l’humain l’erreur cognitive de croire qu’il s’agit là d’évolution alors qu’il n’en est rien. Les phénomènes comportementaux observés révèlent que le progrès de la civilisation nuit considérablement à l’évolution parce qu’il permet à l’espèce humaine de flotter psychologiquement au-dessus des contraintes réelles des lois immuables et instransgressibles de la nature, laissant à l’humain la fausse impression d’être omniscient et omnipotent dans le contrôle de son univers. (https://irasd.wordpress.com/2015/12/02/le-progres-de-la-civilisation-nuit-a-levolution-de-lespece-humaine/)
Cette inertie prouve que les stratégies comportementales humaines sont adaptées à son environnement social et non à son environnement biophysique. Les conséquences induisent dans l’environnement humain des stratégies cognitives erronées qui mènent à des stratégies comportementales déviantes.
Sans une introspection par les connaissances scientifiques généralisée au plus grand nombre d’individus de l’espèce humaine, l’effondrement ne pourra être évité et la survie sera à haut risque.
L’IRASD poursuit toutefois ses travaux, car si elle n’arrive pas à temps à redresser la situation, elle léguera au moins à l’humanité la compréhension des raisons de l’effondrement de sa civilisation.
.
http://www.tvanouvelles.ca/2015/12/24/bientot-la-chute-de-la-civilisation-moderne
Bientôt la chute de la civilisation moderne?
La civilisation moderne telle que nous la connaissons sera anéantie dans un avenir très rapproché, prédit une nouvelle étude.
Des chercheurs de l’Université du Maryland et de l’Université du Minnesota en arrivent à cette conclusion dans une étude menée grâce à la contribution d’outils de recherche utilisés par la NASA, rapporte le quotidien britannique The Guardian.
En analysant cinq facteurs de risque, soit la population, le climat, l’eau, l’agriculture et l’énergie, l’étude rapporte qu’un écrasement soudain des structures sociétales peut survenir lorsque ces facteurs convergent pour former deux critères importants.
Le rapport indique que toutes les sociétés disparues depuis 5 000 ans ont été le résultat d’un épuisement des ressources causé par la pression mise sur les capacités naturelles de l’écosystème et par une stratification de la société entre les élites (riches) et la masse (pauvres). Les chercheurs prédisent que les élites ressentiront les effets de la destruction environnementale plus tard que les masses, permettant au statu quo de persister plus longtemps malgré la catastrophe inévitable qui se dessine sous leurs yeux.
L’étude suggère de réduire les iniquités économiques pour assurer une distribution équitable des ressources et de réduire substantiellement notre consommation des ressources naturelles en s’appuyant sur des énergies renouvelables et en limitant la croissance de la population.
Les chercheurs concluent néanmoins qu’à la lumière de la situation actuelle, il sera difficile d’éviter la chute de la civilisation moderne.
Évolution, progrès et Anthropocène
L’évolution et l’histoire de l’humanité constituent les piliers de connaissances primordiales pour comprendre la situation actuelle de l’espèce humaine et de sa civilisation. Deux cent ans de recherches en paléontologie, paléoanthropologie, évolution, génétique, biologie, primatologie, anthropologie, psychologie sociale et autres sciences connexes permettent de constituer un tour d’horizon représentatif de l’espèce humaine.
Les deux cent dernières années de l’histoire de l’humanité correspondent aussi à la grande accélération du progrès depuis le début de l’ère industrielle. Ce progrès plus rapide que l’évolution de la capacité cognitive de l’espèce humaine a donné naissance à une nouvelle ère géologique : l’Anthropocène, caractérisée par les cicatrices que laisseront les comportements inadaptés de l’humanité dans les archives géologiques et climatiques de la planète.
L’Anthropocène est la plus paradoxale des époques. D’une part elle amène des progrès immenses, d’autre part elle engendre des conséquences extrêmes. La dichotomie entre les deux s’explique par la compréhension rationnelle du système humain avec l’intégration des connaissances cumulées par la science afin de détailler la nature et le fonctionnement des interactions entre les environnements humain, biophysique et social.
L’évolution démontre l’affiliation de l’humain avec les autres espèces et ses origines de primate. Elle permet de comprendre les fondements génétiques et biologiques des stratégies comportementales de l’homme.
L’histoire de l’humanité regorge de situations pour observer l’adaptation des stratégies comportementales humaines et leurs interactions avec les concepts et mécanismes de société en constante mutation.
L’étude détaillée de ces deux aspects primordiaux intégrés dans leur contexte avec l’apport des sciences naturelles et sociales constitue indéniablement la démarche la plus rationnelle et le moyen le plus objectif de comprendre la situation actuelle du système avec les interactions entre ses environnements humain, biophysique et social dont on observe aujourd’hui les conséquences.
Cette démarche est le cœur des recherches en Anthropocène de l’IRASD visant à décrypter la nature des impacts de l’espèce humaine sur ses environnements. Elle dévoile également toute une panoplie d’interactions comportementales complexes entre l’environnement humain, biophysique et social.
Sans cette compréhension, il devient irréaliste de modifier quoi que ce soit à l’environnement social pour corriger ou mitiger les impacts des stratégies comportementales humaines qui caractérisent l’Anthropocène sans risquer d’empirer la situation qui dégénère au rythme effréné du progrès.
Les intrications culturelles, psychosociales, biologiques et génétiques des stratégies comportementales humaines avec les concepts et mécanismes de son environnement social sont d’une telle complexité qu’il est inévitable d’envisager la nécessité d’une démarche structurée d’architecture de société afin de concevoir de nouveaux concepts et mécanismes de société qui favoriseront l’adaptation des stratégies comportementales humaines.
Telle est la démarche de l’Institut de Recherche en Architecture de Société Durable.
Rien de moins et fort probablement beaucoup plus…
Quelle approche pour réformer l’environnement social humain?
Réformer l’environnement social humain nécessite la compréhension scientifique de sa nature. Se contenter d’expérimentations aléatoires ou se limiter aux cogitations philosophiques est dangereusement insuffisant. La pensée philosophique pourrait aider si elle demeurait les pieds bien encrés dans la réalité biophysique et à condition que la complexité du progrès humain ne soit pas en contradiction avec ses environnements. L’humain n’est pas un esprit immatériel, mais une espèce qui interagit avec les équilibres du réel.
Les outils scientifiques mis en place par les divers domaines de connaissance permettent d’observer et de comprendre les stratégies comportementales de l’espèce humaine dans son environnement social. L’origine, l’adaptation et l’évolution de l’espèce humaine constituent la première clef dont il faut maîtriser la connaissance pour entrouvrir la porte de cette compréhension.
Dans un billet de Jonathan Durand-Folco, blogueur et étudiant au doctorat à la Faculté de philosophie de l’Université Laval à Québec, on peut lire :
Dans son inspirant livre Un million de révolutions tranquilles. Comment les citoyens changent le monde (2012), Bénédicte Manier explore le vaste terrain des alternatives sociales, politiques, économiques et énergétiques qui fleurissent un peu partout dans le monde. Leur principale caractéristique réside dans le fait qu’elles n’émanent pas de l’État ou de l’économie de marché, mais des individus et des communautés qui cherchent à répondre directement à leurs besoins en fonction de normes démocratiques et écologiques. En effet, il semble de plus en plus évident que le blocage institutionnel et politique, de même que l’inertie des grandes entreprises ou le «pseudo-changement » revendiqué par l’économie verte, freinent une véritable transformation du modèle de développement hérité des deux derniers siècles. Bien que l’adjectif durable soit généralement accolé à une croissance toujours présupposée, le discours dominant ne semble pas reconnaître que la durabilité n’implique pas la continuation du capitalisme par d’autres moyens, mais la remise en question radicale de cette forme de société.À première vue, les multiples petites révolutions tranquilles qui fourmillent actuellement ne semblent pas proposer un modèle unifié, un nouveau projet de société, mais une incroyable variété de pratiques parfois insolites.
– Bâtir, habiter et penser la transition par le milieu. Jonathan Durand-Folco, 2015, [En ligne], [https://www.academia.edu/19770504/Ba_tir_habiter_et_penser_la_transition_par_le_milieu].
À l’IRASD, les recherches visent entre autres à identifier pourquoi les structures sociales sont inefficaces pour combler adéquatement les besoins de l’espèce humaine. Les travaux accomplis jusqu’à maintenant tendent à démontrer que les concepts et mécanismes de société sont inadaptés à l’espèce humaine parce que d’une part ils ne respectent pas les principes darwiniens d’adaptation et d’évolution et parce que d’autre part ils ne respectent pas les lois des environnements humain et biophysique.
L’étude des aspects évolutifs, historiques et anthropologiques de l’espèce humaine semble apporter des explications scientifiques tangibles qui tendent à confirmer les raisons pour lesquelles les concepts et mécanismes de la société humaine sont actuellement erronés.
Il ne faut donc pas s’étonner que des groupes d’individus innovent de solutions sociales locales pour améliorer leur sort individuel et collectif. Il s’agit là de réelles adaptations humaines et sociales à un environnement de société inadéquat et en mutation pour lui-même et non au bénéfice de l’espèce.
D’abord, nous observons que les concepts et mécanismes de société interagissent avec la nature humaine pour induire des stratégies comportementales déviantes aux conséquences humaines, environnementales et sociales graves, jusqu’à mettre en péril la pérennité de la civilisation et la survie de l’espèce.
Ensuite, le degré relatif d’évolution de l’espèce humaine est gravement confondu avec le niveau de progrès de sa civilisation. Il en découle une profonde confusion culturelle généralisée entre les concepts d’adaptation, d’évolution et de progrès.
Mais il n’en a pas toujours été ainsi, du moins pas pour tous les aspects de la société humaine. Il faut comprendre que les concepts et mécanismes de société ne sont absolument pas le fruit de l’évolution de l’espèce humaine et n’ont pas été conçus pour favoriser une organisation et un fonctionnement social adapté à l’environnement humain ni à l’environnement biophysique.
Une des erreurs cognitives de l’espèce humaine issue de ses stratégies comportementales est de croire qu’il lui est possible, avec sa seule capacité cognitive à philosopher, de comprendre le monde qui l’entoure sans tenir compte de la réalité biophysique.
«Discours philosophique» et «discours scientifique» ont une même matrice : la «pensée géométrique» (démonstrative), instaurée simultanément par Pythagore et Thalès de Milet. Ce «nouveau» mode de pensée s’est appelé la «rationalité» («pensée/ratio»), et il s’est développé sur le pouvoir de «comparer» les représentations et d’évaluer (critiquer) leur mise en rapport. Quand la philosophie demeure fidèle à son origine, elle «marche sur les pieds» de la science et souscrit au postulat «matérialiste». Mais quand elle «marche sur la tête», comme un «discours religieux», on l’appelle «idéalisme», et elle adopte alors un mode de pensée «dogmatique» incompréhensible et déconnecté du réel.
Cette erreur de la philosophie qui lui a valu son exclusion de la démarche de l’IRASD (https://irasd.wordpress.com/2014/12/17/la-philosophie-est-exclue-de-la-demarche-de-recherche-de-lirasd/) doit largement être compensée par l’observation des faits tangibles et la compréhension du réel avec l’approche scientifique. Cette approche permet concrètement de démontrer que le monde au sens de l’univers décrit par l’humain, n’est ni créé par une intervention divine ni construit par une intelligence créatrice.
Le monde est tout simplement le fruit d’une combinaison complexe et interactive de principes et de lois naturelles évolutives qui ont favorisé l’apparition graduelle de la complexité afin de cristalliser la tendance vers la diminution de l’entropie énergétique résultant du « Big bang » originel.
La genèse du monde n’est donc pas conçue comme l’activité intellective d’un Être suprême, comme une conception formelle qui pourrait être simplement réalisée par le commandement d’une souveraineté divine : « Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut ». Le monde est plutôt le fruit d’une activité pratique, une fabrication, un savoir-faire permettant, par l’expérience, l’effort et la transformation de la matière, de produire une œuvre.
– Bâtir, habiter et penser la transition par le milieu. Jonathan Durand-Folco, 2015, [En ligne], [https://www.academia.edu/19770504/Ba_tir_habiter_et_penser_la_transition_par_le_milieu].
Absolument rien ne permet de poser quelque hypothèse que ce soit, ni dans le sens du créationnisme ni dans le sens du constructivisme.
Seules les stratégies comportementales cognitives humaines, incapables d’accepter l’absence d’explication tangible, peuvent fabuler des croyances aussi variées qu’erronées pour tenter de trouver des explications magiques aux origines de l’univers et de la vie, en compensation de l’absence de compréhension scientifique solide de ces faits réels.
Au-delà de ses croyances erronées, l’humain fait preuve de créativité et parfois d’innovation lorsque sa capacité cognitive n’est pas éradiquée par des stratégies comportementales psychosociales déviantes induites par des concepts et mécanismes de société erronés comme l’économie monétaire capitaliste ou l’organisation administrative hiérarchisée qui en découle :
Ni le marché, ni la logique administrative et hiérarchique ne peuvent créer un monde commun, car celui-ci ne peut naître que des êtres qui construisent et cultivent des milieux dans le but d’y habiter. Le Capital ne vise que sa propre accumulation déterritorialisée, tandis que l’État ne cherche que l’accroissement de son propre pouvoir sur le territoire. S’ils cherchent à s’étendre et même à « faire monde », ce n’est jamais pour y habiter, mais pour le dominer. Seul l’autogouvernement permet aux habitants et habitantes d’établir ensemble, de décider collectivement et de veiller à leur milieu : « Soigner et construire, tel est le bâtir au sens étroit. L’habitation, […] est un bâtir au sens d’une telle préservation » »… La transition n’est pas un défi individuel, mais collectif, qui suppose la mobilisation du milieu et la création de nouvelles formes communes afin d’atteindre une véritable résilience sociale et écologique… » »Sans prétendre que notre projet soit suffisant pour changer le cours des choses, on a la conviction qu’il participe aux explorations qui sont nécessaires à entreprendre. On a besoin de prototypes de foyers de résilience collective. On veut générer ensemble de nouveaux points de départ qui seront porteurs d’avenir (Le Germoir, 2014).
– Bâtir, habiter et penser la transition par le milieu. Jonathan Durand-Folco, 2015, [En ligne], [https://www.academia.edu/19770504/Ba_tir_habiter_et_penser_la_transition_par_le_milieu].
Le problème de cette approche expérimentale empirique appliquée est qu’elle s’appuie exclusivement sur les résultats locaux pour combler des besoins immédiats et qu’elle fait abstraction de la mesure des impacts de ces activités sur les équilibres environnementaux à moyen et long terme.
Sans une connaissance élargie à tous les domaines de la science, aucune architecture de société ne peut être envisagée afin d’assurer une cohésion équilibrée de la symbiose entre les environnements humain, biophysique et social. Le tâtonnement peut être aussi long que l’évolution avant d’aboutir à une version adaptée. Dans l’urgence, c’est une mauvaise approche.
Cette brève excursion au sein des multiples trajectoires de la transition ne saurait être exhaustive, car elle constitue une piste de recherche, voire un chantier théorique et pratique qui suppose un travail collectif d’élaboration, de débats et de réalisation sur le terrain. » »Créer une nouvelle culture ne signifie pas seulement faire individuellement des découvertes «originales», cela signifie aussi et surtout diffuser critiquement des vérités déjà découvertes, les «socialiser» pour ainsi dire et faire par conséquent qu’elles deviennent des bases d’actions vitales, éléments de coordination et d’ordre intellectuel et moral. … (Gramsci, 2012…)
– Bâtir, habiter et penser la transition par le milieu. Jonathan Durand-Folco, 2015, [En ligne], [https://www.academia.edu/19770504/Ba_tir_habiter_et_penser_la_transition_par_le_milieu].
La démarche structurée et rationnelle de l’IRASD, transcende le tâtonnement de l’expérimentation et de la philosophie pour aboutir à la capacité d’architecture de concepts et mécanismes de société qui seront expressément conçus pour favoriser l’adaptation des stratégies comportementales humaines dans une société qui respectera mieux les équilibres avec les environnements humain et biophysique.
Économie du capital humain développée par l’éducation pour l’évolution de l’espèce
Dans une analyse précédente (https://irasd.wordpress.com/2015/12/02/le-progres-de-la-civilisation-nuit-a-levolution-de-lespece-humaine/), nous avons abordé la confusion entre évolution et progrès entretenue par l’espèce humaine dans son environnement social par les concepts et mécanismes de son économie monétaire. La relation entre les stratégies comportementales humaines liées à son évolution et à son histoire explique les raisons de cette confusion et l’origine des choix erronés de l’espèce humaine dans son environnement social.
Un proverbe chinois dit : « L’argent est une richesse morte, les enfants sont une richesse vivante. »
Comme la capacité de survie de toute espèce dépend de l’adaptation de ses individus, la valeur d’une société découle de la capacité d’innovation de ses individus. L’humain est une espèce socialisée qui aurait dû, comme la plupart des espèces vivantes en compétition pour la survie, établir la base de son économie sur le capital humain réel, plutôt que sur le capital monétaire virtuel.
« Le capital humain est l’ensemble des aptitudes, talents, qualifications, expériences accumulées par un individu et qui déterminent en partie sa capacité à travailler ou à produire pour lui-même ou pour les autres. »
(https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Capital_humain)
Il importe d’identifier pourquoi l’espèce humaine a fait le choix erroné de la monnaie pour développer l’économie de son environnement social, plutôt que de miser sur le capital humain. Pour le savoir, il suffit d’étudier la nature comportementale des décisions qui ont poussé l’humain à se doter d’un étalon de valeur aussi irréel.
On trouve des réponses en anthropologie comportementale des premiers primates hominidés et leurs descendants dans l’histoire de l’humanité. La paléo psychologie sociale permet également d’approfondir ces comportements humains étalés dans le temps.
Il en ressort une l’hypothèse plausible que l’homme préhistorique et antique n’ayant pas suffisamment développé ses connaissances scientifiques du monde, il fut plus aisé dans la continuité comportementale de l’instinct de survie d’orienter la société humaine vers la valeur des biens et services éphémères, plutôt que vers le capital humain durable qui n’avait pas de valeur à l’évoque.
On le constate d’ailleurs par les innombrables boucheries perpétrées dans les cultures primitives du combat et de la guerre dont les violences s’expriment encore aujourd’hui chez des groupes d’individus aux comportements déviants. L’espèce humaine a progressé en perpétuant une culture sociale établie sur ces concepts et mécanismes erronés.
Le capital humain est en partie ce sur quoi misent certaines entreprises du modèle économique monétaire pour atteindre une rentabilisation fiscale. Mais il s’agit d’un objectif détourné de la réalité, car le capital humain est utilisé d’abord pour la performance et la productivité ensuite pour la qualité et l’innovation. Et même dans ce dernier cas, le profit est toujours l’objectif premier vers lequel est détournée l’innovation.
Le modèle économique monétaire vise exclusivement l’accumulation monétaire de richesse virtuelle et non le développement individuel et collectif de l’espèce. Pourtant, la survie passe d’abord par la qualité et l’innovation de l’adaptation et non par la performance et la productivité de l’accumulation d’un concept.
Depuis des millénaires, l’économie monétaire entretient cette confusion grave en induisant d’innombrables stratégies comportementales déviantes résultant en la dégradation des ressources naturelles minérales et bio topiques au profit de la croissance économique monétaire. Elle réussit à perdurer parce que l’entreprise est considérée comme un lieu de création de richesses et le creuset indispensable de la socialisation et de l’autonomie des personnes.
En réalité, l’entreprise n’est qu’un vecteur de l’économie monétaire favorisant la circulation de l’argent et son accumulation entre les mains de la minorité. Rares sont les individus qui sortirons grandis d’avoir sacrifié leur vie entière au travail. Les scientifiques font exception. Mais leurs recherches sont de moins en moins possibles à cause de la pression fiscale de la croissance économique qui détourne leurs travaux vers des applications lucratives plutôt que de développer la connaissance permettant d’innover pour l’évolution, le progrès et la survie de l’espèce tout en permettant de mesurer les conséquences néfastes d’une civilisation appuyée sur une économie monétaire.
Dans une économie basée sur le capital humain, un seul investissement est justifiable : l’investissement en temps et en efforts dans l’éducation. Car l’éducation est la clef de voûte de l’accroissement de la valeur du capital humain rendant possible la qualité et l’innovation dont bénéficie chaque individu pour s’adapter en s’améliorant, favorisant ainsi l’évolution de l’espèce qui consolide sa capacité de survie. Il ne s’agit pas ici d’une éducation centrique sur le travail ni bornée à l’innovation technique, mais d’un processus d’apprentissage continu de notre monde favorisant la consolidation des connaissances requises pour assurer des stratégies comportementales durables en équilibre avec les environnements humain, biophysique et social.
Non seulement cette éducation favorise le développement de la capacité d’innovation sociale, mais elle constitue un accélérateur de création de richesse humaine et de socialisation. De plus, cette éducation nivelle les inégalités sociales en ramenant le développement du capital humain à sa plus simple expression limitée à la capacité de développement individuel et non à l’accessibilité à l’éducation actuellement bloquée par l’économie monétaire.
Ainsi, le développement des individus n’est limité que par leur capacité d’apprentissage qui se développe avec le temps et l’acquisition de connaissances pour atténuer les limitations cognitives individuelles. Plus l’individu apprend, plus la capacité cognitive de son cerveau se développe, repoussant constamment ses limitations. On assiste alors à une évolution cognitive et comportementale de l’espèce qui la projette vers un avenir inévitablement plus prometteur que l’actuel.
Lecture : Comment exister encore?
Voici une analyse interessante et concise de l’état du progrès de la civilisation humaine et du constat qu’elle constitue un frein majeur à l’évolution de l’espèce.
Les graves défauts de conception de l’environnement social avec des concepts et mécanismes erronés à sa base, induisent des stratégies comportementales déviantes en interagissant avec la nature humaine.
.
Pour une humanité retrouvée, libérée de ladite croissance
Cet essai se présente sous la forme d’une introduction aux valeurs écosociales et entend procéder à une description critique des obstacles politiques, économiques et techniques à l’émancipation sociale et écologique.
Ainsi Louis Marion exprime en prologue les intentions de son ouvrage. L’essai est une forme assez libre d’écriture qui lui permet d’embrasser l’état du monde dans son ensemble. Et c’est peu dire que le constat est ici alarmant! La croissance comme modèle unique des sociétés humaines est un cancer généralisé dont la COP 21 n’a jamais osé reconnaître les symptômes.
Louis Marion, en s’appuyant essentiellement sur les réflexions de Günther Anders, va chercher les causes de cette situation extrême dans laquelle se trouve l’humanité tout entière, à travers une série de critiques sans concession ni pincettes, successivement du capitalisme, de l’aliénation au travail, du libéralisme, de l’instrumentalisation politique du langage, du progressisme technocratique et de la mégamachine industrielle.
Si le projet est ambitieux, le pari est bel et bien tenu en moins de 200 pages. Il en résulte une concentration d’informations et de concepts parfois ardus à assimiler mais toujours très perspicaces dans le développement du propos. Bien que sombre dans son constat, il reste une véritable foi en l’homme, au-delà de la division politique fade gauche droite qui ne trompe plus personne, se définit intrinsèquement comme être social.
De son rapport à l’autre, l’homme est perfectible et a tout à gagner de son expérience sensorielle du monde. Or, lorsque la machine intervient au départ pour le servir et finit par l’asservir, le système s’emballe et n’a d’autre finalité que lui-même en dehors des intérêts proprement humains.
Ainsi en est-il d’une économie financiarisée qui n’a d’autre raison d’être que de créer de la valeur où l’humanité est un produit monnayable comme un autre. Ainsi en est-il de l’évolution de la technologie qui tend de plus en plus à séparer l’homme de sa propre expérience du monde social et environnemental, lui ôtant toujours plus sa responsabilité dans ses actions.
L’auteur, à travers ses critiques constructives, vise une humanité retrouvée dans son essence par l’usage de ses sens, d’une sociabilité quotidienne et immédiate terreau irremplaçable d’un espace démocratique.
Comment exister encore ? Capital, techno-science et domination
de Louis Marion
Nombre de pages : 163
Date de sortie (France) : septembre 2015
Éditeur : écosociété
Collection : Théorie, TH 08
Lecture : « Soigner l’esprit, guérir la terre » – thérapie écopsychologique de l’espèce humaine
Un livre prometteur pour aider l’humain à soigner ses déficiences psychosociales déviantes induites dans ses stratégies comportementales par des concepts et mécanismes sociaux erronés par rapport aux lois immuables et intransgressibles de la nature.
L’écopsychologie, bien qu’elle ouvre la porte à la conscientisation de la réalité que l’humain origine de l’environnement biophysique et non de l’environnement social, ne constitue toutefois qu’une thérapie cognitive et non une solution aux graves problèmes d’adaptation de l’espèce humaine à son environnement biophysique.
L’homme est adapté à son environnement social avec des stratégies comportementales déviantes induites par des concepts et mécanismes de société erronés. Comme pour toute adaptation, il n’existe aucune autre manière que d’opérer des changements à l’environnement afin de forcer une adaptation des stratégies comportementales.
Dans la nature, les adaptations physiologiques et comportementales sont provoquées par des changements environnementaux déstabilisant ou mettant à risque la capacité de survie et de reproduction des espèces. Ces adaptations favorisent l’évolution. (https://irasd.wordpress.com/dossiers/recherches/environnement-humain/theorie-de-levolution-et-principes-dadaptation/)
Chez l’espèce humaine, un environnement social très développé et étanche à l’environnement biophysique, isole l’espèce des changements de l’environnement biophysique. L’espèce humaine répond toujours à des changements de l’environnement biophysique par des adaptations comportementales résultant en des changements à son environnement social.
Jamais les lois sociales ne sont adaptées par l’homme pour être compatibles avec les lois immuables et intransgressibles de la nature. Aucune interconnexion n’est instaurée entre les deux environnements, d’où l’étanchéité de l’environnement social qui protège l’espèce humaine des changements de l’environnement biophysique en la déconnectant de ce dernier.
L’humain ne vit absolument pas en symbiose ni naturelle ni artificielle avec l’environnement biophysique duquel il provient, mais presque exclusivement en symbiose avec l’environnement social dans lequel il a progressé. L’homme exploite l’environnement biophysique non pour sa survie, mais pour la croissance de son environnement social.
« La capacité à croître d’une population est infinie, mais la capacité d’un environnement à supporter les populations est toujours finie. Les populations croissent jusqu’à ce qu’elles soient stoppées par la disponibilité décroissante des ressources dans l’environnement. »
Depuis la fin de son évolution il y a environ 10 000 ans et le début de son progrès dans l’histoire, jamais la civilisation de l’humanité n’a aussi gravement été menacée d’effondrement et son espèce aussi menacée de disparition. Les impacts des stratégies comportementales déviantes de l’espèce humaine sur l’équilibre de son environnement biophysique menacent directement son environnement social et sa capacité de survie. La dégradation de l’environnement biophysique provoquée par la croissance de l’environnement social humain, accélère les déséquilibres, la raréfaction des ressources de l’environnement et des modifications environnementales et climatiques auxquelles l’espèce ne pourra pas s’adapter pour survivre.
Bien que l’écopsychologie soit une thérapie clef dans le processus d’évolution de l’espèce humaine pour assurer sa survie, il faudra drastiquement moderniser les concepts et mécanismes de l’environnement social afin de les rendre compatibles avec l’environnement biophysique pour induire chez l’homme une réelle adaptation des stratégies comportementales.
Cette modernisation ne peut se faire sans l’intégration des connaissances cumulées par l’approche scientifique afin de bien comprendre comment l’humain a évolué dans le temps et comment ses stratégies comportementales se sont adaptées au cours de son histoire. Cette compréhension permet d’identifier les concepts et mécanismes sociaux erronés qui induisent les stratégies comportementales déviantes de l’espèce humaine.
L’architecture sociale, qui s’appuie sur ces connaissances, favorise l’élaboration de concepts et mécanismes sociaux qui induiront des stratégies comportementales humaines adaptées à l’environnement biophysique pour permettre la survie de l’espèce tout en favorisant le progrès de la civilisation en symbiose avec ses environnements humain, biophysique et social.
–
http://www.trilogies.org/articles/soigner-lesprit-guerir
Soigner l’esprit, guérir la terre
Sous le titre Soigner l’esprit, guérir la Terre, Michel Maxime Egger vient de publier une introduction à l’écopsychologie. Une mouvance peu connue et développée sous nos latitudes et qui offre des pistes fécondes pour répondre à la crise écologique à travers une reconnexion en profondeur entre l’être humain et la nature.
Soigner l’esprit, guérir la Terre fait découvrir un mouvement clé et très peu connu en Europe continentale : l’écopsychologie. Il s’est cristallisé dans les années 1990 aux Etats-Unis et développé essentiellement dans le monde anglo-saxon. Transdisciplinaire, inspirée par la sagesse des traditions premières, l’écopsychologie estime que, pour répondre en profondeur à la crise environnementale, l’écologie et la psychologie ont besoin l’une de l’autre.
Elle montre comment sortir du déni et de l’impuissance, traite à la racine l’aliénation de l’humanité envers son habitat naturel, qui ne serait pas étrangère aux formes d’addiction à la consommation. Elle propose un changement du regard, à travers les idées fécondes de moi et d’inconscient écologiques, qui réinscrivent la psyché humaine dans la terre et sa mémoire.

Il en résulte des thérapies prometteuses qui ouvrent les portes du cabinet pour s’immerger dans la nature sauvage, interpréter autrement les rêves et coopérer avec les animaux. Un champ d’intervention primordial est l’éducation, qui doit permettre à l’enfant de se construire une identité en interrelation non seulement avec les autres humains, mais avec la toile de la vie.
L’ouvrage de Michel Maxime Egger offre une synthèse de l’écopsychologie, de son histoire et de ses enjeux, agrémenté de portraits de quelques grandes figures : Carl G. Jung, Paul Shepard, Theodore Roszak et Joanna Macy. Axé sur les interrelations intimes entre l’être humain et la nature, il est complémentaire de son précédent livre, qui ajoutait la dimension divine: La Terre comme-soi-même. Repères pour une écospiritualité (Labor et Fides, 2102).
Conférences et présentations
Voir l’agenda sur ce site.
Emissions radio et TV
- Faut pas croire: Mon esprit pour guérir la planète, débat entre Michel Maxime Egger et Marie Romanens, RTS Un (TV), 24 mai 2015.
- Spiritualité: «L’Eco-psychologie ou comment changer notre état d’esprit face aux enjeux de l’environnement», Radio-Cité, 5 émissions du 16 au 22 juin 2015, Radio Cité (Gilles Soulhac).
- Format A3: Être écolo, ça passe par le coeur… Introduction à l’écopsychologie, Radios régionales de Neuchâtel, Jura Bernois et Jura, 18 juin 2015.
- Hautes fréquences: La révolution verte du pape François, RTS la 1ère, 21 juin 2015.
- Babylone: Soigner l’esprit, guérir la terre, Espace 2, 24 août 2015 & La 1ère, 13 septembre 2015.
- Sur le rebord du monde: Répondre en profondeur à la crise écologique, RCF, 24 août 2015.
- Hautes fréquences: Sainte alliance contre le réchauffement climatique, RTS la 1ère, 29 novembre 2015; télécharger l’émission.
Entretiens, articles & bonnes feuilles
- « Un lien ontologique avec la nature », propos recueillis par Antoine Nouis, Réforme, No 3615, 25 juin 2015.
- « L’écologie a besoin de la psychologie, et vice-versa », propos recueillis par Jean-Claude Noyé, La Vie, 9 juillet 2015.
- « Et si l’écologie ne se réglait pas par la politique ? », propos mis en forme par Christian Willi, Christianisme aujourd’hui, An 13, No 7, juillet-août 2015.
- « L’écopsychologie veut reverdir l’identité humaine », propos recueillis par Dominique Hartmann, Le Courrier, 15 août 2015.
- Extraits de l’ouvrage « Soigner l’esprit, guérir la Terre », bonnes feuilles parues dans Le Cercle Psy. Le journal de toutes les psychologies, No 18, septembre-novembre 2015, pp. 104-107.
- Réchauffement climatique: vaincre la tentation du déni, 3e millénaire, No 117, automne 2015, pp. 38-41.
- Soigner l’esprit pour guérir la Terre ?, avec un encadré « La tentation du déni», propos recueillis et mis en forme par Mirko Locatelli, Moins, No. 20, novembre-décembre 2015, pp. 4-5.
- « Le climat se réchauffe car nos cœurs sont trop froids », Le Temps, 5 décembre 2015.
Revue de presse
«Le monde se trouve au coeur d’une urgence spirituelle collective, dont la crise écologique est l’une des manifestations majeures». Les écologistes se posant des questions sur les raisons de la lassitude que susciterait désormais leur message seraient bien inspirés de lire le remarquable ouvrage de Michel Maxime Egger, Soigner l’esprit, guérir la Terre (Labor et Fides). Ce n’est pas en bardant notre planète de technologies dites propres ni en usant d’un discours moralisateur usé que nous nous en sortirons. La déconnexion de l’homme avec ce qu’il croit être son environnement – alors qu’il est lui-même l’environnement! – a pris une telle ampleur au cours des âges qu’un bouleversement des consciences passe par des expériences physiques, sensorielles et spirituelles que l’auteur nous suggère. Et cela après nous avoir initié, dans un langage limpide, aux subtilités de l’écopsychologie, née il y a plusieurs années aux Etats-Unis d’un rapprochement de l’écologie et de la psychologie. En compagnie de Carl G. Jung, Theodore Roszak, Paul Shepard et Joanna Mary, nous explorons les secrets de nos âmes. Attention, danger salutaire!
Philippe Le Bé, L’Hebdo, 23 avril 2015.
Souvent les psychothérapeutes adaptent le patient à une société déstabilisante, ils soignent les symptômes et pas la cause du mal. Les écopsychologues estiment de leur côté que notre rupture avec la Terre est la source profonde de notre malaise social. C’est pourquoi le livre de Michel Maxime Egger, « Soigner l’esprit, sauver la Terre (introduction à l’écopsychologie) », paraît indispensable. Il montre historiquement l’émergence de cette nouvelle approche qui lie écologie et psychologie, très répandue dans le monde anglo-saxon mais malheureusement encore ignorée dans l’espace francophone. La traduction de l’ouvrage de Joanna Macy (écopsychologie – pratique et rituels pour la Terre) est une heureuse exception détaillée par Michel Maxime Egger.
Michel Sourrouille, Biosphère, 16 juin 2015, avec une synthèse de l’ouvrage.
Une démarche prometteuse qui renoue avec la sagesse ancestrale
Pour aborder la question de l’évolution du climat, nous avons souvent évoqué l’énigme suivante : comment se fait-il que nous ne croyions pas ce que nous savons ? Nous savons que notre système de consommation est dans une impasse et que notre civilisation va dans le mur, mais nous n’ajustons pas notre comportement à notre savoir. Le livre de Michel Maxime Egger revient sur cette question en présentant les contours d’une nouvelle science, appelée écopsychologie. Depuis le XVIIIe siècle, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, l’anthropocène, marquée par l’impact des activités humaines sur l’évolution de la planète. Ces dernières décennies, nous sommes devenus conscients des risques d’effondrement, tant pour les écosystèmes que pour les sociétés humaines. Un tel constat devrait induire un changement de comportement qui nous engagerait vers une société qui soutient la vie, dans toutes ses dimensions, et pourtant notre comportement relève du déni.
L’écopsychologie repose sur une alliance entre l’écologie et la psychologie. Cette science part du principe qu’il existe une interdépendance profonde entre la non-durabilité des relations avec soi-même et les autres et la non-durabilité des relations avec la Terre. Une écospychologue pose la question centrale : «Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les psychothérapeutes posent à leurs patients des questions sur leurs relations avec leur mère, leur père et leurs amis… mais disent rarement un mot sur les liens – ou le manque de lien – avec leur « mère » Terre ? […] Si les patients traitaient les autres humains comme ils traitent la Terre, les thérapeutes pren¬draient ces comportements comme preuve d’une sérieuse pathologie. » Et l’auteur de souligner une corrélation entre la perte du lien primordial avec la nature et un comportement de prédateur vis-à-vis de cette dernière.
Si Freud a répondu à la question de la relation entre la psyché et la nature à partir de l’ancien paradigme scientifique, rationaliste et dualiste, c’est du côté de Jung que les écopsychologues trouvent des pistes de réflexion qui les aident à fonder leur science. Il pouvait en effet conseiller à ses patients d’aller se promener dans une forêt, convaincu qu’un arbre peut parfois aider à se reconnecter avec son intériorité. L’auteur déploie les différentes dimensions de cette science, holistique et interdisciplinaire, de son histoire et de ses enjeux, agrémentée de portraits de quelques grandes figures de l’écopsychologie. Une démarche prometteuse qui renoue avec la sagesse ancestrale. Il relève en effet qu’Hippocrate, le père de la médecine, affirmait dans son traité Air, eau, lieu qu’on ne pouvait comprendre les troubles d’un sujet si l’on n’étudiait pas sérieusement son environnement : le type d’eau, la qualité de l’air, les vents, l’humidité, les tem¬pératures, les aliments, les plantes, les saisons…
Antoine Nouis, Réforme, 25 juin 2015.
Vous êtes dans l’air du temps et vous avez une sensibilité écologique ? Cela va vous intéresser. Car vous aurez certainement remarqué que, malgré tous les beaux discours, les lois et le tri de votre compost, la crise semble s’aggraver et que rien ne semble pouvoir la vaincre. Un mouvement anglo-saxon qui s’est développé depuis les années 1990 a fait le même constat. Les réponses courantes apportées aux problèmes écologiques de la planète ne suffisent pas à les régler. Il faut rechercher plus en profondeur, dans la psychologie, ce qui explique les comportements anti-écologiques. C’est ainsi qu’est née l’écopsychologie.
Michel Maxime Egger, 57 ans, est l’auteur d’un livre sur le sujet. Depuis les promenades avec son grand-père dans l’enfance et la construction de cabanes dans la forêt, il a toujours entretenu un lien étroit avec la nature. Une passion qu’il allie aujourd’hui à son travail pour le développement équitable et durable. Parallèlement, Michel Egger a suivi un chemin spirituel riche et original. «Dans des monastères ou des sessions de développement personnel, je me suis rendu compte que beaucoup des personnes que je rencontrais ne faisaient pas le lien entre leur spiritualité et le monde avec ses problèmes, raconte-t-il. D’un autre côté, dans les organisations où je travaillais, la spiritualité était souvent absente. Or tout se joue pour moi dans l’articulation des deux domaines de la spiritualité et de notre responsabilité, écologique en particulier.»
L’ouvrage sur l’écopsychologie approfondit cette veine. Le lecteur y apprend comment le consumérisme, cause importante de la destruction de la planète, est enraciné dans la psyché humaine. «Nous pouvons parler d’addiction à la consommation, affirme Michel Egger. L’être humain cherche en elle une réponse aux questions essentielles qu’il se pose sur la vie. Vous avez beau informer sur les problèmes, cette info nourrit le mental, mais descend-elle en nous pour toucher le coeur et nous rendre vraiment concernés?» Les écopsychologues prônent une écologie qui va rechercher les ressorts cachés de ses échecs et une psychologie ouverte aux problèmes de l’environnement. «Pour répondre à la crise écologique, nous devons être attentifs autant aux maladies de l’âme qu’aux dégâts à l’environnement. Les deux sont interconnectés. Selon les écopsychologues, nous ne pourrons pas guérir l’être humain sans restaurer la santé de la planète.»
A l’origine du mal, selon eux, se trouve la coupure entre l’être humain et la nature. «Dans les sociétés traditionnelles, note Michel Egger, l’enfant passait de la matrice de la mère à celle de la société. Entre les deux, il y avait toutefois celle de la nature, qui a disparu.» Pour renouer avec la nature au plus profond de nous-mêmes, les écopsychologues s’appuient notamment sur une nouvelle forme d’interprétation des rêves. « Et si nos rêves n’avaient pas seulement à voir avec notre vie intrapsychique ? Si les éléments naturels qui les habitent devaient être pris, non comme des symboles, mais comme des messagers de ce monde naturel que nous portons au fond de nous-mêmes ? Pour nous alerter, ou nous apprendre quelque chose.» Les écopsys auxquels se réfère Michel Egger nous disent à la croisée des chemins. Ils nous invitent à laisser de côté le déni – aussi dénoncé par le pape François dans sa récente encyclique sur la Création – et le découragement. Et à changer de cap. «L’aventure essentielle de notre époque est d’aller vers un développement qui honore et célèbre la vie, basée sur des relations plus harmonieuses entre l’homme et la nature.»
Vincent Volet, bonne nouvelle, No 6, juillet-août 2015.
Une ouverture à un nouveau champ disciplinaire
La crise écologique suppose changement d’état d’esprit qui conduit à rapprocher l’écologie de la psychologie. Dans la suite d’un ouvrage qui portait sur la spiritualité (cf. Études, juillet-août 2012), Michel Maxime Egger présente la nouvelle discipline de l’«écopsychologie» qui se développe surtout dans le monde américain. Il s’agit d’étendre le champ de la psychologie au-delà de la seule psychè humaine, comme Jung l’avait pressenti dans sa critique de Freud, retrouvant la notion d’«âme du monde» comme «matrice qui rend possible l’intelligence du vivant». La nature et l’humain sont profondément corrélés: on ne parviendra pas à restaurer la santé humaine sans restaurer celle de la planète. À l’inverse, les déséquilibres de cette dernière sont l’objectivation de ceux de l’humanité. Le diagnostic de la situation présente met l’accent sur le rejet de tout dualisme. Il est suivi par des propositions concrètes d’« écothérapie » qui sont pratiquées : cures psychologiques dans la nature, conseil chamanique, séjours dans la «nature sauvage», etc. Chaque chapitre se conclut par le portrait d’une figure emblématique de ce courant de pensée: Carl Gustav Jung (à titre de précurseur), Paul Shepard, Theodore Roszak et Joanna Macy. La perspective s’efforce de redonner une dimension humaniste à ce qui pourrait dériver vers une écologie trop « naturaliste ». Certaines propositions nécessiteraient un recul critique, mais on peut remercier l’auteur de nous introduire avec beaucoup d’érudition à un nouveau champ disciplinaire.
François Euvé, Etudes, juillet-août 2015.
S’inscrivant dans la continuité de son essai La Terre comme soi-même, avec ce nouvel ouvrage Michel Maxime Egger étudie l’écopsychologie, un mouvement transdisciplinaire et multiforme dont il entreprend de retracer l’histoire, de préciser les contours et d’en définir les enjeux afin de nous en proposer une synthèse. L’écopsychologie offre en effet des voies théoriques et thérapeutiques fécondes pour dépasser le dualisme entre l’être humain et la nature, et refonder ainsi notre relation à la Terre. Elle apparaît ainsi comme étant de nature à répondre en profondeur à une crise écologique et climatique dont les conséquences sur la santé et le bien-être humains sont de plus en plus manifestes. […]
Les écopsychologues anglo-saxons étudiés ici – Théodore Roszak, Joanna Macy, Paul Shepard, Harold Searles, Robert Greenway… –, venus d’horizons très différents, œuvrent à la redécouverte de l’unité entre l’âme et le cosmos, à l’exploration des interrelations entre la psyché et la nature et à la prise en compte de la dimension psychologique dans l’approche des problèmes environnementaux et dans celle du monde naturel au cours des pratiques thérapeutiques.
C’est en fin de compte une démarche d’ouverture à l’amour de la Terre et de la vie, qui ne pourra s’accomplir pleinement que par une transformation intérieure. C’est aussi un appel à élargir les cercles de l’identité humaine au-delà de l’individu comme de ses interrelations avec ses proches et son milieu social, pour entrer dans une compréhension de la santé de la personne dans sa relation au monde naturel autre qu’humain et développer une conscience de l’unité du réel. De là, un ensemble de pratiques proposées par les écopsychologues, qui visent à restaurer le lien entre, d’une part, notre corps et notre psyché, et, d’autre part, la nature, une nature qui apparaît au cours de cette réflexion comme étant elle-même dotée d’une «âme», espace de rencontre avec l’âme humaine.
L’auteur s’attache à faire ressortir les lignes de force de l’écopsychologie, laquelle puise à des sources d’inspiration très diverses et dont les champs d’investigation sont multiples, tout autant que les approches thérapeutiques qu’elle propose : «son approche, écrit-il, est transdisciplinaire, sa philosophie holistique, sa vision du monde écocentrique et sa visée thérapeutique». Michel Maxime Egger examine la philosophie et les actions thérapeutiques et éducatives offertes par l’écopsychologie, selon laquelle la santé humaine et celle de la planète sont indissociables, et les conditions qui permettraient leur mise en œuvre.
Il procède pour cela à une vaste étude, qui s’appuie non seulement sur les éléments de l’écopsychologie, mais aussi sur les apports de l’histoire et de la psychologie, et enfin en prenant en compte des conceptions de la nature, du moi et de l’inconscient puisées dans les données de l’écologie profonde, de la science contemporaine et des peuples premiers.
Louis Rolland, Sources, pour une vie reliée, No 31, juillet-septembre 2015.
Écopsychologie : voici le premier livre de synthèse en français sur cette discipline qui étudie interactions entre la psyché humaine et la nature, expliquant comment la rupture entre l’homme et la nature est à l’origine de la crise environnementale. Présentation de ses fondateurs : Cari Jung, Paul Shepard, Théodore Roszak et Joanna Macy.
L’Ecologiste, No 45, août-octobre 2015.
La découverte d’un courant important
Dans son livre paru en 2012, La Terre comme soi-même, l’auteur appelait à un changement de paradigme dans la relation de l’être humain avec la terre : non plus un rapport de sujet à un environnement objet, mais se redécouvrir partie intégrante de la nature. Il y montrait comment les grandes traditions spirituelles de l’humanité proposaient des pistes en ce sens. C’est dans la foulée de cet ouvrage que l’auteur poursuit sa recherche avec Soigner l’esprit, guérir la Terre, en nous proposant la découverte d’un courant important de la psychologie peu connu en Europe continentale, mais qui se développe surtout dans le monde anglo-saxon : l’écopsychologie.
Transdisciplinaire, inspirée par les traditions premières, l’écopsychologie estime que, pour répondre en profondeur à la crise environnementale d’aujourd’hui, il faut allier l’écologie et la psychologie. Elle veut traiter à laracine l’aliénation de l’humanité par rapport à son habitat naturel dont elle use et abuse, et montrer comment l’être humain est passé d’une symbiose avec la nature à une relation de dualité et d’aliénation. Cette aliénation ne serait pas étrangère aux formes d’addiction à la consommation, avec l’exploitation de la nature que celle-ci entraîne.
L’écopsychologie propose donc un changement de regard, à travers les idées fécondes de moi et d’inconscient écologiques, qui réinscrivent la psyché humaine dans la Terre et sa mémoire. Un champ d’intervention primordial est l’éducation qui doit permettre à l’enfant de se construire une identité en interrelation non seulement avec les autres humains, mais aussi avec la toile de la vie. L’ouvrage propose aussi les portraits de quelques grands initiateurs de cette approche : Carl G. Jung, Paul Shepard, Théodore Roszak et Joanna Macy.
Dans son « ouverture finale », l’auteur rappelle que le monde se trouve au cœur d’une « urgence spirituelle collective » et que, dans la mesure où les symptômes de la crise écologique appartiennent à la fois au patient individuel et au corps collectif, il n’y aura pas de transition vers une société qui soutient la vie sans un travail de transformation au double plan de la psyché profonde et des structures politico-économiques.
John Borremans, Voies de l’Orient, No 136, juillet-septembre 2015.
Fondateur de www.trilogies.org et responsable du bureau romand d’Alliance Sud (regroupement de six ONG suisses), l’auteur part du hiatus « entre l’abondance de l’information sur les problèmes écologiques et l’insuffisance des changements de comportement ». « Jusqu’ici les cris d’alarme […], les appels à l’autolimitation […] n’ont pas réussi à inverser la courbe », écrit-il. Nourrie de l’approche jungienne, de mythologie animale et d’écologie profonde, l’écopsychologie, discipline essentiellement américaine encore peu connue en Europe, fait un lien entre les déséquilibres que nous infligeons à la Terre et nos propres déséquilibres. Elle voit l’origine des dérives de notre civilisation dans sa vision dominatrice, dualiste, scientiste, matérialiste et utilitariste du monde. Le parallèle entre écocide et ethnocide est saisissant : quand on est capable de l’un on est capable de l’autre.
La méthode scientifique qui nous a donné les outils d’une agression massive peut-elle, par la seule lumière de ses constats, inciter l’humain à la modération dans l’usage qu’il fait de la Terre ? On peut en douter, sachant que les retours d’information restent souvent pour chacun « des réalités lointaines et statistiques ». Comment toucher le cœur, l’âme, parler à notre lien au monde, comment ressentir comme nôtres les besoins de la Terre ?
Nous semblons bien « trop séparés de la nature pour être réellement touchés par les maux qui l’affectent », car « la nature est considérée […] comme un objet extérieur à l’être humain ». Quel lien avec la nature a une génération confinée dans un monde d’écrans, ignorant d’où vient l’eau du robinet, la pomme sur la table de la cuisine ? Qui n’a pas la chance de prendre des coups et des bosses dans la nature ? Et qui « risque de croire […] que les seules réalités vivantes sont les humains » ?
« La modernité occidentale a désenchanté la nature et vidé la matière de l’esprit », souligne Michel Egger. Il s’agit de réapprendre que « nous sommes comme des cellules dans le corps du vaste organisme vivant qu’est la planète Terre », de retrouver notre capacité à résonner à l’unisson de l’âme du monde, à nous relier à notre propre nature, et donc à la nature et à ses constituants, par notre corps, nos sens, notre âme, notre esprit et aussi notre raison. Ce sont les ressorts affectifs qui nous déterminent, et tant que nous ne résoudrons par la question de notre coupure avec la nature, nous continuerons à être incapables de la respecter (puisque nous ne nous respectons pas nous-mêmes). Car, estime l’écopsychologue Théodore Roszak, « l’être humain est naturellement animiste ». Or, « sans intimité avec la nature, [il] devient malade », ajoute un de ses collègues, Robert Greenway.
Soyons donc accoucheurs d’un nouveau chapitre de notre histoire « reposant plus sur les liens que sur les biens ». En cela l’auteur voit un paradoxal espoir, car « le consumérisme […] manifeste en creux une aspiration fondamentale à la relation ».
René Longet, Choisir, No 669, septembre 2015.
Dans ce livre très documenté, Michel Maxime Egger présente les fondements d’un mouvement qui explore les liens intimes entre la nature et la psyché humaine. D’où vient la déprime chronique des sociétés consuméristes ? En partie, et bien plus qu’on ne pense, d’une vie quotidienne de moins en moins harmonieuse avec notre environnement naturel, affirment les écopsychologues. « Que signifie « aller bien » dans un système que l’on peut considérer comme globalement pathologique ? », interroge Egger en déplorant que la psychologie dominante ait « tendance à ignorer les causes structurelles – économiques, sociales, écologiques – des problèmes psychologiques ». C’est donc à une « réconciliation entre l’être humain et le cosmos » que travaille l’écopsychologie, ce qui passe certes d’abord par une conversion personnelle à la sobriété de vie, mais aussi, plus radicalement, par une transformation de structures sociales et politiques « dysfonctionnelles », insoutenables à maints égards. Ce n’est pas le moindre mérite de la synthèse passionnante d’Egger que de dessiner des alternatives pour un empowerment révolutionnaire.
Limite, Revue d’écologie intégrale, No 1, septembre 2015.
La découverte d’un mouvement essentiel
Après la publication de La Terre comme soi-même, ce deuxième ouvrage de Michel Maxime Egger nous fait découvrir un mouvement essentiel très peu connu en Europe continentale: l’écopsychologie. Établie dans les années 1990 aux Etats-Unis et développée principalement dans le monde anglo-saxon, l’écopsychologie entend répondre en profondeur à la crise environnementale qui domine aujourd’hui l’humanité dans son ensemble. Transdisciplinaire avant tout, elle montre comment l’écologie et la psychologie peuvent créer une dynamique nouvelle pour sortir du déni et de l’impuissance ; elle traite, à la racine, l’aliénation de l’humanité envers son habitat naturel, qui ne serait pas étrangère aux formes d’addiction à la consommation. Elle propose un changement de regard dans la perspective d’une relation consciente et harmonieuse à la nature. L’écopsychologie s’inscrit dans le devenir spirituel de la civilisation contemporaine, axé sur l’éducation et les thérapies inspirées par les traditions spirituelles. L’ouvrage offre une synthèse de l’écopsychologie, de son histoire et de ses enjeux, agrémenté de portraits de quelques grandes figures : Carl G. Jung, Paul Shepard, Theodore Roszak et Joanna Macy.
3e millénaire – L’homme en devenir, No 117, automne 2015.
Pour guérir la Terre, il faut soigner notre tête
Avec l’essai Soigner l’esprit, guérir la Terre, Michel-Maxime Egger nous invite à comprendre intimement que nous ne sommes pas séparés du monde qui nous environne. L’écopsychologie rend possible ce changement radical de notre perception. Sur 250 pages très documentées, le dernier livre de Michel Maxime Egger bouscule la vision de la psyché admise en Occident depuis plus d’un siècle. […] Egger décrit le mouvement de l’écopsychologie, né dans les années 1990 chez des penseurs anglo-saxons, qui révèle la nécessité réciproque de l’écologie et de la psychologie : selon ce mouvement de pensée, seule la réunion de l’écologie et de la psychologie peut résoudre la situation « d’écocide » dans laquelle nous nous trouvons, où l’homme comme la planète sont malades. […]
Ainsi, les écopsychologues ne prennent pas en compte l’individu séparé de son environnement mais le considèrent comme un être perméable aux dommages et déséquilibres subis par la Terre. La première tâche serait de quitter « la terrible illusion de la discontinuité », l’idée d’une séparation entre moi et le monde, créée dans la pensée moderne afin de prononcer les mots « je suis », […] afin de retrouver une valeur que nous portons tous en nous-mêmes : « La conscience de l’unité du réel. » Egger retrace les étapes de l’épopée humaine qui ont conduit à nous éloigner de cette conscience, faisant pourtant partie de notre structure fondamentale, ainsi que l’atteste l’étude des sociétés traditionnelles.
L’écologie comme la psychologie connaisse chacune ses limites, qui s’expliquent justement par leur isolement. L’écologie ne gagnerait pas l’adhésion collective parce que l’individu moderne, dissocié intérieurement entre l’intellect et le cœur, construirait sans le savoir une sorte de bulle pour se protéger de la réalité. Les émotions face aux « vérités qui dérangent » sont ainsi refoulées, et privées du pouvoir de transformation dont elles sont porteuses. De l’autre côté, la psychologie occidentale dominante s’est limitée au monde strictement humain et souffre d’une conception atomisée, réductrice du moi.
Carl Gustav Jung est convoqué par Egger comme précurseur fécond de la nouvelle discipline. […] Renouant avec l’antique anima mundi, les nombreux auteurs cités par Egger appellent à passer d’un égo-humano-centrisme à une perspective éco-cosmo-centrique, tous attestant, bien que de façons différentes, de la réalité de « l’âme du monde ». « Le changement de cap est l’aventure essentielle de notre temps. Il naît de transformations dans nos cœurs, nos esprits et nos visions de la réalité. » Ces mots de l’états-unienne Joanna Macy témoignent de l’approche holistique qui nous est demandée pour suivre le chemin de l’écopsychologie, et pour accepter le paradoxe comme voie royale vers la conscience de l’unité. […]
La discipline n’omet pas le plan citoyen ! Face à « l’urgence spirituelle collective », son programme débouche de manière emblématique sur le politique, et elle reconnaît son besoin d’une théorie sociale. L’enjeu se trouve dans l’articulation de l’individuel et du structurel, en n’oubliant pas, tel que nous dit ultimement Roszak, « que seul l’amour peut nous changer. »
Juliette Kempf, Reporterre, 28 octobre 2015
Avec cet ouvrage, Michel Maxime Egger offre une très belle entrée en matière dans l’écopsychologie, ce nouveau champ transdisciplinaire qui se développe depuis le début des années 1990. L’écopsychologie, terme né sous la plume de Theodore Roszak, cherche à trouver des réponses à notre crise écologique actuelle en alliant écologie et psychologie. Elle n’est toutefois pas une discipline unique et unifiée. De sources d’inspiration multiples, l’écopsychologie regroupe des approches théoriques et des pratiques variées, et couvre un champ d’investigation très vaste. Cette diversité, Michel Maxime Egger a très bien su la mettre en évidence, dressant un tableau exhaustif et pertinent des visées de l’écopsychologie ; c’est là que réside la richesse de son livre.
Dans un premier temps, l’introduction de Soigner l’esprit, guérir la Terre permet au lecteur d’entrer facilement dans le sujet, car elle présente de manière succincte la genèse et la raison d’être de cette nouvelle discipline. Le premier chapitre est ensuite consacré aux limites de l’écologie et de la psychologie dans la perspective des problèmes contemporains d’environnement. L’auteur y montre les différentes raisons pour lesquelles persiste un décalage entre la prise de conscience environnementale, et les mesures individuelles et collectives adoptées jusqu’à présent. Du côté de l’écologie, les obstacles sont de deux sortes. D’une part, les discours écologiques qui jouent par exemple sur la peur ou la culpabilité produisent des mécanismes de protection et de blocage qui se traduisent souvent par un déni du réel ou une résistance aux changements. D’autre part, l’argumentation rationnelle des informations sur l’état de notre planète ne suffit pas à modifier les comportements humains. Du côté de la psychologie, la principale critique concerne la vision réductrice, voire l’oubli de la nature. En effet, la nature est généralement considérée comme un objet extérieur ; seule la psyché individuelle compte. Pour résumer, l’écologie ignore le monde psychique, tandis que la psychologie n’intègre la nature ni dans sa théorie ni dans sa pratique.
Or, face à ces limites, l’écopsychologie œuvre à intégrer les interdépendances physiques et psychiques entre les hommes et la biosphère, premièrement pour comprendre les causes profondes de la crise écologique, et deuxièmement pour changer nos modes de vie et d’être. Ce sont ces deux axes que Michel Maxime Egger présente avec habileté dans les chapitres respectivement deux et trois, sûrement les plus intéressants du livre. Selon les écopsychologues, les atteintes à la planète sont les symptômes des déséquilibres psychiques de l’homme. Et notre déconnexion avec le monde naturel en est la source. Pour comprendre les origines de cette déconnexion, il faut remonter le cours de l’histoire de l’humanité. Paul Shepard a identifié quatre étapes historiques qui ont façonné la conscience humaine, générant divers dualismes entre l’homme et la nature : les débuts de l’agriculture au Néolithique, les pasteurs éleveurs monothéistes, le puritanisme et la révolution industrielle. De ces dualismes ont découlé des représentations de la nature marquées par l’extériorité, la domination, la dénaturalisation ou la perte de relations symboliques et sacrées avec la nature. Ainsi déconnecté de la nature, l’homme s’est tourné vers l’extérieur, vers des sources secondaires telles que le travail ou la consommation pour trouver du sens à sa vie, au lieu de chercher à l’intérieur de lui-même.
L’écopsychologie prône donc un changement radical de nos modes d’être, de vivre et de penser. Elle a pour but de transformer notre vision de la nature et notre psyché. Il s’agit dans le premier cas de passer d’une perspective égo-humano-centrique à une perspective éco-cosmo-centrique, et dans le deuxième cas de former une unité entre la psyché humaine et la biosphère. Certains écopsychologues conçoivent un inconscient écologique qui recouvre le monde naturel organique et inorganique auquel les hommes doivent se connecter, à l’image des peuples premiers de chasseurs-cueilleurs. En somme, réunir le monde naturel et la psyché humaine permet à la fois aux hommes de modifier leurs impacts environnementaux et de se réaliser en tant que personnes.
Le dernier chapitre est, quant à lui, consacré aux différentes approches écothérapeutiques. Il clôt très bien cet ouvrage sur l’écopsychologie en présentant sa dimension pratique, qu’il aurait été dommage de négliger. À noter qu’à la fin de chaque chapitre, un portrait de quatre pionniers / ères de la discipline est esquissé. On y trouve parfois quelques répétitions, mais on n’en voudra pas à l’auteur vu la pertinence de ces portraits. En guise de conclusion, Michel Maxime Egger termine sur l’importance pour l’écopsychologie de dépasser le plan individuel en intégrant les dimensions socio-politico-économiques. Il signe ainsi un bel ouvrage introductif sur l’écopsychologie, complet et bien structuré, qui permet d’appréhender sans peine ce champ disciplinaire en pleine évolution.
Gabriel Salerno, Futuribles, décembre 2015
La Toile en parle
- Eglises & écologies (E&E)
- Reporterre: une présentation de l’ouvrage
- Chronique libre
- Le Journal intégral
–
http://www.laboretfides.com/?page_id=3&product_id=687222
Soigner l’esprit, guérir la terre , Les Editions Labor et Fides
Pour la première fois dans l’édition francophone, cet ouvrage fait découvrir un mouvement important et quasi inconnu en Europe continentale : l’écopsychologie. Cristallisée dans les années 1990 en Californie et développée depuis lors essentiellement dans le monde anglo-saxon, l’écopsychologie estime que l’écologie et la psychologie ont besoin l’une de l’autre. Pour ses promoteurs, l’aliénation de l’humanité par rapport à son habitat naturel ne serait pas étrangère aux formes d’addiction à la consommation et aux techniques de masse. Pour s’en préserver, ils inventent l’idée féconde d’inconscient écologique à partir de laquelle se profilent des thérapies prometteuses sollicitant l’immersion dans la nature sauvage ou la sollicitation des animaux. Un champ d’intervention important est l’éducation qui doit permettre à l’enfant de se construire une identité personnelle en interrelation non seulement avec la culture et les autres humains, mais avec la nature et le monde du vivant en général.
Sociologue et journaliste de formation, Michel Maxime Egger travaille en tant que lobbyiste pour le développement durable et des relations Nord-Sud plus équitables. Il a fondé le réseau « Trilogies » qui met en dialogue traditions spirituelles et grandes problématiques de notre temps. Dernier livre paru : « La Terre comme soi-même », Labor et Fides, 2012.
Lecture : Le contrôle des jeunes déviants – un comportement déviant en soi
Ce livre expose un aspect intéressant des stratégies comportementales déviantes de l’espèce humaine en ciblant les déviances sociales chez les jeunes adolescents sous l’angle des mécanismes de contrôle social.
Il est désolant de constater que l’étude ignore totalement la connaissance des mécanismes psychosociaux de l’adaptation des stratégies comportementales à l’environnement social. Les auteurs demeurent à côté et en surface de la problématique en effleurant les tentatives de contrôle social et ratent la cible réelle de la problématique.
Cette analyse néglige l’identification des causes profondes et réelles que sont les concepts et mécanismes erronés de l’environnement social qui sont responsables d’induire ces comportements déviants. Les auteurs ignorent que les stratégies comportementales sont la résultante d’adaptations à l’environnement pour préserver l’intégrité individuelle et la survie des jeunes qui se sentent menacés dans un monde en crise.
Les jeunes humains ne développent généralement pas leur capacité d’inhibition avant l’âge de maturité cervicale autour de 20 ans. Les adolescents d’aujourd’hui sont bombardés d’informations plus ou moins fiables par leur fréquentation assidue des médias sociaux et par l’accès rapide aux informations sur Internet.
Les adolescents développent donc très tôt une conscience de l’état du monde qui les entoure en se forgeant une image de la réalité interprétée de manière plus intuitive que celle que les adultes peuvent atteindre. Cette prise de conscience de la réalité des problématiques d’une espèce et de sa civilisation en crise dans un environnement social inadéquat et un environnement biophysique dégradé, incite les jeunes à se rebeller plus facilement et de manière plus agressive, exprimant ainsi leur désarroi profond de la perte de contrôle et de capacité à pouvoir participer à la rectification de la crise humaine.
En conséquence, les jeunes sont plus aptes à s’enrôler dans des groupes axés sur la révolte contre le système social. Les environnements de proximité de ces groupes de rue favorisent la détérioration rapide des agissements déviants par adaptation des stratégies comportementales qui favorisent le maintien d’un statut social au sein de ces groupes. Ce qui aboutit inévitablement à des stratégies comportementales déviantes.
Le contrôle social est totalement inefficient parce qu’il ne résout pas les causes fondamentales à l’origine des adaptations de stratégies comportementales des jeunes. Le contrôle social constitue une déviance comportementale en soi qui s’appuie sur l’ignorance ou l’indifférence des causes réelles des stratégies comportementales des jeunes adolescents qui tentent de s’adapter à un monde en crise.
La seule voie possible pour minimiser ces stratégies comportementales déviantes est la réforme sociale de tous les concepts et mécanismes erronés de la société humaine qui induisent ces stratégies comportementales déviantes en interagissant avec la nature humaine.
Pour architecturer cette réforme, il faut d’abord identifier clairement les concepts et mécanismes de société erronés qui induisent ces adaptations comportementales déviantes pour ensuite concevoir de nouveaux concepts et mécanismes sociaux favorisant l’adoption de comportements constructifs chez les individus de l’espèce humaine. Tel est la mission de l’IRASD avec l’architecture sociale.
Stéphane Brousseau – Directeur de recherche
.
http://www.pum.umontreal.ca/catalogue/le-controle-des-jeunes-deviants
Le contrôle des jeunes déviants – Les Presses de l’Université de Montréal
Les perceptions publiques de la jeunesse semblent se cristalliser autour de deux figures bien distinctes: d’un côté, une jeunesse ordinaire, dont on dit souvent qu’« il faut bien qu’elle se passe ». Elle est certes parfois turbulente, ou même politisée, mais ses désordres semblent transitoires et, du moins aux yeux d’une partie de la société, légitimes. De l’autre côté, une jeunesse menaçante, issue des classes populaires, qui met en échec les instances traditionnelles de socialisation et ne semble répondre qu’aux exigences de la rue, du quartier ou du gang. Si cette seconde figure n’est pas nouvelle, sa perception s’est sensiblement modifiée et le fossé s’est creusé entre les deux polarités. À la représentation des déviances comme des séquences prévisibles et presque inévitables de la vie des jeunes (hommes le plus souvent) d’origine populaire s’est substituée l’image de déviances ancrées, accompagnées de violences incontrôlées, menant de la petite délinquance à la grande criminalité, ou – ultime menace de notre époque – aux radicalisations les plus terrifiantes. Cet ouvrage met en lumière le fonctionnement des dispositifs de contrôle et les processus de typification qui contraignent en partie la jeunesse stigmatisée à ne pouvoir exister qu’à l’intérieur de cadres forgés pour elle. La multiplicité des territoires investigués, de la France au Brésil, en passant par le Québec et les États-Unis, permet de présenter une grande variété de cas et de dégager certaines tendances d’ensemble.
Fabien Desage est maître de conférence en science politique à l’Université de Lille et membre du Centre d’études et de recherches administratives, politiques et sociales.
Nicolas Sallée est professeur au Département de sociologie de l’Université de Montréal et chercheur collaborateur au Centre international de criminologie comparée (CICC).
Dominique Duprez est directeur de recherche en sociologie au CNRS et membre du Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales.
Acquisition de connaissances et interprétation du réel
Toutes les espèces vivantes sont génétiquement et instinctivement assujetties à leurs comportements et aux conséquences qui en découlent sur leur capacité de survie parce que leurs stratégies comportementales sont adaptées aux conditions environnementales de leurs niches écologiques.
Chez les espèces dont la capacité cognitive est peu développée, les stratégies comportementales génétiques et instinctives qui prédominent sont essentiellement des produits d’adaptations successives de l’évolution. Si ces espèces présentent des modifications de leurs comportements de manière à nuire à leur capacité de survie ou de reproduction, elles vont subir les conséquences qui en découlent et devoir s’adapter à nouveau.
Les espèces adaptent leurs stratégies comportementales pour faire face à des changements environnementaux et non l’inverse, elles ne modifient pas leurs comportements de manière volontaire.
Toutefois, l’espèce humaine est dotée d’une capacité cognitive permettant le raisonnement conscient. Ses individus, en plus d’être génétiquement et instinctivement assujettis aux conséquences de leurs comportements, en sont aussi consciemment responsables.
Ni les lois de l’environnement social ni les principes de morale philosophique ou religieuse ne constituent des limites réelles aux actions et comportements. Elles ne sont que des conventions humaines permettant à l’espèce de fonctionner avec une certaine cohésion dans son environnement social. Aucune loi physique, chimique, psychologique ou autre n’empêche un individu d’en tuer un autre.
Les réelles conséquences des actions humaines sont liées aux impacts qu’elles ont sur l’équilibre des lois immuables et intransgressibles de la nature concrétisant les environnements humain et biophysique dont les sciences permettent d’expliquer les mécanismes. De nombreux principes psychologiques sont sollicités et impactés lorsqu’un individu en a tué un autre.
Afin de minimiser les impacts destructifs et maximiser les impacts constructifs, chaque individu de l’espèce humaine doit apprendre énormément au quotidien et tout au long de son vivant. Parmi les actions et comportements, ceux qui peuvent sembler à première vue des erreurs devraient toujours être convertis en occasions d’apprendre pour favoriser l’amélioration continue. Cet apprentissage implique et entraine des adaptations aux stratégies comportementales. Ce qui apporte une forme d’autorégulation par introspection cognitive qui doit nécessairement être couplée avec une acquisition de connaissances.
Les seules vraies erreurs sont commises lorsque l’humain s’empêche émotionnellement d’apprendre en refusant l’erreur, chaque fois qu’il considère exacte sa perception et son interprétation de la réalité. Pourtant, les sens et la capacité cognitive de l’espèce humaine ne lui permettent pas d’atteindre une interprétation juste de la réalité. Ces erreurs sont précisément liées aux limitations de perception, aux influences de ce qui est ressenti et à la cognition de l’information et qui est limitée par les connaissances acquises.
La philosophie est constamment utilisée pour tenter d’interpréter la partie cognitive du réel. La philosophie, du grec ancien φιλοσοφία (composé de φιλεῖν, philein : « aimer »; et de σοφία, sophia : « sagesse »), signifie littéralement : « l’amour de la sagesse ».
La philosophie n’est pas une science regroupant un ensemble de connaissances. La philosophie est une démarche réflexive sur des savoirs disponibles se présentant comme un questionnement, un débat d’idées et une interprétation du monde et de l’existence humaine. Elle peut se concevoir comme une activité d’analyse, de définition, de création ou de méditation sur des concepts existants dans le but d’une recherche de la vérité, d’une méditation sur le bien, le beau, le juste ou la quête du sens de la vie et du bonheur.
La philosophie s’appuie donc exclusivement sur des concepts de l’environnement humain intrinsèque à sa nature et largement influencés par sa culture, elle-même induite par les stratégies comportementales de l’évolution et de l’histoire de l’espèce qui ont donné lieu à l’émergence de la pensée humaine.
La philosophie est intrinsèquement liée à la nature humaine et n’existe pas comme externalité mesurable par les approches scientifiques à l’extérieur de l’environnement humain. La philosophie est donc une stratégie comportementale humaine et non une science.
La philosophie est donc insuffisante en soi pour expliquer le réel. Elle peut tout au plus aider l’humain à mieux utiliser sa capacité cognitive. Il n’existe aucune preuve scientifique probante et fiable que la philosophie a déjà réussi à expliquer avec exactitude le réel.
Par contre, la science utilise des outils d’acquisition de données qui dépassent les sens humains, des outils mathématiques qui sont aux limites de la capacité cognitive humaine et des outils de modélisation informatiques qui dépassent la capacité cognitive humaine. Avec ces outils et ces approches méthodologiques, il est possible d’acquérir méticuleusement des éléments de connaissance qui se rapprochent du réel parce qu’ils transcendent les sens et la capacité cognitive de l’espèce humaine.
Mais aucune des sciences ne peut prétendre refléter ni représenter le réel, car elles correspondent toutes à des domaines distincts de l’étude d’aspects spécifiques du réel. Seule l’intégration scientifique de tous les domaines des sciences peut favoriser la mise au point d’une image plus représentative du réel que celle fournie par les sens et la capacité cognitive humaine limités.
L’homme a donc tout avantage à développer le réflexe de tenter de comprendre au lieu de s’appuyer instinctivement sur des croyances erronées découlant d’une perception limitée et de connaissances déficientes. Pour comprendre, il faut acquérir la connaissance tout en gardant à l’esprit qu’elle sera toujours limitée par les moyens d’acquisition donc, jamais parfaite à 100 %.
Plus la fiabilité ou la précision de l’image de la réalité acquise par l’humain est précise, moins il commettra d’actes aux conséquences destructrices tout en maximisant les actions aux conséquences constructrices.
Le réel n’est pas ce que l’humain en pense. La pensée humaine est une interprétation de ce qu’il perçoit du réel au travers des limitations de ses sens pour construire une image et une compréhension personnalisée du réel, dont l’analyse est toujours limitée par la somme de connaissances acquises.
Avec l’accumulation de connaissances, l’humain passe du jugement critique au constat analytique. Il peut cesser de critiquer pour commencer à expliquer. Il passe du mode destructif au mode constructif. Cette approche ne peut être autrement que bénéfique pour l’individu et pour la collectivité.
Refuser d’apprendre ou se conformer à ses croyances équivaut à brouiller volontairement notre interprétation du réel et à limiter la capacité humaine tout en acceptant d’être entraîné par un flot d’erreurs plutôt que dans un univers de réussites. Il sagit là de stratégies comportementales déviantes.
La vie de l’espèce humaine devrait être une séquence continue d’apprentissages pour compenser le fait que les individus ne naissent pas avec des connaissances innées dans le cerveau et que cet organe n’est pas complètement formé avant l’âge de 20 ans. Ce qui n’enlève rien au fait que la génétique comportementale humaine puisse programmer des stratégies comportementales instinctives qui seront modulées par adaptations psychosociales.
Pour que cette séquence d’apprentissages soit possible, il faudra sans doute réformer complètement la société humaine en commençant par le processus d’apprentissage de connaissances appelé « éducation » et en modifiant en profondeur les priorités de l’espèce et les objectifs de la civilisation afin de d’altérer en conséquence les stratégies comportementales humaines nécessaires à l’atteinte de ces objectifs.
Tel est le but de l’architecture sociale : forcer consciemment l’adaptation des stratégies comportementales humaines en modifiant son environnement social de manière précise et spécifiquement conçue pour atteindre les comportements souhaités.
Stéphane Brousseau – Directeur de recherche
Le progrès de la civilisation nuit à l’évolution de l’espèce humaine
Cette analyse expose la différence et la dualité entre évolution et progrès.
L’évolution n’a rien à voir avec le progrès. L’évolution n’est que le résultat naturel de l’adaptation dans le temps à des conditions locales.
« Le progrès est une illusion reposant sur un préjugé social et un espoir psychologique. »
– Stephen Jay Gould
L’humain se raccroche au progrès parce qu’il n’a pas intégré la compréhension de l’évolution darwinienne à ses stratégies comportementales. C’est pourtant cette connaissance qui constitue notre meilleur espoir d’endiguer notre arrogance dans un monde en évolution.
S’il est un phénomène constant observable et largement documenté, c’est bien le changement. Sur les éléments inertes du règne matériel, atomique et moléculaire, les changements induisent des modifications de structures physiques ou d’états chimiques. Sur les formes de vie végétales et animales du règne vivant, les changements forcent les individus à s’adapter pour survivre, se nourrir et se reproduire ce qui mène à l’évolution.
Ces impacts physiques, chimiques et comportementaux demeurent possibles dans la mesure où les changements sont raisonnablement circonscrits à la capacité du matériel à les subir ou à la capacité du vivant à s’y adapter. Lorsque l’amplitude des changements ou sa rapidité franchissent le seuil de cette capacité, les modifications excèdent l’intégrité physico-chimique et la capacité d’adaptation devient improbable. L’intégrité matérielle et la survie sont alors compromises.
Le progrès est la concrétisation de l’adaptation de comportements humains induits par l’apport de connaissances acquises, instinctivement mises au profit du développement de l’environnement social. Ces comportements sont considérés comme des biais ou déviances comportementales lorsqu’ils affectent les équilibres de l’environnement biophysique, mettant à risque la survie de l’espèce.
L’élément prédominant de l’adaptation de l’espèce humaine pour survivre dans son environnement biophysique n’est pas physiologique, mais relève plutôt de l’adaptation de ses stratégies comportementales et de l’organisation sociale de l’espèce en groupes raciaux, culturels et fonctionnels très structurées autour de concepts et mécanismes de société comme le travail, l’économie, etc. Nous nommons cette organisation l’environnement social.
Durant la préhistoire, l’espèce humaine a évolué physiquement comme le démontrent les adaptations des diverses lignées de primates. Mais elle a aussi évolué physiologiquement grâce aux adaptations de son cerveau qui ont favorisé sa capacité cognitive.
Cette capacité du cerveau a permis à l’espèce humaine de survivre par l’acquisition de connaissances dites fondamentales sur l’environnement, le biotope, les interactions entre ceux-ci et le développement d’outils pour compenser la faible longévité des individus associée à l’adaptation médiocre de l’espèce à son environnement biophysique hostile.
Au cours de son histoire, l’espèce humaine a pu bénéficier de cette adaptation physiologique du cerveau pour continuer à développer sa capacité cognitive par l’acquisition de connaissances associées aux sciences pures comme la physique, la chimie, la biologie, la génétique, la psychologie, etc.
Ces connaissances acquises ont pu être appliquées à la conception d’outils et à la construction d’infrastructures artificielles supportant le développement et le progrès de l’environnement social jusqu’après l’ère industrielle. Mais déjà, on ne peut plus parler d’évolution ici, mais de progrès.
L’évolution est strictement liée à la capacité d’adaptation physionomique, physiologique ou comportementale, d’une espèce pour survivre aux changements de son environnement biophysique. L’évolution est donc directement dépendante des lois immuables et intransgressibles de l’environnement biophysique.
Le progrès se limite exclusivement aux applications matérialisées de connaissances scientifiques acquises se concrétisant dans des concepts, fonctionnements, outils, technologies et infrastructures sociales humaines.
Dans le cas spécifique de la civilisation humaine, force est de constater, et elle le fait d’ailleurs, que le progrès apporte une dualité complexe entre l’amélioration des conditions de vie favorisées par l’environnement social et une profonde absence d’adaptation de la civilisation aux lois immuables et intransgressibles de l’environnement biophysique.
Cette situation est le résultat de l’adaptation humaine à son environnement social dont les concepts et le fonctionnement imperméables tendent à rendre l’adaptation humaine étanche aux réalités et mécanismes des environnements humain et biophysique. En d’autres mots, la civilisation humaine n’a jamais été conçue consciemment d’une part et cette conception ne s’est jamais opérée en toute connaissance de causes à effet des conséquences sur l’intégrité de l’environnement biophysique.
La capacité cognitive actuelle de l’espèce humaine, couplée à la somme cumulée de ses connaissances acquises par les sciences, devrait théoriquement lui permettre de concevoir consciemment l’architecture d’un nouveau modèle de société appuyé sur de nouveaux concepts et mécanismes de fonctionnement afin d’éliminer un maximum d’impacts sur les équilibres de l’environnement biophysique tout en minimisant ceux qui ne peuvent être éliminés.
Un usage « intelligent » des connaissances pour le progrès peut ainsi permettre une évolution de l’espèce humaine dont les stratégies comportementales sociales seront compatibles avec les lois immuables et intransgressibles de la nature.
L’inverse n’est pas possible et ne peut même pas être envisagé…
Stéphane Brousseau – Directeur de recherche
Maturité du libre arbitre et capacité cognitive humaine
Qu’est-ce que le libre arbitre?
« Le libre arbitre est la faculté qu’aurait l’être humain de se déterminer librement et par lui seul, à agir et à penser, par opposition au déterminisme ou au fatalisme, qui affirment que la volonté serait déterminée dans chacun de ses actes par des “forces” qui l’y nécessitent. “Se déterminer a” ou “être déterminé par” illustre l’enjeu de l’antinomie du destin ou de la “nécessité” d’un côté et du libre arbitre de l’autre. »
(https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Libre_arbitre)
Selon la réalité scientifique, le libre arbitre est une conséquence de la capacité cognitive du cerveau humain couplée avec la maîtrise d’une somme importante de connaissances sur ses environnements humain, biophysique et social.
Dans la nature, le déterminisme peut être en partie associé à l’instinct comportemental génétique ou acquis des espèces favorisant leur capacité à se nourrir, à se reproduire et à s’adapter pour survivre, ce qui participe à définir une espèce vivante et à la distinguer d’une forme inerte.
L’apprentissage chez l’espèce humaine est certes limité dès la naissance par le développement de son cerveau qui n’atteint sa maturité cognitive que vers l’âge de 20 ans. Mais la capacité cognitive de l’humain se développe aussi proportionnellement à sa volonté et surtout à son effort pour acquérir par lui-même une somme grandissante de connaissances de complexité croissante qui suit la courbe de développement de sa capacité cognitive. En effet, l’acquisition de connaissances favorise aussi le développement cognitif avec ses capacités analytiques et d’intégration des données acquises.
Sans ces connaissances, le libre arbitre ne peut pas se manifester parmi les stratégies comportementales de l’espèce humaine et on se limite alors au « déterminisme » des comportements instinctifs. Mais il existe toute une gamme de niveaux de maturité cognitive entre le libre arbitre et l’assujettissement au déterminisme instinctif.
La capacité humaine d’acquisition de données par l’observation des environnements biophysique et social est limitée par la perfectibilité de ses sens. Sans l’utilisation de ses capacités cognitives pour dépasser ses limitations sensorielles en innovant avec des outils d’acquisition et de mesure du réel, les données d’observation demeurent partielles, limitées à ce que peuvent capter les sens humains et l’interprétation du réel qu’il en fait devient alors teintée de fabulations hypothétiques erronées menant à des stratégies comportementales déviantes telles qu’observées dans l’étude de l’histoire de l’humanité.
La propension de l’humain à fabuler des réponses aux questionnements induits par l’observation de ses environnements, l’incitent à adopter intuitivement pour hypothèses du réel des croyances erronées en remplacement des connaissances fiables exigeant des efforts, du temps et des outils pour les acquérir.
Les croyances erronées qui remplacent la vacuité intellectuelle laissée par le manque ou l’absence de connaissances induisent des stratégies comportementales déviantes issues d’un libre arbitre devenu déficient.
Ce n’est donc que par les outils et la démarche imparfaite de la science et en adoptant une approche cognitive neutre et objective, qu’il devient possible d’atteindre une maîtrise plus fiable des connaissances acquises, pour que l’humain puisse développer sa capacité cognitive afin d’atteindre une maturité acceptable du libre arbitre.
Le libre arbitre ne peut atteindre une maturité acceptable sans une maîtrise de toutes les sciences. C’est là le talon d’Achille de l’espèce humaine : sa déficience cognitive et sociale individuelle à intégrer un grand nombre de connaissances limite sa capacité comportementale collective et la maturité de son libre arbitre.
En observant les stratégies comportementales de l’espèce humaine dans ses environnements social et biophysique, on constate que le libre arbitre n’est pas encore très développé chez l’humain et se limite à un nombre restreint d’individus.
Il est aussi fort probable que nombre d’individus absorbés par la médiocrité des activités répétitives et routinières imposées par les concepts et mécanismes erronés de l’environnement social n’expriment pas leur libre arbitre pour diverses raisons culturelles, comportementales et psychosociales, préférant le confort de l’ignorance à l’effort cognitif.
Ainsi apparaît le déterminisme ou fatalisme, issu de l’assujettissement psychosocial et cognitif des individus à un modèle d’environnement social erroné auquel l’espèce humaine est adaptée avec des stratégies comportementales déviantes.
Le fatalisme est donc une illusion psychologique qui se substitue au libre arbitre lorsque ce dernier ne s’est pas développé en laissant dépérir la capacité cognitive inutilisée pour acquérir les connaissances qui sont nécessaires à son expression.
Toute espèce vivante s’adapte physiologiquement et adapte ses stratégies comportementales à son environnement pour survivre aux changements constants. L’humain est spécialement mieux adapté à son environnement social qu’à son environnement biophysique. À preuve, la complexité de la civilisation qu’il a échafaudée sans tenir compte des lois immuables et intransgressibles de l’environnement biophysique! La science en étudie et reconnait d’ailleurs les conséquences sur la dégradation de l’environnement biophysique ou sur les déséquilibres climatiques induits par les activités humaines.
Pour que l’humain développe son libre arbitre avec le maximum de sa capacité cognitive et d’acquisition de connaissances, il faudra induire chez l’espèce des changements majeurs de stratégies comportementales.
Et le seul moyen d’y arriver est de modifier en profondeur son environnement social en changeant de manière consciente et réfléchie les concepts et mécanismes de fonctionnement de la société et de la civilisation humaine. Là réside la tâche de l’architecture sociale ou architecture de société sur laquelle s’appuient tous les travaux de recherche de l’IRASD.
Pour y arriver, il faudra user d’une somme colossale de libre arbitre…
Stéphane Brousseau – Directeur de recherche
B.Sc. Géologie
Analyste et architecte en technologies de l’information et des communications
Chercheur en architecture sociale durable
–
IRASD – Institut de recherche en architecture sociale durable
SSARI – Sustainable Social Architecture Research Institute
En ces temps obscurs et incertains, il faudra que nous soyons brillants…
À la veille de la COP21 à Paris, tournant décisionnel pour la survie de l’espèce humaine et pendant que les stratégies comportementales déviantes des chefs d’État enveniment la violence par des conflits armés pour des intérêts économiques erronés, nous citons ici ce matin une réflexion tout à fait juste de notre collaborateur en France, Stéphane Hairy qui nous incite à faire preuve d’intelligence.
En effet, il faudra exploiter au maximum la somme des connaissances scientifiques de l’humanité avec toute sa capacité cognitive individuelle et collective pour transcender les croyances et comportements déviants que notre espèce a développés au fil de notre évolution et de la mise en place de notre environnement social, moteur de notre civilisation.
D’une part, d’innombrables indicateurs sont au rouge quant à la probabilité croissante de l’effondrement de notre civilisation. D’autre part, la dégradation que notre environnement social impose à l’environnement biophysique met en péril notre capacité de survie en imposant des changements environnementaux planétaires auxquels nous ne pourrons pas nous adapter.
Il est plus qu’urgent que les chercheurs, scientifiques et citoyens mettent l’épaule à la roue afin d’effectuer la lourde tâche de recherche et de compilation de connaissances nécessaires à la compréhension de l’écosystème humain, prémisse à l’architecture de notre société qui rendra possible la modernisation réformatrice inévitable à la pérennité de la civilisation humaine et à la survie de l’espèce.
En d’autres mots, voici la réflexion de Stéphane Hairy :
« En ces temps obscurs et incertains, il est plus que nécessaire d’être résilient face à l’adversité, de ne rien lâcher. Parce que ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous exploitent, ceux qui essayent de maitriser nos vies, nos humeurs, notre temps de cerveau disponible, notre peur et nos joies, ne lâcheront rien.
Je fais partie d’une génération qui ne peut qu’être désemparée en observant la situation actuelle, comme l’impression que notre espèce n’arrivera jamais à se dépêtrer du bourbier dans lequel elle s’est figée.
Seulement, voilà, cette situation est là et toutes les choses qui nous entourent et qui créent notre désespoir sont des créations humaines. Nous oublions vite que nous aussi avons un potentiel de création énorme, un potentiel créatif gigantesque pour la résolution de problème. Il faut que nous l’exploitions, nous sommes là pour ça, je pense profondément que nous sommes là pour ça et que si nous ne faisons rien… Il se ne passera rien.
Les politiques ne nous sauveront pas, les banquiers, les publicitaires, les journalistes et autres intellectuels ou spécialistes, non plus. Seul un élan collectif le permettra… Nous ne prenons pas la mesure du défi qui se présente aujourd’hui à notre espèce, car il ne faudra pas seulement être créatif… Il faudra que nous soyons brillants… »
– Stéphane Hairy – Collaborateur
Technicien aéronautique
Journaliste d’investigation
Structure organisationnelle, évolution des systèmes humains (économique, politique), comportement humain, sociologie, neurosciences, architecture sociale, dynamique des systèmes.
Déviances comportementales, survie humaine et architecture sociale
Déviant, déviante, adj. : Se dit de ce qui s’écarte de la règle, du cours normal des choses. Dévier de sa direction, en être détourné. Modifier, détourner le parcours normal. Transgresser, se mettre à l’écart des règles.
Erroné, erronée, adj. : Se dit de ce qui comporte une ou des erreurs, qui est inexact, faux ou incomplet par rapport à la réalité, ce qui permet d’adopter ou d’exposer des opinions ou comportements non conformes à la réalité et de tenir pour vrai ce qui est faux; commettre une erreur. Est erroné ce qui permet ou favorise l’acte ayant des conséquences graves.
L’IRASD considère comme déviant l’ensemble des stratégies comportementales humaines individuelles ou collectives qui vont à l’encontre des lois immuables et intransgressibles de la nature pour provoquer des modifications aux équilibres des environnements humain et biophysique qui engendrent des changements tels que l’espèce humaine a de faibles probabilités de pouvoir s’y adapter avec pour conséquence de mettre à risque sa capacité de survie.
Les stratégies comportementales qui favorisent la dégradation de l’environnement biophysique ou l’aggravation du réchauffement atmosphérique responsable des changements climatiques sont des exemples de stratégies déviantes.
La plupart des stratégies comportementales humaines déviantes sont induites par des concepts et mécanismes erronés de l’environnement social qui interagissent avec la nature humaine. Ces stratégies humaines, ces concepts et mécanismes sociaux résultent de l’évolution et de l’adaptation de l’espèce humaine pour survivre dans son environnement biophysique en élaborant son environnement social au fil de son histoire.
Les déviances comportementales sont des conséquences du fait que la majorité des concepts et mécanismes de l’environnement social sont erronés en n’étant pas du tout ou pas suffisamment appuyés sur les lois immuables et intransgressibles de la nature, mais sur des conventions, concepts et mécanismes purement inventés et conçus par l’homme afin d’assurer l’intégrité, le développement et la croissance de son environnement social.
Des changements aux environnements engendrent des adaptations ou des modifications des stratégies comportementales pour toutes les espèces, incluant l’humain. Le succès de l’adaptation à ces changements pour assurer la survie de l’espèce mène inévitablement à l’évolution physiologique ou comportementale qui résulte de modifications génétiques suite à la sélection naturelle des individus dont les adaptations ont pu assurer la survie.
Lorsque des stratégies comportementales déviantes provoquent des conditions extrêmes de changements des environnements humain et biophysique, pour lesquels l’espèce humaine ne dispose pas de la capacité d’adaptation suffisante pour assurer sa survie, il n’existe aucune autre solution pour éviter l’extinction que de forcer l’humain à adapter ses stratégies comportementales. La probabilité que ce forçage survienne naturellement est extrêmement faible, sinon nulle.
Pour forcer l’humain à adapter ses stratégies comportementales, il faut changer son environnement social. Pour changer son environnement social, il faut une réforme des concepts et mécanismes de la société. Les principes de base pour appliquer cette réforme sont en partie associés au développement durable. Mais le développement durable ignore une foule de variables comme la psychologie, la culture et le développement qui influencent directement les stratégies comportementales pour les faire dévier des lois immuables et intransgressibles de la nature et du développement durable lui-même.
En conséquence, cette réforme ne peut être réalisée sans une architecture sociale intégrée aux environnements humain et biophysique. Cette architecture sociale ne peut être effectuée sans une excellente maîtrise de la somme globale des connaissances scientifiques et sociales cumulées par l’humanité en intégrant ces connaissances au mieux pour minimiser l’impact des variables qui pourraient permettre l’architecture de concepts et mécanismes sociaux déconnectés de la réalité humaine et biophysique.
Ces travaux d’une envergure jamais réalisée par l’humanité doivent pourtant être faits afin d’éviter l’effondrement de la civilisation et l’extinction de l’espèce humaine dans le contexte actuel des pression induites par les dégradations de l’environnement biophysique, par l’épuisement des ressources et par les changements climatiques.
Ces travaux sont toutefois impossibles à réaliser sans une collaboration massive, unifiée, intégrée et coordonnée de chercheurs en provenance de tous les domaines de connaissances. Sans cette collaboration, le temps nécessaire pour accomplir ces recherches dépasserait largement la vie d’un seul homme et ne serait jamais réalisé à temps pour éviter l’effondrement de la civilisation et l’extinction de l’espèce humaine.
Lecture : Économie de l’après-croissance, Politiques de l’Anthropocène II
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100738890
Économie de l’après-croissance
Politiques de l’Anthropocène II
Agnès Sinaï
Presses de Sciences Po | Nouveaux Débats
La croissance et le productivisme, véritables socles de nos sociétés industrielles, nous entraînent dans une consommation effrénée d’espace et de ressources et mettent la planète sur une orbite périlleuse.
Les théories économiques, qui ont alimenté ce déni de la finitude des ressources, dérivent aujourd’hui vers de nouveaux mirages tels que la monétarisation des écosystèmes ou la croissance verte. Il importe de les dissiper et d’inventer une économie bio physique en phase avec les cycles de la nature, ralentie, locale et sobre, de réhabiliter le geste humain en faisant appel aux basses technologies.
À la lumière de ce nouveau paradigme, la décroissance des pays riches apparaît non plus comme une fatalité ou une contrainte mais comme une nécessité éthique et physique et une voie de justice sociale et d’égalité.
Introduction
Renouveler l’imaginaire économique
Agnès Sinaï
Première partie MIRAGES
Chapitre 1En finir avec la croissance ?
Dominique Méda
Une obsolescence du PIB de plus en plus admise
Le PIB occulte les maux de la croissance
Reconnaître les implications de l’obsolescence du PIB
Chapitre 2 Décroissance et récession en Europe
Alice Canabate
Récession et effets de l’austérité néolibérale
Vers une société frugale
Instituer des politiques anthropocéniques communes
Chapitre 3 Comment ne pas voir les limites de la planète
petite histoire de la mystique de la croissance indéfinie
Christophe Bonneuil
Basculement vers l’énergie fossile et externalisation de la nature
La fusion néomoderne comme nouvelle modalité de la négation des limites
Chapitre 4 L’impossible découplage entre énergie et croissance
Thierry Caminel
Mesurer l’efficacité énergétique
Découplage CO2 et matière
Efficacité énergétique et croissance
Rendement décroissant de l’énergie investie
Cannibalisme énergétique
Inertie sociétale
Difficiles incitations
Rendement décroissant de l’innovation
TIC, réseaux intelligents et découplage
Inéluctable décroissance
Une quatrième blessure narcissique
Chapitre 5 Des utopies industrialistes à la bioéconomie
Agnès Sinaï
La bioéconomie, une éthique
De quelques nouveaux oxymores
Deuxième partie RÉORIENTATIONS
Chapitre 6 L’économie biophysique
une économie pour l’ère de la décroissance
Yves Cochet
Critique de l’économie néoclassique
Économie écologique et économie biophysique
État stationnaire, état inégalitaire
Le rôle crucial de l’énergie
Rendements énergétiques décroissants
Le ratio EROEI
Économie politique hétérodoxe
Brève histoire énergétique de l’économie
Ce n’est pas une question d’argent
Le krach de 2008, résultat de la crise de l’énergie
Chapitre 7 Estimer l’inestimable
la nature mise à prix
Virginie Maris
La notion de services écosystémiques
La quantification de la nature
Les évaluations monétaires
Estimer l’inestimable : l’exemple de l’amitié
Le concept de valeur pour les économistes et pour les philosophes
Le problème de l’incommensurabilité des valeurs
Une conception pragmatiste
Chapitre 8 La monnaie, coupable ou innocente ?
Paul Jorion
Les fonctions de la monnaie et ses genres
Neutralité ou non de la monnaie
La machine à concentrer la richesse
Prêts à la production et prêts à la consommation
Le partage du surplus
La croissance, effet induit du prêt à intérêt
Vulnérabilité des monnaies parallèles ou complémentaires
Chapitre 9 Les low-tech, emplois de demain
Philippe Bihouix
Les basses technologies, seul choix rationnel
Terreur légitime ?
Destructions et créations d’emploi
Le contre-pied des low-tech
Chapitre 10 De la nécessité d’une décroissance
François Roddier
Énergie et PIB
La croissance en biologie
Quand la matière s’auto-organise
Le processus de criticalité auto-organisée
L’application à l’économie
L’auto-organisation des circuits neuronaux
L’auto-organisation de l’économie dans une société
L’évacuation de l’entropie et les embouteillages
Les processus naturels de régulation
Conclusion Refonder l’économie dans le soin de la Terre
Agnès Sinaï
L’argent ne mène rien sauf l’homme
L’argent ne mène pas le monde. Mais en interaction avec la nature humaine, ce concept social induit des stratégies comportementales déviantes qui dénature l’espèce et dégrade profondément les équilibres entre l’homme et son environnement, détruisant la symbiose indispensable au maintien de la vie.
L’espèce humaine est menée par le concept d’argent qui l’incite a entrer dans la montée d’un escalier social l’entraînant dans une spirale de croissance artificielle sans buts et déconnectée de la réalité humaine et biophysique.
L’humain assujetti à l’argent voit ses comportements de plus en plus altérés, en grande partie de manière inconsciente et surtout inconséquente des impacts qu’il impose à l’environnement et au climat humain, social et biophysique.
L’économie humaine basée sur l’argent n’est non seulement pas viable ni durable, mais elle freine considérablement l’évolution et est néfaste pour l’espèce. La pression engendrée par l’inévitable croissance économique typique du modèle s’exerce sur l’individu, la société et la planète. L’homme doit adapter ses stratégies comportementales à ces changements de l’environnement social et ces adaptations déviantes ont des conséquences s’aggravant de manière accélérée.
L’homme a le choix de modifier son système social afin de changer ses stratégies comportementales. Mais jamais il ne pourra modifier les lois immuables et intransgressibles de la nature, de la physique et de la chimie pour qu’elles se soumettent au concept social de l’argent.
L’homme a le choix d’adapter son système social aux lois immuables et intransgressibles de la nature ou de continuer à monter l’escalier de la croissance virtuelle qui dégrade la nature humaine. Cette situation ne peut mener l’homme qu’à se précipiter vers l’effondrement de sa civilisation pouvant également entraîner la disparition partielle ou complète de son espèce. Tout ce qui monte doit redescendre…
L’argent ne mène rien sauf l’homme.
Est-il suffisamment évolué d’un point de vue cognitif pour se libérer de la cage qu’il a lui-même conçu en s’y enfermant?
Changements climatiques, symptôme du comportement humain
Jean-Claude Ameisen : « Il ne faut pas seulement se focaliser sur le climat »

Comment est née votre prise de conscience du sentiment de nature ?
Jean-Claude Ameisen : J’ai vécu mon enfance dans de grandes villes, mais j’ai toujours été émerveillé par la nature. Par tout ce qui vit, mais aussi par la neige, le vent, la mer. Et la montagne, surtout. Cette impression d’arpenter le ciel. A chaque pas, ou presque, un nouvel horizon qui se dévoile, de nouvelles cimes, de nouvelles vallées, de nouvelles forêts, de nouveaux torrents. Et cette impression étrange d’approcher les débuts du monde, ce qui nous a précédé depuis si longtemps et qui nous survivra.
Lire aussi : Comment changer notre rapport à la nature ?
Il y avait cet émerveillement, et il y avait les questions. Où s’enfuit la mer quand elle se retire ? Pourquoi les étoiles brillent dans la nuit noire ? Pourquoi les bourgeons reviennent à chaque printemps, et les feuilles, et les fleurs ? Où est l’arbre dans la graine ? Est-il déjà là, près d’apparaître, ou lui reste-t-il encore à s’inventer ? Et d’où vient le vent, la foudre, et le feu qui change le bois en cendre, et disparaît ? Comment se faisait-il que je pense, rêve, et vive ? Et pourquoi faudrait-il que je meure un jour ? Il y avait les secrets de la nature, que ni les questions ni les réponses ne pouvaient épuiser.
Y avait-il également les récits, le monde imaginaire des livres ?
Je me souviens du bouleversement qu’a causé en moi l’un des premiers romans que j’ai lus, vers l’âge de 5 ans : Le Dernier des Mohicans, de James Fenimore Cooper. La tragédie de la disparition des peuples amérindiens, provoquée par les guerres coloniales des Européens, dans la région des Grands Lacs, en Amérique du Nord, au XVIIIe siècle. Dans la splendeur de la nature, je découvrais soudain une dimension d’indifférence qui rendait déchirante et insupportable la souffrance humaine.
Mais il y avait aussi, dans l’extraordinaire capacité de renouvellement de la nature, une forme de promesse implicite : l’espoir que tout ne soit pas perdu à jamais, l’espoir que puissent un jour resurgir de nouvelles aubes, de nouveaux rêves, de nouvelles possibilités de bonheur. Ma conscience de la nature a émergé de ce mélange d’émerveillement, devant la présence étrange et familière de la réalité, et de plongées dans les livres, de dialogues silencieux avec ceux qui les avaient écrits, et dont certains avaient disparu depuis longtemps. La nature était plus que ce que je pouvais en percevoir, imaginer et ressentir. Elle était plus que ce que tous les autres, avant moi ou autour de moi, pouvaient m’aider à percevoir, à imaginer et à ressentir.
Étiez-vous déjà sensible à la fragilité de la nature ?
Non, elle me semblait inépuisable. Ce que je ressentais, c’était l’extrême fragilité des êtres vivants qui la composent. L’extrême fragilité de chacun d’entre nous.
Comment est née votre prise de conscience écologique ?
A la fois d’une prise de conscience générale, puis, plus personnellement, de mes recherches sur les relations entre la vie et la mort, au cours desquelles la question des mécanismes d’évolution du vivant avait pris une importance croissante. Je me suis replongé dans Darwin. Et j’ai réalisé à quel point le passé, la profondeur de temps, ce que Darwin appelait « le long écoulement des âges », était un élément indispensable pour comprendre le présent. A mon émerveillement devant la nature – natura, littéralement, « ce qui est en train de naître » – s’est surimposée l’idée que, pour comprendre ce qui nous entoure, il faut que le passé fasse partie de notre regard.
Il y a près de 150 ans, Darwin, après avoir proposé sa théorie de l’évolution du monde vivant, s’inquiétait déjà de notre capacité à le détruire
Nous sommes les cousins des oiseaux et des fleurs. Et des étoiles. Nous faisons partie d’un même récit. Les frontières qui séparent les espèces vivantes ne sont que des degrés d’éloignement sur le thème de la parenté, en perpétuel devenir à partir d’une généalogie commune. Les relations qu’ont tissées et que tissent continuellement entre eux les êtres vivants – les écosystèmes – jouent un rôle essentiel dans le renouvellement de la nature et dans l’émergence de la nouveauté. Et il en est de même des innombrables extinctions qui ont sculpté la diversité du vivant. Pour ces raisons, ce que nous pouvons préserver, ce n’est pas l’état actuel de l’univers vivant : c’est sa capacité à se renouveler, à évoluer, et à nous permettre de vivre.
Charles Darwin (1809-1882), auquel vous avez consacré un livre, Dans la lumière et les ombres : Darwin et le bouleversement du monde (Points Seuil, 2011), et sur les épaules duquel vous vous hissez chaque semaine sur France Inter, a-t-il été précurseur en matière écologique ?
On considère souvent que la prise de conscience écologique date des années 1960, avec le Club de Rome notamment. Mais il y a près de 150 ans, Darwin, après avoir proposé sa théorie de l’évolution du monde vivant, s’inquiétait déjà de notre capacité à le détruire. C’est en 1868, neuf ans seulement après la publication de De l’origine des espèces. Darwin cite la phrase attribuée à Francis Bacon : « Knowledge is Power » (La connaissance est un pouvoir). Et il poursuit : « C’est seulement aujourd’hui que l’homme a commencé à prouver à quel point “la connaissance est un pouvoir”. [L’humanité] a désormais acquis une telle domination sur le monde matériel et un tel pouvoir d’augmenter en nombre qu’il est probable qu’elle envahira toute la surface de la Terre jusqu’à l’annihilation de chacune des belles et merveilleuses variétés d’êtres animés. » A l’exception,ajoute-t-il, des animaux et des plantes que nous aurons conservés dans nos fermes et nos jardins zoologiques et botaniques.
Sa sombre prophétie semble s’être réalisée…
Malheureusement, nous nous sommes engagés sur ce chemin : la sixième grande extinction dans l’histoire de notre planète, celle dont nous sommes responsables, a commencé ; et en ce qui concerne les mammifères, plus de 80 % vivent aujourd’hui dans nos élevages. Mais, dans ce que Darwin appelait « l’infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses » – la merveilleuse diversité de l’univers vivant – il y a une composante qui lui était quasiment inconnue : le monde des organismes unicellulaires, qui a probablement été l’unique forme de vie durant les trois premiers milliards d’années d’évolution du vivant.
Il constitue aujourd’hui une part essentielle de la biodiversité, que nous ne pouvons voir qu’à l’aide de microscopes. Et nous vivons en symbiose avec lui. A titre d’exemple, nous hébergeons chacun dans notre tube digestif plusieurs centaines de milliers de milliards de bactéries – dix fois plus que le nombre de cellules qui nous composent – et leur présence est essentielle au développement de notre système immunitaire, et à notre production et consommation d’énergie. Nos relations de symbiose avec le monde vivant dépassent de loin les relations affectives, émotionnelles, esthétiques et symboliques que l’humanité a entretenues, dans d’innombrables cultures, avec certains des animaux et des plantes qui nous entourent.
Sommes-nous devenus maîtres, possesseurs, mais également destructeurs de la nature ?
Je pense que la question essentielle n’est pas celle de l’avenir de « la nature » en tant que telle. La nature s’en est très bien tirée pendant 3,5 à 4 milliards d’années sans nous et elle continuerait à s’en tirer très bien sans nous. Il y a une forme d’orgueil à penser que nous parviendrions à la faire disparaître. Mais la nature nous a donné naissance, nous en faisons partie, nous y vivons et nous en vivons. Et en détruisant les composantes de la nature qui sont essentielles à notre existence, c’est à l’humanité que nous faisons du mal. Nous devrions remettre le bien-être de l’humanité au centre de nos réflexions sur la nature.
Prendre soin de la nature, c’est prendre soin de nous ?
Des publications scientifiques récentes indiquent que les personnes qui habitent en ville aux alentours d’espaces verts, ou dans des rues bordées d’arbres, sont, en moyenne, moins malades que celles qui vivent loin des arbres ou des espaces verts. Il y a une dimension préventive et thérapeutique dans notre relation à la nature, et quand nous parlons de la nature, nous parlons aussi de nous.
Y a-t-il un risque à focaliser la préoccupation écologique sur le seul réchauffement climatique ?
Le changement climatique est une menace grave. Mais il n’est que l’un des nombreux symptômes des dégradations de l’environnement planétaire que causent nos modes de vie. Et ces dégradations ont – indépendamment de leurs effets sur le changement climatique – des effets majeurs sur la santé humaine.
Ainsi, la pollution à elle seule est responsable, selon l’OMS, d’un quart de toutes les maladies dans le monde. Une étude de l’OMS publiée en 2014 indique que la seule pollution de l’air provoque chaque année la mort prématurée de plus de 7 millions de personnes dans le monde. J’ai pris pour exemple la pollution. Mais nos dégradations de l’environnement ont aussi pour conséquence l’épuisement de la plupart des ressources naturelles non renouvelables, la pollution des sols, des nappes phréatiques et des mers, la déforestation, l’épuisement des sols et des réserves d’eau par l’agriculture et l’élevage intensifs, l’épuisement des ressources maritimes par la pêche intensive et l’acidification des océans, l’érosion des écosystèmes et de la biodiversité, l’émergence de maladies infectieuses d’origine animale…
Focaliser la préoccupation écologique sur le seul réchauffement climatique risque de nous détourner des efforts indispensables pour protéger la santé humaine, réduire les inégalités et préserver notre environnement.
Faut-il aussi changer de politique énergétique ?
Une étude récente de l’OCDE a exploré dans les 34 pays qui la composent, plus la Chine et l’Inde, le coût des morts prématurées et des maladies provoquées par la seule pollution de l’air extérieur : non pas en termes de souffrance humaine, mais uniquement en termes de coûts économiques. Ce coût a été évalué à 3 500 milliards de dollars par an – environ 3 100 milliards d’euros, soit plus de 85 % du total des dépenses publiques annuelles de santé réalisées par l’ensemble des pays de la planète.
La pollution à elle seule est responsable, selon l’OMS, d’un quart de toutes les maladies dans le monde. La seule pollution de l’air provoque chaque année la mort prématurée de plus de 7 millions de personnes
Une autre étude publiée par des chercheurs du FMI estime que le coût économique des morts prématurées, des maladies et des dégâts environnementaux causés par la seule utilisation des énergies fossiles s’élevait en 2013 à 4 900 milliards de dollars – plus que le total des dépenses publiques annuelles de santé dans le monde. Ces désastres en termes de vie humaine et de santé et ces coûts économiques ne sont pas intégrés dans le prix des énergies fossiles. Et si on les prenait en compte, les énergies propres et renouvelables nous paraîtraient beaucoup moins chères.
Croyez-vous à cette nouvelle religion du « développement durable » ?
De nombreuses études scientifiques ont révélé à quel point l’exploitation des ressources et les dégradations de l’environnement se produisent aux dépens des populations les plus pauvres de notre planète, et au profit d’une partie des habitants des pays les plus industrialisés. Non seulement notre mode de développement économique et social n’est pas durable pour les générations futures, mais il est aussi de plus en plus inéquitable pour les générations présentes.
Dans nos pays riches, malgré les dégradations de l’environnement, l’espérance de vie moyenne à l’âge adulte n’a cessé d’augmenter depuis plus d’un demi-siècle. Mais c’est au prix d’inégalités croissantes en termes économiques et sociaux, en termes d’espérance de vie, d’espérance de vie en bonne santé, de maladie et de handicap. Ces inégalités se creusent à l’intérieur de nos pays riches, entre pays riches et pays pauvres, et à l’intérieur des pays pauvres.
Les catastrophes sont-elles autant sociales qu’environnementales ?
Les catastrophes naturelles révèlent de manière brutale des précarités et des vulnérabilités préexistantes que nous nous sommes habitués à ne plus voir. Les victimes de l’ouragan Katrina à La Nouvelle-Orléans, du tremblement de terre d’Haïti, des sécheresses au Sahel, de la canicule de 2003 dans notre pays, des crises écologiques et économiques… sont avant tout ceux qui étaient auparavant déjà les plus pauvres, les plus fragiles, les plus abandonnés. Et, indépendamment des catastrophes, 2 milliards de personnes vivent dans l’insécurité alimentaire, sans savoir si elles mangeront demain ; 1,2 milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau potable ; et des études indiquent que le développement mental de 250 millions d’enfants sera profondément altéré par la pauvreté, la pollution et la sous-alimentation.
Chaque année, dans les pays pauvres, plusieurs millions d’enfants et d’adultes meurent encore de maladies infectieuses pour lesquelles nous disposons collectivement des vaccins et des médicaments qui permettraient de les sauver ; 850 millions de personnes souffrent des maladies de la faim et de la dénutrition ; et 3 millions d’enfants sont morts de faim l’année dernière.
Quel type de développement défendez-vous ?
L’économiste Amartya Sen a montré depuis longtemps que les famines sont dues, dans la quasi-totalité des cas, non pas à une production insuffisante de nourriture, mais à l’existence d’inégalités, à une absence de solidarité, de partage, de véritable démocratie et d’accès de certaines populations ou personnes à leurs droits fondamentaux. A la seule préoccupation d’un développement « durable » – qui ferait durer les tragédies –, nous devrions ajouter le souci d’un développement « équitable ».
Mais les progrès scientifiques et technologiques ont permis à une grande partie de l’humanité de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Dès lors, pourquoi ne pas penser que les hommes pourront toujours trouver d’autres formes d’énergies ou aller coloniser d’autres mondes ?
La question principale ne me semble pas être de se demander si les avancées scientifiques et techniques apportent des bénéfices – elles en apportent toujours – mais si la manière dont nous les utilisons se fait au profit d’une partie de l’humanité et aux dépens d’une autre. Il s’agit toujours, sous des formes chaque fois différentes, de la question de la nature des frontières que nous traçons entre « nous » et « les autres ». De quelle humanité parlons-nous quand nous parlons de l’avenir de l’humanité ? De qui parlons-nous quand nous parlons de « nous » ? « Quand des êtres humains sont séparés de nous par de grandes différences d’apparence ou d’habitudes, écrivait Darwin, l’expérience nous montre, malheureusement, combien le temps est long avant que nous ne les considérions comme nos semblables. »
A la seule préoccupation d’un développement « durable » – qui ferait durer les tragédies –, nous devrions ajouter le souci d’un développement « équitable »
Combien le temps est long… L’histoire de l’exclusion est une très longue histoire. La première démocratie occidentale est née à Athènes : tout le monde y était libre et égal, sauf les femmes, les esclaves et les étrangers. La Déclaration d’indépendance des Etats-Unis, en 1776, se veut la première proclamation des droits de l’homme à vocation universelle : mais elle maintient l’esclavage, et ne donne pas de droits aux peuples autochtones. En 1789, la Révolution française abolit les privilèges et proclame la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : mais elle maintient l’esclavage, et ne donne pas le droit de vote à une moitié de la population, les femmes… Les avancées de la recherche scientifique sont toujours une source d’espoir. Mais il nous faut ensuite nous interroger, croiser les regards, ouvrir la réflexion, afin d’éviter l’exclusion.
Pourquoi cette prise de conscience écologique vient-elle aujourd’hui du côté des autorités spirituelles, notamment du pape François qui, dans son encyclique Laudato si, écrit que le monde contemporain fomente une « culture du déchet » et plaide même pour une forme de « décroissance » ?
La place de l’humanité dans la nature a toujours été une question centrale pour les spiritualités. Mais le pape François a donné à cette question une dimension sociale profondément humaine et universelle, soulignant les effets dramatiques des dégradations de la nature sur la souffrance des plus démunis : « Une vraie approche écologique, dit-il, se transforme toujours en une approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la clameur de la Terre que la clameur des pauvres. »
Qu’attendez-vous de la conférence de Paris sur le climat (COP21) et qu’allez-vous proposer en tant que président du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) ?
Le CCNE est en train de réfléchir à cette question : ce que je souhaite, à titre personnel, c’est que la COP21 soit l’occasion d’un véritable changement. Au lieu de focaliser tous les efforts sur la seule lutte contre le changement climatique, au risque de négliger, voire d’aggraver les inégalités et les drames humains, les consacrer à des mesures qui préservent le bien-être humain et réduisent les inégalités en protégeant l’environnement.
Jean-Claude Ameisen
Né en 1951, Jean-Claude Ameisen est médecin, immunologiste et chercheur en biologie. Directeur du Centre d’études du vivant de l’Institut des humanités de l’université Paris-Diderot, il préside le Comité consultatif national d’éthique (CCNE).
Concepteur et animateur de « Sur les épaules de Darwin », émission scientifique et philosophique hebdomadaire de France Inter (dont une partie est disponible en version écrite, comme Sur les épaules de Darwin : Retrouver l’aube, France Inter/Les liens qui libèrent, 2014), il a publié de nombreux ouvrages, dont La Sculpture du vivant. Le suicide cellulaire ou la mort créatrice (Seuil, 1999) et Dans la lumière et les ombres. Darwin et le bouleversement du monde (Fayard-Seuil, 2008).
C’est la démarche proposée par l’OMS par plusieurs commissions internationales, par le journal médical The Lancet, par le ministère de la santé, par le pape François… Garantir la protection et l’accès équitable de chacun aux biens communs de l’humanité que sont l’air, l’eau, la biodiversité, les ressources alimentaires et énergétiques, le climat ; préserver les capacités de renouvellement des splendeurs et des richesses de la nature, et le respect des pratiques culturelles humaines qui s’y déploient ; faire preuve de sobriété, d’inventivité et de solidarité ; réduire notre consommation inutile d’énergie ; développer les énergies propres et renouvelables ; lutter contre la pollution, soutenir les produits d’une agriculture et d’une pêche durables et d’un commerce équitable. Et lutter pour la diminution de la pauvreté, l’accès de tous aux droits fondamentaux, à la nourriture, à un toit, à l’éducation, aux soins.
Car protéger d’abord ceux qui sont le plus démunis n’est pas seulement un impératif éthique : c’est aussi le moyen de construire, à terme, un avenir véritablement commun pour l’humanité.
Croyances aux complots, de graves comportements erronés
Une des stratégies comportementales erronées de l’espèce humaine contribuant à brouiller l’observation et l’analyse objective des faits liés à des événements est la théorie ou la croyance aux complots.
Cette stratégie comportementale nuit considérablement à l’observation objective et à l’analyse des faits par une forme de rejet cognitif de la réalité provoquée par diverses déviances comportementales psychosociales dont :
– le sentiment d’impuissance sur le contrôle de sa vie;
– une méfiance excessive des décideurs de la société;
– une grande ouverture d’esprit naïve à des croyances erronées;
– un manque de confiance en soit comblé par une fausse supériorité intellectuelle.
Ces comportements psychosociaux déviants sont majoritairement provoqués par l’interaction de concepts et mécanismes de société erronés qui interagissent avec la nature humaine.
Ces comportements peuvent engendrer des stratégies comportementales décisionnelles erronées et des déviances psychosociales graves pouvant mener à la mort de nombreux individus de l’espèce et d’autres espèces.
Un bref article de la presse.
.
http://plus.lapresse.ca/screens/fc14d9f7-e628-468d-9585-2c6ceadf4341%7ChwR-TnnnXHzk.html
Des complots plein la tête
ALEXANDRE VIGNEAULT
LA PRESSE
Une personne sur deux croit à une théorie du complot ou une autre, estime Michael J. Wood, chercheur en psychologie à l’Université du Kent, en Angleterre. Entre une personne qui doute que toute la vérité ait été faite sur le 11-Septembre et une autre qui clame que la transformation de Bruce Jenner en Caitlyn est une preuve de plus d’un complot Illuminati, il y a tout de même un pas. Que certains esprits franchissent plus facilement que d’autres.
« La plupart des gens croient à une théorie du complot ou une autre, mais la majorité des gens ne font pas appel aux théories du complot pour expliquer ce qui se passe dans le monde », nuance en effet le psychologue originaire de la Colombie-Britannique, qui s’est initié aux discours conspirationnistes à travers la série X-Files et qui s’affaire désormais à les décortiquer.
Peut-on faire le portrait psychologique d’un conspirationniste ? Seulement de manière imparfaite, bien que les recherches réalisées à ce jour établissent des liens entre certains traits psychologiques et l’adhésion au conspirationnisme. « Beaucoup de gens qui adhèrent aux théories du complot ressentent une forme d’aliénation, signale par exemple Michael J. Wood. Ces personnes ne se sentent pas représentées dans la société. »
L’attachement aux libertés individuelles, l’ouverture « aux nouvelles expériences », la méfiance envers les autres et les institutions sont aussi communs chez les tenants des théories du complot. Or, c’est le sentiment d’impuissance face à sa vie ou au système politique qui semble au cœur de ce type de lecture du monde.
NE PAS CROIRE AU HASARD
« Il y a des indices qui pointent vers des enjeux de contrôle, précise le psychologue de l’Université du Kent. Les théories du complot donnent l’impression que le monde peut être contrôlé. Les choses n’arrivent donc pas par hasard. »
Jean Twenge, du département de psychologie de l’Université de San Diego, suggère que ce sentiment d’absence de contrôle jumelé à une exposition grandissante à des événements incontrôlables contribue à l’émergence d’une « mentalité de victime ».
« Souvent, les théories du complot mettent en scène des gens dominés par des puissants qui leur mentent. Ces derniers auraient même le pouvoir de falsifier la vérité en achetant les complicités politiques et médiatiques. »
— Rachida Azdouz, psychologue
L’influence de ces puissances supposément malveillantes leur permettrait ainsi d’écrire l’actualité – voire l’histoire – comme bon leur semble. Toutefois, ceux qui croient, par exemple, que les images montrant des astronautes américains sur la Lune ont été fabriquées par la NASA oublient un détail, selon un sociologue américain : une telle arnaque aurait exigé la complicité de milliers de personnes – scientifiques, techniciens, journalistes – et même celle d’astronomes soviétiques. Plus un complot est vaste, moins il a de chances de demeurer secret, selon Ted Goertzel.
OPÉRATION PAIX D’ESPRIT
Élisabeth Vallet, politologue de l’UQAM, croit que les théories du complot offrent des explications simples à des phénomènes complexes. Son confrère français Julien Giry voit un avantage à ce genre de lecture du monde : « [La théorie du complot] permet de rassurer, analyse-t-il. On sait pourquoi toutes les choses mauvaises arrivent, c’est l’action d’un groupe d’individus – francs-maçons, Illuminati, etc. –, c’est eux, la nuisance unique. »
« Peut-être que ça va avec ce qui se passe avec les médias, avec le fait qu’on tende à favoriser des messages de plus en plus courts. On le voit en tant qu’expert à la radio, à la télévision et même dans l’espace qui nous est alloué dans les journaux qui réduisent », suggère Élisabeth Vallet.
« En ayant moins d’espace [dans les médias], on va nécessairement réduire le faisceau d’éléments qu’on va apporter pour expliquer ce qui se passe. »
— Élisabeth Vallet, politologue à l’UQAM
Dans un récent dossier du mensuel français Le monde diplomatique, l’économiste Frédéric Lordon envisageait l’adhésion aux théories du complot comme la contrepartie d’un manque de transparence répandu. « Le conspirationnisme n’est pas une psychopathologie de quelques égarés, écrit-il, il est le symptôme nécessaire de la dépossession du politique et de la confiscation du débat public. »
« Il y a probablement beaucoup de ça, reconnaît Élisabeth Vallet. Ça joue énormément, mais j’ai l’impression que les pics de complot, ce sont des moments où, simultanément, le débat est réduit et il y a des événements qui touchent les gens et auxquels on cherche des explications quasiment monolithiques. » Comme les attentats du 11-Septembre.
JE DOUTE, DONC JE SUIS
Remettre en question la parole des autorités est un réflexe qui n’a, de prime abord, rien de malsain. « Le doute est même une preuve d’intelligence, fait valoir la psychologue Rachida Azdouz, qui est aussi directrice du Centre d’études et de formation en enseignement supérieur de l’Université de Montréal.
Douter, c’est être libre par rapport aux idées toutes faites qu’on veut nous asséner. » Ce doute se transforme en pensée conspirationniste lorsqu’il devient la pierre d’assise d’une méfiance « viscérale » et « excessive » à l’endroit de la parole officielle, selon elle.
Ce qui rassemble les « Truthers », qui réclament une nouvelle enquête sur le 11-Septembre, c’est d’abord le fait de ne pas croire à la version officielle. En analysant des débats en ligne, Michael J. Wood a d’ailleurs constaté que les partisans du complot avancent peu d’arguments pour soutenir leur point de vue ou défendre une explication différente. « Ils passent l’essentiel de leur temps à pointer les trous de l’histoire officielle », résume-t-il.
Ce qui continue d’intriguer ce psychologue, c’est qu’en partant des mêmes informations, les partisans des théories du complot et lui arrivent à des conclusions différentes au sujet des forces qui mènent le monde. « Peut-être que les théories du complot ne sont pas aidantes elles-mêmes, mais elles reflètent un état d’esprit positif, nuance-t-il toutefois. C’est le signe que les gens se méfient de leur gouvernement et que celui-ci est imputable. Que les gens demeurent vigilants. »
Ces croyances ont-elles un impact négatif ? « Parfois, oui. Pour ceux qui nient les changements climatiques ou affirment qu’il ne faut pas faire vacciner les enfants, ces théories du complot peuvent être assez dommageables. »
Sapiens : Une brève histoire de l’humanité
Il y a 100 000 ans, la Terre était habitée par au moins six espèces différentes d’hominidés. Une seule a survécu. Nous, les Homo Sapiens.
Comment notre espèce a-t-elle réussi à dominer la planète? Pourquoi nos ancêtres ont-ils uni leurs forces pour créer villes et royaumes? Comment en sommes-nous arrivés à créer les concepts de religion, de nation, de droits de l’homme? À dépendre de l’argent, des livres et des lois? À devenir esclaves de la bureaucratie, des horaires, de la consommation de masse? Et à quoi ressemblera notre monde dans le millénaire à venir?
Véritable phénomène d’édition, traduit dans une trentaine de langues, Sapiens est un livre audacieux, érudit et provocateur. Professeur d’Histoire à l’Université hébraïque de Jérusalem, Yuval Noah Harari mêle l’Histoire à la Science pour remettre en cause tout ce que nous pensions savoir sur l’humanité : nos pensées, nos actes, notre héritage… et notre futur.
« Un animal insignifiant
Il y a environ 13,5 milliards d’années, la matière, l’énergie, le temps et l’espace apparaissaient à l’occasion du Big Bang. L’histoire de ces traits fondamentaux de notre univers est ce qu’on appelle la physique.
Environ 300 000 ans après leur apparition, la matière et l’énergie commencèrent à se fondre en structures complexes, appelées atomes, lesquels se combinèrent ensuite en molécules. L’histoire des atomes, des molécules et de leurs interactions est ce qu’on appelle la chimie.
Voici près de 3,8 milliards d’années, sur la planète Terre, certaines molécules s’associèrent en structures particulièrement grandes et compliquées : les organismes. L’histoire des organismes est ce qu’on appelle la biologie.
Voici près de 70 000 ans, des organismes appartenant à l’espèce Homo sapiens commencèrent à former des structures encore plus élaborées : les cultures. Le développement ultérieur de ces cultures humaines est ce qu’on appelle l’histoire.
Trois révolutions importantes infléchirent le cours de l’histoire. La Révolution cognitive donna le coup d’envoi à l’histoire voici quelque 70 000 ans. La Révolution agricole l’accéléra voici environ 12 000 ans. La Révolution scientifique, engagée voici seulement 500 ans, pourrait bien mettre fin à l’histoire et amorcer quelque chose d’entièrement différent. Ce livre raconte comment ces trois révolutions ont affecté les êtres humains et les organismes qui les accompagnent. »
Un animal insignifiant – Le coût de la pensée
« En dépit de leurs multiples différences, toutes les espèces partagent plusieurs caractéristiques marquantes. La plus notable est la taille extraordinaire du cerveau en comparaison de celui des autres animaux. Les mammifères de 60 kilos ont un cerveau moyen de 200 cm3. Les tout premiers hommes, voici 2,5 millions d’années, avaient un cerveau d’environ 600 cm3. Le Sapiens moderne possède un cerveau moyen de 1200-1400 cm3. Les cerveaux de Neandertal étaient encore plus gros.
Que l’évolution ait sélectionné les gros cerveaux peut bien nous sembler couler de source. Nous sommes si épris de notre grande intelligence que nous imaginons qu’en matière de puissance cérébrale plus on en a, mieux c’est. Si tel était le cas, cependant, la famille des félins aurait aussi produit des chats sachant calculer, et les cochons auraient maintenant lancé leur propre programme spatial. Pourquoi les cerveaux géants sont-ils si rares dans le règne animal ?
Un cerveau géant est épuisant pour le corps. Il n’est pas facile à trimballer, surtout enchâssé dans un crâne massif. Il est plus difficile encore à alimenter. Chez l’Homo sapiens, le cerveau représente autour de 2 % à 3 % du poids corporel total, mais il consomme 25 % de l’énergie du corps quand celui-ci est au repos, contre 8 % seulement pour le cerveau des autres grands singes. Les humains archaïques payèrent leurs gros cerveaux de deux façons. Premièrement, ils passèrent plus de temps à chercher de quoi se nourrir. Deuxièmement, leurs muscles s’atrophièrent. Comme un gouvernement détourne des fonds de la défense vers l’éducation, les hommes détournèrent de l’énergie des biceps vers les neurones. Que ce soit une bonne stratégie pour survivre dans la savane ne va pas de soi. Si un chimpanzé ne peut l’emporter dans une discussion avec un Homo sapiens, le singe peut le déchiqueter comme une poupée de chiffons. »
« Nous supposons qu’un gros cerveau, l’usage d’outils, des capacités d’apprentissage supérieures et des structures sociales complexes sont des avantages immenses. Que ceux-ci aient fait de l’espèce humaine l’animal le plus puissant sur Terre paraît aller de soi. Or, deux bons millions d’années durant, les humains ont joui de tous ces avantages en demeurant des créatures faibles et marginales. Les humains qui vivaient voici un million d’années, malgré leurs gros cerveaux et leurs outils de pierre tranchants, connaissaient la peur constante des prédateurs, du gros gibier rarement chassé, et subsistaient surtout en cueillant des plantes, en ramassant des insectes, en traquant des petits animaux et en mangeant les charognes abandonnées par d’autres carnivores plus puissants.
Un des usages les plus courants des premiers outils de pierre consistait à ouvrir les os pour en extraire la moelle. Selon certains chercheurs, telle serait notre niche originelle. De même que la spécialité des pics est d’extraire les insectes des troncs d’arbre, de même les premiers hommes se spécialisèrent dans l’extraction de la moelle. Pourquoi la moelle ? Eh bien, imaginez que vous observiez une troupe de lions abattre et dévorer une girafe. Vous attendez patiemment qu’ils aient fini. Mais ce n’est pas encore votre tour à cause des chacals et des hyènes – vous n’avez aucune envie de vous frotter à eux – qui récupèrent les restes. C’est seulement après que vous et votre bande oserez approcher de la carcasse, en regardant prudemment à droite et à gauche, puis fouiller les rares tissus comestibles abandonnés. »
« C’est là une clé pour comprendre notre histoire et notre psychologie. Tout récemment encore, le genre Homo se situait au beau milieu de la chaîne alimentaire. Des millions d’années durant, les êtres humains ont chassé des petites créatures et ramassé ce qu’ils pouvaient, tout en étant eux-mêmes chassés par des prédateurs plus puissants. Voici 400 000 ans seulement que plusieurs espèces d’hommes ont commencé à chasser régulièrement le gros gibier ; et 100 000 ans seulement, avec l’essor de l’Homo sapiens, que l’homme s’est hissé au sommet de la chaîne alimentaire. »
« Ce bond spectaculaire du milieu au sommet a eu des conséquences considérables. Les autres animaux situés en haut de la pyramide, tels les lions ou les requins, avaient eu des millions d’années pour s’installer très progressivement dans cette position. Cela permit à l’écosystème de développer des freins et des contrepoids qui empêchaient lions et requins de faire trop de ravages. Les lions devenant plus meurtriers, les gazelles ont évolué pour courir plus vite, les hyènes pour mieux coopérer, et les rhinocéros pour devenir plus féroces. À l’opposé, l’espèce humaine s’est élevée au sommet si rapidement que l’écosystème n’a pas eu le temps de s’ajuster. De surcroît, les humains eux-mêmes ne se sont pas ajustés. La plupart des grands prédateurs de la planète sont des créatures majestueuses. Des millions d’années de domination les ont emplis d’assurance. Le Sapiens, en revanche, ressemble plus au dictateur d’une république bananière. »
« Il n’y a pas si longtemps, nous étions les opprimés de la savane, et nous sommes pleins de peurs et d’angoisses quant à notre position, ce qui nous rend doublement cruels et dangereux. Des guerres meurtrières aux catastrophes écologiques, maintes calamités historiques sont le fruit de ce saut précipité. »
Extrait de: Yuval Noah Harari. « Sapiens : Une brève histoire de l’humanité (ESSAIS DOC.) (French Edition). » Albin Michel, 2015-09-01T22:00:00+00:00.
Yuval Noah Harari, né le 24 février 1976, est professeur d’histoire et auteur du bestseller international Sapiens : Une brève histoire de l’humanité. Il enseigne actuellement au Département d’Histoire de l’Université hébraïque de Jérusalem.
Biographie
Harari, Juif Mizrahim d’origine, est né en Israël de parents libanais. Il se spécialise d’abord en histoire médiévale et militaire et obtient son doctorat à l’université d’Oxford en 2002. Depuis, il a publié de nombreux livres et articles, notamment Special Operations in the Age of Chivalry 1100-1550, The Ultimate Experience : Battlefield Revelations and the Making of Modern War Culture, The Concept of “Decisive Battles” in World History et Armchairs, Coffee and Authority: Eye-witnesses and Flesh-witnesses Speak about War, 1100-2000.
Son livre le plus récent s’intitule Sapiens : Une brève histoire de l’humanité. D’abord publié en hébreu sous le titre Une brève histoire de l’humanité, il a ensuite été traduit dans près de 30 langues[1]. Le livre retrace toute l’histoire de l’humanité, depuis l’évolution de l’Homo Sapiens à l’Âge de pierre jusqu’aux révolutions politiques et technologiques du XXIe siècle. Sapiens est devenu un bestseller en Israël[2][3]. Il a suscité l’intérêt des universitaires aussi bien que celui du grand public et a rapidement fait d’Harari une célébrité[4].
Les vidéos postées sur Youtube des conférences d’Harari en hébreu sur l’histoire du monde ont été visionnées par des dizaines de milliers d’internautes en Israël. Harari propose également une série de cours en ligne gratuits et en anglais intitulée « A Brief History of Humankind »[5]. Plus de 100 000 personnes à travers le monde sont d’ores et déjà inscrites. Enfin Harari a pu se faire connaître dans le monde entier par le biais de ses Ted talks[6].
Et en 2015 Sapiens a été sélectionné par Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, pour figurer dans son « online book club »[7], ce dernier invitant ses 38 millions de contacts[2] à lire un livre qu’il présente comme « un grand récit sur l’histoire de la civilisation humaine »[8].
- ↑ Payne, Tom (26 September 2014). « Sapiens: a Brief History of Humankind by Yuval Noah Harari, review: ‘urgent questions' ». The Telegraph. Retrieved 29 October 2014.
- ↑ a et b http://www.theguardian.com/culture/2015/jul/05/yuval-harari-sapiens-interview-age-of-cyborgs
- ↑ http://www.thebookseller.com/profile/yuval-noah-harari-interview
- ↑ Fast talk / The road to happiness, in Haaretz, April 25, 2012
- ↑ http://www.melsophia.org/2013/08/16/histoire-de-l-humanite/
- ↑ https://www.youtube.com/watch?v=YZa4sdIwV04
- ↑ http://uk.businessinsider.com/mark-zuckerberg-recommends-sapiens-a-brief-history-of-humankind-2015-6?r=US&IR=T
- ↑ (en) « Page Facebook de Mark Zuckerberg », sur www.facebook.com, 16 juin 2015(consulté le 25 août 2015)
Réflexions sur la décroissance
Nous partageons ici cette réflexion intéressante comprenant quelques lectures de référence.
Comment faire croître la décroissance?

L’appel explicite à une « décroissance soutenable » a été lancé au début des années 2000, en Europe latine d’abord, contre l’idéologie du « développement durable » surtout, mais contre aussi le développement tout court.
Pour les « objecteurs de croissance », le « développement durable » ou aujourd’hui la « croissance verte » ne permettront que de «polluer moins pour polluer plus longtemps». Rappelant qu’une croissance économique infinie dans un monde fini n’est pas possible, ils ajoutent qu’elle n’est pas souhaitable. Cette croissance est pour eux en effet synonyme d’injustices entre humains et de soumission à une mégamachine technocapitaliste de plus en plus aliénante.
Pour la plupart d’entre eux cependant, la décroissance n’est plus une option. La question est de savoir si cette décroissance sera subie, conséquence brutale et incontrôlable du dépassement des limites biophysiques de la planète, ou si elle sera choisie et assumée collectivement, dans le but d’éviter aux humains, en particulier aux plus démunis d’entre eux, les effets désastreux d’un tel dépassement. Militer en faveur de la « décroissance soutenable », c’est croire qu’il est encore possible de mettre en oeuvre cette décroissance choisie.
Parmi les textes fondateurs de la décroissance, il faut mentionner le rapport sulfureux publié en 1972 par le Club de Rome sous le titre Halte à la croissance! L’équipe Meadows du Massachusetts Institute of Technology (MIT) affirmait que l’humanité était sur le point d’atteindre les limites de son exploitation des ressources naturelles. Seule solution pour éviter un effondrement au cours du XXIe siècle : l’arrêt de la croissance économique et de la croissance démographique.
Précurseurs
Un tel discours, remettant en question les fondements de la civilisation industrielle, ne pouvait que susciter le scepticisme, aussi bien à gauche qu’à droite. L’idée qu’il pourrait y avoir des limites biophysiques à la croissance économique n’est guère plus présente en effet dans la tradition socialiste que dans la tradition libérale. Il existe cependant des exceptions.
Du côté libéral, l’oeuvre de John Stuart Mill constitue certainement une référence essentielle. Comme tous les « économistes classiques », ce philosophe anglais considérait que la croissance économique ne pouvait durer. Mais à la différence de Malthus ou de Ricardo, Mill envisageait la possibilité d’un état stationnaire dans lequel la croissance économique cèderait le pas au développement intellectuel et à l’art de vivre. Cet état stationnaire se trouve au coeur des préoccupations de l’un des fondateurs de l’économie écologique : Herman Daly.
Formé par l’économiste hétérodoxe Nicholas Georgescu-Roegen, autre inspirateur essentiel de la décroissance, Daly a consacré une bonne partie de ses travaux à faire la critique des théories économiques dominantes, auxquelles il reproche de ne pas tenir compte des contraintes biophysiques qui pèsent sur toutes les activités de production. Mais contrairement à son maître Georgescu-Roegen pour qui la décroissance était la seule manière de sauver l’espèce humaine, il promeut une économie stationnaire, reposant sur des flux de matière et d’énergie n’excédant pas les capacités de régénération et d’absorption de la planète.
Du côté socialiste, on trouve également quelques précurseurs de la décroissance, qui eux aussi font figure de penseurs hétérodoxes au sein de leur tradition intellectuelle. Le premier d’entre eux est l’anglais William Morris. Pour Morris, ce n’est pas seulement la domination du capital sur le travail qui fait problème dans la société occidentale du XIXe siècle, mais c’est aussi l’industrialisation du monde elle-même. Une telle critique reste centrale aujourd’hui dans la mouvance décroissanciste. On la retrouve chez certains critiques de la technique, tels que Gunther Anders, Jacques Ellul, Bernard Charbonneau ou Ivan Illich.
Critique du dévelopement
Mais elle est constitutive aussi d’un autre courant de pensée central au sein de la mouvance décroissanciste : la critique du développement. Outre Serge Latouche et Gilbert Rist, cette critique essentielle a été formulée en particulier par François Partant, Wolfgang Sachs et à nouveau Ivan Illich, à partir des années 1960. Elle consiste à dénoncer « l’aide au développement » lancée par Truman et ses alliés en 1949. Il s’agit de refuser d’un même geste un discours pseudogénéreux à l’égard d’une grande partie du monde qualifiée désormais de « sous-développée » et des pratiques effectives visant à entretenir ces mêmes pays dans un état de dépendance à l’égard du « monde développé ».
Parmi les inspirateurs socialistes de la décroissance, on trouve par ailleurs deux critiques importants du marxisme des années 1960 et 1970 : Cornelius Castoriadis et André Gorz. Les objecteurs de croissance doivent au premier deux idées capitales de leur mouvement : l’appel à une «décolonisation de notre imaginaire» et la valorisation de l’autonomie collective.
Au second, ils doivent d’avoir formulé de manière particulièrement rigoureuse et éclairante les trois critiques constitutives de l’idéologie de la décroissance. Dès 1975, Gorz dénonçait le caractère à la fois destructeur, injuste et aliénant de la quête de croissance caractéristique du capitalisme. Appelant à «rompre le lien entre plus et mieux», il faisait la promotion d’une abondance frugale, qui n’avait rien à voir, il faut le souligner, avec l’austérité capitaliste qu’on nous impose aujourd’hui au nom de l’équilibre budgétaire.
On peut affirmer aujourd’hui que la « décroissance soutenable » a cessé d’être ce slogan provocateur qu’elle avait tendance à être il y a encore dix ans. L’idée a fait son chemin — elle est même enseignée à HEC Montréal par l’un d’entre nous ! Cela dit, force est d’admettre qu’elle n’a pas suscité encore de véritable mouvement social. Bien souvent, elle reste une idée d’intellectuels à laquelle celles et ceux qui ne sont pas friands de réflexion théorique peinent à s’identifier.
Pourquoi ne parvient-elle pas à s’imposer comme la bannière rassembleuse qu’elle prétend pouvoir être ? À quelles conditions pourrait-elle jouer ce rôle ? Ou bien doit-elle se résoudre à n’être qu’un courant de pensée susceptible d’influencer les mouvements engagés dans la transformation de nos sociétés ? Telles sont quelques-unes des questions que soulève aujourd’hui cette idéologie.
Des commentaires ou des suggestions pour Des Idées en revues? Écrivez à arobitaille et à gtaillefer.
Déviances comportementales des religions
Voici un excellent cas d’observation des phénomènes de stratégies comportementales psychosociales erronées induites par des concepts et mécanismes religieux associés à des croyances déconnectées de la réalité des faits.
La dérision fait parti intégrante des stratégies comportementales humaines et apparaît lorsque des concepts ou mécanismes de société sont erronés. Il s’agit d’un comportement expressif d’opposition normal qui peut être dommageable seulement s’il dégénère en intimidation qui peut s’aggraver jusqu’à des comportements violents.
Les religions sont des organisations sociales regroupant des individus partageant une même croyance. Les croyances font parti des stratégies comportementales humaines lorsque l’absence ou le manque de connaissances ou de reconnaissance de faits ne permet pas d’expliquer certains phénomènes des Environmental humain, biophysique ou social.
Rien ni aucune loi naturelle ne justifie qu’un respect sans bornes doive être accordé aux concepts sociaux de religion et s’imposer aux comportements humains.
En aucun cas il ne peut être envisagé qu’une quelconque loi de convention sociale puisse contrevenir à des lois immuables et intransgressibles des environnements humain ou biophysique.
Interdire le comportement de dérision est aussi absurde que d’interdire à l’humain de se comporter comme un humain…
Un musulman veut interdire la dérision
© La Presse canadienne
QUÉBEC — La loi devrait explicitement interdire à quiconque de se moquer de la religion, a soutenu jeudi un des leaders de la communauté musulmane du Québec, Salam Elmenyawi.
En commission parlementaire qui étudie le projet de loi 59 sur le discours haineux, le président du Conseil musulman de Montréal a tenu des propos qui ont fait sourciller les partis d’opposition, estimant que M. Elmenyawi cherchait en fait à brimer la liberté d’expression au Québec.
Il a plaidé pour que Québec adopte la ligne dure avec son projet de loi 59, affirmant qu’il pouvait tolérer qu’on l’insulte, lui, mais jamais qu’on insulte sa religion.
Le mémoire présenté par le Conseil musulman de Montréal exhorte Québec à inclure notamment dans son projet de loi «la prévention de la dérision et le dénigrement de toute religion et de ses personnalités».
Car la liberté d’expression ne devrait pas inclure le droit de tourner en dérision une religion, a insisté M. Elmenyawi, qui ne s’exprimait qu’en anglais. Ses propos étaient traduits en français par un interprète.
La députée caquiste de Montarville, Nathalie Roy, lui a fait remarquer que son discours allait totalement à l’encontre des Chartes des droits, québécoise et canadienne, qui garantissent à toute personne le droit de s’exprimer librement.
«Vous allez loin, a commenté Mme Roy. Si on ne peut pas se moquer, si on ne peut pas rire d’une religion, quelle qu’elle soit, ça va à l’encontre de notre liberté d’expression. Ca va très, très loin ce que vous demandez.»
Le leader musulman en a rajouté, en faisant valoir que lorsqu’on tourne en dérision l’islam, «vous vous moquez de moi, vous vous moquez de ma femme, vous vous moquez du prophète, de la mère du prophète».
Et il a dit que si une personne ose insulter la mère du prophète, «c’est comme si on insultait ma mère, ça me touche, moi, personnellement».
«Vous pouvez m’insulter, moi, mais n’insultez pas ma religion!», a lancé le leader musulman aux élus réunis dans le Salon rouge de l’Assemblée nationale.
Avec le projet de loi 59, Québec veut s’attaquer aux discours haineux ou incitant à la violence, de même que prévenir les crimes dits d’honneur et les mariages forcés de jeunes filles âgées de 16 ou 17 ans.
Le projet de loi consent également davantage de pouvoir d’enquête à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), lorsqu’elle jugera qu’un groupe ou une communauté peut faire l’objet d’un discours haineux.
Québec vise donc à protéger légalement la communauté musulmane, notamment, contre d’éventuelles attaques, mais le président du Conseil musulman de Montréal juge que le projet de loi devrait être encore plus répressif.
La députée péquiste Agnès Maltais est revenue quant à elle sur le fait que M. Elmenyawi avait dénoncé la motion votée à l’unanimité à l’Assemblée nationale en vue de contrer l’implantation au Québec de tribunaux dit islamiques, en 2005.
L’initiative provenait de l’ex-députée libérale Fatima Houda-Pepin, qui cherchait ainsi à protéger les femmes musulmanes contre la charia, la loi islamique.
Jeudi, M. Elmenyawi a justifié son rejet de la motion en disant qu’il cherchait à éviter «la stigmatisation de la communauté musulmane» par l’Assemblée nationale, qui n’a pas agi de la même façon avec d’autres religions.
«Ma foi, ma religion, vous la dénigrez ainsi dans l’Assemblée nationale», a-t-il plaidé.
Nous avançons comme des somnambules vers la catastrophe
Une analyse de 2011 encore plus d’actualité avec l’accélération du développement économique provoquant le ralentissement du développement humain et l’augmentation des symptômes d’instabilités précurseurs à un effondrement.
http://www.terraeco.net/Comment-vivre-moins-vite-comment,19890.html
Edgar Morin : « Nous avançons comme des somnambules vers la catastrophe »
Que faire dans cette période de crise aiguë ? S’indigner, certes. Mais surtout agir. A 90 ans, le philosophe et sociologue nous invite à résister au diktat de l’urgence. Pour lui, l’espoir est à portée de main. Entretien.
Pourquoi la vitesse est-elle à ce point ancrée dans le fonctionnement de notre société ?
La vitesse fait partie du grand mythe du progrès, qui anime la civilisation occidentale depuis le XVIIIe et le XIXe siècle. L’idée sous-jacente, c’est que nous allons grâce à lui vers un avenir toujours meilleur. Plus vite nous allons vers cet avenir meilleur, et mieux c’est, naturellement. C’est dans cette optique que se sont multipliées les communications, aussi bien économiques que sociales, et toutes sortes de techniques qui ont permis de créer des transports rapides. Je pense notamment à la machine à vapeur, qui n’a pas été inventée pour des motivations de vitesse mais pour servir l’industrie des chemins de fer, lesquels sont eux-mêmes devenus de plus en plus rapides. Tout cela est corrélatif par le fait de la multiplication des activités et rend les gens de plus en plus pressés. Nous sommes dans une époque où la chronologie s’est imposée.
Cela est-il donc si nouveau ?
Dans les temps anciens, vous vous donniez rendez-vous quand le soleil se trouvait au zénith. Au Brésil, dans des villes comme Belém, encore aujourd’hui, on se retrouve « après la pluie ». Dans ces schémas, vos relations s’établissent selon un rythme temporel scandé par le soleil. Mais la montre-bracelet, par exemple, a fait qu’un temps abstrait s’est substitué au temps naturel. Et le système de compétition et de concurrence – qui est celui de notre économie marchande et capitaliste – fait que pour la concurrence, la meilleure performance est celle qui permet la plus grande rapidité. La compétition s’est donc transformée en compétitivité, ce qui est une perversion de la concurrence.
Cette quête de vitesse n’est-elle pas une illusion ?
En quelque sorte si. On ne se rend pas compte – alors même que nous pensons faire les choses rapidement – que nous sommes intoxiqués par le moyen de transport lui-même qui se prétend rapide. L’utilisation de moyens de transport toujours plus performants, au lieu d’accélérer notre temps de déplacement, finit – notamment à cause des embouteillages – par nous faire perdre du temps ! Comme le disait déjà Ivan Illich (philosophe autrichien né en 1926 et mort en 2002, ndlr) : « La voiture nous ralentit beaucoup. » Même les gens, immobilisés dans leur automobile, écoutent la radio et ont le sentiment d’utiliser malgré tout le temps de façon utile. Idem pour la compétition de l’information. On se rue désormais sur la radio ou la télé pour ne pas attendre la parution des journaux. Toutes ces multiples vitesses s’inscrivent dans une grande accélération du temps, celui de la mondialisation. Et tout cela nous conduit sans doute vers des catastrophes.
Le progrès et le rythme auquel nous le construisons nous détruit-il nécessairement ?
Le développement techno-économique accélère tous les processus de production de biens et de richesses, qui eux-mêmes accélèrent la dégradation de la biosphère et la pollution généralisée. Les armes nucléaires se multiplient et on demande aux techniciens de faire toujours plus vite. Tout cela, effectivement, ne va pas dans le sens d’un épanouissement individuel et collectif !
Pourquoi cherchons-nous systématiquement une utilité au temps qui passe ?
Prenez l’exemple du déjeuner. Le temps signifie convivialité et qualité. Aujourd’hui, l’idée de vitesse fait que dès qu’on a fini son assiette, on appelle un garçon qui se dépêche pour débarrasser et la remplacer. Si vous vous emmerdez avec votre voisin, vous aurez tendance à vouloir abréger ce temps. C’est le sens du mouvement slow food dont est née l’idée de « slow life », de « slow time » et même de « slow science ». Un mot là-dessus. Je vois que la tendance des jeunes chercheurs, dès qu’ils ont un domaine, même très spécialisé, de travail, consiste pour eux à se dépêcher pour obtenir des résultats et publier un « grand » article dans une « grande » revue scientifique internationale, pour que personne d’autre ne publie avant eux. Cet esprit se développe au détriment de la réflexion et de la pensée. Notre temps rapide est donc un temps antiréflexif. Et ce n’est pas un hasard si fleurissent dans notre pays un certain nombre d’institutions spécialisées qui prônent le temps de méditation. Le yoguisme, par exemple, est une façon d’interrompre le temps rapide et d’obtenir un temps tranquille de méditation. On échappe de la sorte à la chronométrie. Les vacances, elles aussi, permettent de reconquérir son temps naturel et ce temps de la paresse. L’ouvrage de Paul Lafargue Le droit à la paresse (qui date de 1880, ndlr) reste plus actuel que jamais car ne rien faire signifie temps mort, perte de temps, temps non-rentable.
Pourquoi ?
Nous sommes prisonniers de l’idée de rentabilité, de productivité et de compétitivité. Ces idées se sont exaspérées avec la concurrence mondialisée, dans les entreprises, puis répandues ailleurs. Idem dans le monde scolaire et universitaire ! La relation entre le maître et l’élève nécessite un rapport beaucoup plus personnel que les seules notions de rendement et de résultats. En outre, le calcul accélère tout cela. Nous vivons un temps où il est privilégié pour tout. Aussi bien pour tout connaître que pour tout maîtriser. Les sondages qui anticipent d’un an les élections participent du même phénomène. On en arrive à les confondre avec l’annonce du résultat. On tente ainsi de supprimer l’effet de surprise toujours possible.
A qui la faute ? Au capitalisme ? A la science ?
Nous sommes pris dans un processus hallucinant dans lequel le capitalisme, les échanges, la science sont entraînés dans ce rythme. On ne peut rendre coupable un seul homme. Faut-il accuser le seul Newton d’avoir inventé la machine à vapeur ? Non. Le capitalisme est essentiellement responsable, effectivement. Par son fondement qui consiste à rechercher le profit. Par son moteur qui consiste à tenter, par la concurrence, de devancer son adversaire. Par la soif incessante de « nouveau » qu’il promeut grâce à la publicité… Quelle est cette société qui produit des objets de plus en plus vite obsolètes ? Cette société de consommation qui organise la fabrication de frigos ou de machines à laver non pas à la durée de vie infinie, mais qui se détraquent au bout de huit ans ? Le mythe du nouveau, vous le voyez bien – et ce, même pour des lessives – vise à toujours inciter à la consommation. Le capitalisme, par sa loi naturelle – la concurrence –, pousse ainsi à l’accélération permanente, et par sa pression consommationniste, à toujours se procurer de nouveaux produits qui contribuent eux aussi à ce processus.
On le voit à travers de multiples mouvements dans le monde, ce capitalisme est questionné. Notamment dans sa dimension financière…
Nous sommes entrés dans une crise profonde sans savoir ce qui va en sortir. Des forces de résistance se manifestent effectivement. L’économie sociale et solidaire en est une. Elle incarne une façon de lutter contre cette pression. Si on observe une poussée vers l’agriculture biologique avec des petites et moyennes exploitations et un retour à l’agriculture fermière, c’est parce qu’une grande partie de l’opinion commence à comprendre que les poulets et les porcs industrialisés sont frelatés et dénaturent les sols et la nappe phréatique. Une quête vers les produits artisanaux, les Amap (Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne, ndlr), indique que nous souhaitons échapper aux grandes surfaces qui, elles-mêmes, exercent une pression du prix minimum sur le producteur et tentent de répercuter un prix maximum sur le consommateur. Le commerce équitable tente, lui aussi, de court-circuiter les intermédiaires prédateurs. Certes, le capitalisme triomphe dans certaines parties du monde, mais une autre frange voit naître des réactions qui ne viennent pas seulement des nouvelles formes de production (coopératives, exploitations bio), mais de l’union consciente des consommateurs. C’est à mes yeux une force inemployée et faible car encore dispersée. Si cette force prend conscience des produits de qualité et des produits nuisibles, superficiels, une force de pression incroyable se mettra en place et permettra d’influer sur la production.
Les politiques et leurs partis ne semblent pas prendre conscience de ces forces émergentes. Ils ne manquent pourtant pas d’intelligence d’analyse…
Mais vous partez de l’hypothèse que ces hommes et femmes politiques ont déjà fait cette analyse. Or, vous avez des esprits limités par certaines obsessions, certaines structures.
Par obsession, vous entendez croissance ?
Oui ! Ils ne savent même pas que la croissance – à supposer qu’elle revienne un jour dans les pays que l’on dit développés – ne dépassera pas 2 % ! Ce n’est donc pas cette croissance-là qui parviendra à résoudre la question de l’emploi ! La croissance que l’on souhaite rapide et forte est une croissance dans la compétition. Elle amène les entreprises à mettre des machines à la place des hommes et donc à liquider les gens et à les aliéner encore davantage. Il me semble donc terrifiant de voir que des socialistes puissent défendre et promettre plus de croissance. Ils n’ont pas encore fait l’effort de réfléchir et d’aller vers de nouvelles pensées.
Décélération signifierait décroissance ?
Ce qui est important, c’est de savoir ce qui doit croître et ce qui doit décroître. Il est évident que les villes non polluantes, les énergies renouvelables et les grands travaux collectifs salutaires doivent croître. La pensée binaire, c’est une erreur. C’est la même chose pour mondialiser et démondialiser : il faut poursuivre la mondialisation dans ce qu’elle créé de solidarités entre les peuples et envers la planète, mais il faut la condamner quand elle crée ou apporte non pas des zones de prospérité mais de la corruption ou de l’inégalité. Je milite pour une vision complexe des choses.
La vitesse en soi n’est donc pas à blâmer ?
Voilà. Si je prends mon vélo pour aller à la pharmacie et que je tente d’y parvenir avant que celle-ci ne ferme, je vais pédaler le plus vite possible. La vitesse est quelque chose que nous devons et pouvons utiliser quand le besoin se fait sentir. Le vrai problème, c’est de réussir le ralentissement général de nos activités. Reprendre du temps, naturel, biologique, au temps artificiel, chronologique et réussir à résister. Vous avez raison de dire que ce qui est vitesse et accélération est un processus de civilisation extrêmement complexe, dans lequel techniques, capitalisme, science, économie ont leur part. Toutes ces forces conjuguées nous poussent à accélérer sans que nous n’ayons aucun contrôle sur elles. Car notre grande tragédie, c’est que l’humanité est emportée dans une course accélérée, sans aucun pilote à bord. Il n’y a ni contrôle, ni régulation. L’économie elle-même n’est pas régulée. Le Fonds monétaire international n’est pas en ce sens un véritable système de régulation.
Le politique n’est-il pas tout de même censé « prendre le temps de la réflexion » ?
On a souvent le sentiment que par sa précipitation à agir, à s’exprimer, il en vient à œuvrer sans nos enfants, voire contre eux… Vous savez, les politiques sont embarqués dans cette course à la vitesse. J’ai lu une thèse récemment sur les cabinets ministériels. Parfois, sur les bureaux des conseillers, on trouvait des notes et des dossiers qualifiés de « U » pour « urgent ». Puis sont apparus les « TU » pour « très urgent » puis les « TTU ». Les cabinets ministériels sont désormais envahis, dépassés. Le drame de cette vitesse, c’est qu’elle annule et tue dans l’œuf la pensée politique. La classe politique n’a fait aucun investissement intellectuel pour anticiper, affronter l’avenir. C’est ce que j’ai tenté de faire dans mes livres comme Introduction à une politique de l’homme, La voie, Terre-patrie… L’avenir est incertain, il faut essayer de naviguer, trouver une voie, une perspective. Il y a toujours eu, dans l’Histoire, des ambitions personnelles. Mais elles étaient liées à des idées. De Gaulle avait sans doute une ambition, mais il avait une grande idée. Churchill avait de l’ambition au service d’une grande idée, qui consistait à vouloir sauver l’Angleterre du désastre. Désormais, il n’y a plus de grandes idées, mais de très grandes ambitions avec des petits bonshommes ou des petites bonnes femmes.
Michel Rocard déplorait il y a peu pour « Terra eco » la disparition de la vision à long terme…
Il a raison, mais il a tort. Un vrai politique ne se positionne pas dans l’immédiat mais dans l’essentiel. A force d’oublier l’essentiel pour l’urgence, on finit par oublier l’urgence de l’essentiel. Ce que Michel Rocard appelle le « long terme », je l’intitule « problème de fond », « question vitale ». Penser qu’il faut une politique planétaire pour la sauvegarde de la biosphère – avec un pouvoir de décision qui répartisse les responsabilités car on ne peut donner les mêmes responsabilités à des pays riches et à des pays pauvres –, c’est une politique essentielle à long terme. Mais ce long terme doit être suffisamment rapide car la menace elle-même se rapproche.
Le président de la République Nicolas Sarkozy n’incarne-t-il pas l’immédiateté et la présence médiatique permanente ?
Il symbolise une agitation dans l’immédiateté. Il passe à des immédiatetés successives. Après l’immédiateté, qui consiste à accueillir le despote libyen Kadhafi car il a du pétrole, succède l’autre immédiateté, où il faut détruire Kadhafi sans pour autant oublier le pétrole… En ce sens, Sarkozy n’est pas différent des autres responsables politiques, mais son caractère versatile et capricieux en font quelqu’un de très singulier pour ne pas dire un peu bizarre.
Edgar Morin, vous avez 90 ans. L’état de perpétuelle urgence de nos sociétés vous rend-il pessimiste ?
Cette absence de vision m’oblige à rester sur la brèche. Il y a une continuité dans la discontinuité. Je suis passé de l’époque de la Résistance où j’étais jeune, où il y avait un ennemi, un occupant et un danger mortel, à d’autres formes de résistances qui ne portaient pas, elles, de danger de mort, mais celui de rester incompris, calomnié ou bafoué. Après avoir été communiste de guerre et après avoir combattu l’Allemagne nazie avec de grands espoirs, j’ai vu que ces espoirs étaient trompeurs et j’ai rompu avec ce totalitarisme-là, devenu ennemi de l’humanité. J’ai combattu cela et résisté. J’ai ensuite – naturellement – défendu l’indépendance du Vietnam ou de l’Algérie, quand il s’agissait de liquider un passé colonial. Cela me semblait si logique après avoir lutté pour la propre indépendance de la France, mise en péril par le nazisme. Au bout du compte, nous sommes toujours pris dans des nécessités de résister.
Et aujourd’hui ?
Aujourd’hui, je me rends compte que nous sommes sous la menace de deux barbaries associées. Humaine tout d’abord, qui vient du fond de l’histoire et qui n’a jamais été liquidée : le camp américain de Guantánamo ou l’expulsion d’enfants et de parents que l’on sépare, ça se passe aujourd’hui ! Cette barbarie-là est fondée sur le mépris humain. Et puis la seconde, froide et glacée, fondée sur le calcul et le profit. Ces deux barbaries sont alliées et nous sommes contraints de résister sur ces deux fronts. Alors, je continue avec les mêmes aspirations et révoltes que celles de mon adolescence, avec cette conscience d’avoir perdu des illusions qui pouvaient m’animer quand, en 1931, j’avais dix ans.
La combinaison de ces deux barbaries nous mettrait en danger mortel…
Oui, car ces guerres peuvent à tout instant se développer dans le fanatisme. Le pouvoir de destruction des armes nucléaires est immense et celui de la dégradation de la biosphère pour toute l’humanité est vertigineux. Nous allons, par cette combinaison, vers des cataclysmes. Toutefois, le probable, le pire, n’est jamais certain à mes yeux, car il suffit parfois de quelques événements pour que l’évidence se retourne.
Des femmes et des hommes peuvent-ils aussi avoir ce pouvoir ?
Malheureusement, dans notre époque, le système empêche les esprits de percer. Quand l’Angleterre était menacée à mort, un homme marginal a été porté au pouvoir, qui se nommait Churchill. Quand la France était menacée, ce fut De Gaulle. Pendant la Révolution, de très nombreuses personnes, qui n’avaient aucune formation militaire, sont parvenues à devenir des généraux formidables, comme Hoche ou Bonaparte ; des avocaillons comme Robespierre, de grands tribuns. Des grandes époques de crise épouvantable suscitent des hommes capables de porter la résistance. Nous ne sommes pas encore assez conscients du péril. Nous n’avons pas encore compris que nous allons vers la catastrophe et nous avançons à toute allure comme des somnambules.
Le philosophe Jean-Pierre Dupuy estime que de la catastrophe naît la solution. Partagez-vous son analyse ?
Il n’est pas assez dialectique. Il nous dit que la catastrophe est inévitable mais qu’elle constitue la seule façon de savoir qu’on pourrait l’éviter. Moi je dis : la catastrophe est probable, mais il y a l’improbabilité. J’entends par « probable », que pour nous observateurs, dans le temps où nous sommes et dans les lieux où nous sommes, avec les meilleures informations disponibles, nous voyons que le cours des choses nous emmène à toute vitesse vers les catastrophes. Or, nous savons que c’est toujours l’improbable qui a surgi et qui a « fait » la transformation. Bouddha était improbable, Jésus était improbable, Mahomet, la science moderne avec Descartes, Pierre Gassendi, Francis Bacon ou Galilée était improbables, le socialisme avec Marx ou Proudhon était improbable, le capitalisme était improbable au Moyen-Age… Regardez Athènes. Cinq siècles avant notre ère, vous avez une petite cité grecque qui fait face à un empire gigantesque, la Perse. Et à deux reprises – bien que détruite la seconde fois – Athènes parvient à chasser ces Perses grâce au coup de génie du stratège Thémistocle, à Salamine. Grâce à cette improbabilité incroyable est née la démocratie, qui a pu féconder toute l’histoire future, puis la philosophie. Alors, si vous voulez, je peux aller aux mêmes conclusions que Jean-Pierre Dupuy, mais ma façon d’y aller est tout à fait différente. Car aujourd’hui existent des forces de résistance qui sont dispersées, qui sont nichées dans la société civile et qui ne se connaissent pas les unes les autres. Mais je crois au jour où ces forces se rassembleront, en faisceaux. Tout commence par une déviance, qui se transforme en tendance, qui devient une force historique. Nous n’en sommes pas encore là, certes, mais c’est possible.
Il est donc possible de rassembler ces forces, d’engager la grande métamorphose, de l’individu puis de la société ?
Ce que j’appelle la métamorphose, c’est le terme d’un processus dans lequel de multiples réformes, dans tous les domaines, commencent en même temps.
Nous sommes déjà dans un processus de réformes…
Non, non. Pas ces pseudo-réformes. Je parle de réformes profondes de vie, de civilisation, de société, d’économie. Ces réformes-là devront se mettre en marche simultanément et être intersolidaires.
Vous appelez cette démarche « le bien-vivre ». L’expression semble faible au regard de l’ambition que vous lui conférez.
L’idéal de la société occidentale – « bien-être » – s’est dégradé en des choses purement matérielles, de confort et de propriété d’objet. Et bien que ce mot « bien-être » soit très beau, il fallait trouver autre chose. Et quand le président de l’Equateur Rafael Correa a trouvé cette formule de « bien-vivre », reprise ensuite par Evo Morales (le président bolivien, ndlr), elle signifiait un épanouissement humain, non seulement au sein de la société mais aussi de la nature. L’expression « bien vivir » est sans doute plus forte en espagnol qu’en français. Le terme est « actif » dans la langue de Cervantès et passif dans celle de Molière. Mais cette idée est ce qui se rapporte le mieux à la qualité de la vie, à ce que j’appelle la poésie de la vie, l’amour, l’affection, la communion et la joie et donc au qualitatif, que l’on doit opposer au primat du quantitatif et de l’accumulation. Le bien-vivre, la qualité et la poésie de la vie, y compris dans son rythme, sont des choses qui doivent – ensemble – nous guider. C’est pour l’humanité une si belle finalité. Cela implique aussi et simultanément de juguler des choses comme la spéculation internationale… Si l’on ne parvient pas à se sauver de ces pieuvres qui nous menacent et dont la force s’accentue, s’accélère, il n’y aura pas de bien-vivre. —
L’IRASD dévoile son plan de recherche
Après plusieurs mois de travail, l’IRASD diffuse son plan de recherche. Cette première version, loin d’être définitive, est plutôt évolutive et les thèmes à aborder seront bonifiés au fil de l’avancement des travaux.
Le plan de recherche de l’IRASD vise à diriger les efforts de recherche vers les divers domaines des sciences naturelles, physiques et sociales identifiées pour décrire et documenter les principaux concepts clefs définissant les environnements humain, biophysique et social pouvant contribuer à valider l’hypothèse de l’objectif principal du plan maître :
Démontrer scientifiquement que des concepts-acteurs de l’environnement social interagissent avec la nature humaine pour induire des comportements décisionnels nuisibles à la pérennité de la civilisation et de l’espèce humaine.
Objectifs du plan de recherche
- Répondre aux questions qui permettent de décrire les environnements.
- Circonscrire, définir et documenter la portée du plan de recherche.
- Déterminer les domaines de spécialisation requis en sciences pures et sociales.
- Distribuer le travail de recherche et de documentation.
Le plan sera mis à jour pour préciser des aspects des travaux ou des sujets visés.
Stéphane Brousseau – Directeur de recherche
B.Sc. Géologie
Analyste et architecte en technologies de l’information et des communications
Chercheur en architecture sociale durable
L’accroissement des instabilités, des précurseurs à l’effondrement
Les instabilités boursières du système économique monétaire à la base de la civilisation humaine ne datent pas d’hier. L’instabilité du système économique humain qui s’accentue depuis 2008 n’est qu’un symptôme des déviances comportementales induites par les concepts et mécanismes de l’organisation sociale de l’espèce.
« Les villes intensifiant la mondialisation et la mondialisation intensifiant les villes, le commerce mondial s’est multiplié par 11 entre 1980 et 2004 – de 580 milliards de dollars à plus de 6000 milliards. » – Stewart Brand, « Discipline pour la planète Terre », 2010
Lorsque les pressions exercées sur les environnements humain, biophysique et social s’accroissent simultanément, la probabilité de déstabilisation du système grandit (1), augmentant le risque d’effondrement (2). Surtout lorsque plusieurs autres variables se retrouvent sous une même pression croissante; celle de la volonté comportementale de faire croitre l’économie monétaire.
La civilisation humaine est actuellement sur un pic instable. (6) La croissance économique et les déviances comportementales psychosociales pour l’accélérer ont également engendré des pressions sur la surexploitation des ressources humaines et naturelles. (3) L’augmentation est proportionnelle à l’accroissement de la population et l’agrandissement des villes supportées par les industries en est une des conséquences.
« L’argent mène le monde! » Mais il le détruit également. L’espèce humaine est-elle suffisamment évoluée pour en prendre conscience? Est-elle suffisamment mature pour se départir de ce modèle? (4)
L’homme a déjà perdu le contrôle de son système social et il est en train de perdre le contrôle de son environnement planétaire. (1)
L’adolescence de l’espèce tire à sa fin, il est temps que l’homme se prenne en main.
La partie de plaisir est terminée, il n’y a plus de place pour le jeu.
L’action est urgente, l’acquisition de connaissances une nécessité et la réforme une obligation inévitable.
Mais l’homme est-il préparé à agir? (5)
À l’IRASD, nous préparons le terrain pour agir. Car agir n’importe comment en faisant n’importe quoi mène à de mauvaises décisions ou à de pires résultats.
Corriger ce qui a été fait avec les mêmes moyens que ce qui l’a provoqué n’est pas une bonne idée.
Introduire de nouveaux concepts et mecanismes de société exige des connaissances et un certain temps.
Nos travaux de recherche ont pour objectif de documenter des dossiers thématiques qui serviront de bases de connaissances pour réaliser l’architecture sociale des solutions pour notre civilisation.
L’IRASD forme une équipe microscopique comparée à l’ampleur de la tâche qui consiste à architecturer des modèles de fonctionnement soutenables et durables pour la société humaine.
Sans l’implication de chercheurs et de citoyens engagés, la tâche est colossale et le temps requis risque de se prolonger au-delà de l’effondrement.
(1) https://irasd.wordpress.com/2015/08/05/synthese-des-donnees-planetaires-adrastia/
(2) https://irasd.wordpress.com/2015/08/10/leffondrement-analyse-critique-du-livre/
Dégringolade boursière: quels impacts pour le Canada?

En pleine dégringolade, l’indice Shanghai Composite a chuté de 37 % en deux mois et dans tout le pays, l’économie continue de tourner au ralenti. Doit-on craindre la contagion? Décryptage en cinq questions.
Un texte de Christine Bureau
1. La Bourse de Shanghai a connu hier sa pire journée depuis 2007. Son principal indice, le Shanghai Composite, a chuté de 8,5 % pour clôturer à 3209,91 points. Comment la Chine en est-elle arrivée là?
L’économie chinoise est en décélération depuis plusieurs années, un phénomène qui a récemment pris de l’ampleur. Le marché boursier s’est lui aussi écrasé au cours des derniers mois. La semaine dernière, les autorités chinoises ont voulu redonner du souffle à leurs exportations en dévaluant le yuan de 2 %. La mesure a eu l’effet contraire.
« D’abord, les autorités chinoises ont interdit les ventes à découvert puis, la semaine dernière, ils ont dévalué le yuan, leur monnaie. Ce genre de choses a été vu par les investisseurs internationaux comme un signe de désespoir », soutient le directeur général chef de la recherche pour les particuliers chez BMO Nesbitt Burns, Stéphane Rochon, pour expliquer la récente dégringolade des bourses mondiales.
Selon lui, la Chine essaie « par tous les moyens » de relancer son économie. Mais le fond du problème, lui, reste le même.
« [Les Chinois] ont une économie qui a trop de capacités. Ils ont beaucoup, beaucoup investi dans leurs capacités manufacturières, mais il n’y a pas assez de demandes globalement pour absorber toute cette production. »
— Stéphane Rochon
2. Quels outils se trouvent à la portée de la Chine pour freiner la dégringolade de son marché boursier?
Pékin étudie l’option d’injecter de l’argent frais dans la Bourse de Shanghai. Avec 3,5 trillions de dollars en devises étrangères, la Chine a d’ailleurs les moyens de le faire. Mais Stéphane Rochon croit que ce sera insuffisant pour calmer les marchés.
« Ils font ça depuis un bout de temps déjà et on dirait qu’à chaque fois qu’ils le font, ça a de moins en moins d’effets positifs. Oui, ils peuvent encore [réinjecter de l’argent], mais en fin de compte, l’économie va se stabiliser là où l’économie va se stabiliser. Toutes les mesures qu’ils vont prendre, ce sont des pansements », soutient-il.
Selon lui, la Chine a plutôt intérêt à limiter ses interventions pour laisser l’économie retrouver son « point d’équilibre ». Une croissance annuelle de 10 % comme celle qu’a connue la Chine n’était pas viable à long terme de toute façon, note-t-il.
3. Peut-on parler d’une crise boursière chinoise?
« C’est une correction majeure, réplique Stéphane Rochon. Le problème, c’est que je ne vois pas d’événement catalyseur qui pourrait stabiliser [l’économie chinoise] à court terme. C’est donc possible qu’on voit plus de déclin encore, du moins dans les actions chinoises. »
Il rappelle que c’est un « momentum économique » à la baisse – c’est-à-dire tous les indices -, qui a créé le mouvement de panique sur les marchés. « Généralement, c’est ce qui fait peur aux investisseurs et c’est pour ça qu’on voit les secousses qu’on voit dans la bourse », résume-t-il.
4. Quelles répercussions aura la chute de la Bourse de Shanghai sur sa consoeur de Toronto et sur l’économie canadienne?
Les secteurs de l’énergie et miniers composent 30 % de l’indice canadien S&P/TSX. Or, ce sont justement ces secteurs qui souffrent le plus du ralentissement de la Chine et de sa dégringolade boursière.
Comme il y a peu d’investisseurs étrangers sur la Bourse de Shanghai, les entreprises canadiennes en lien avec le secteur minier et de l’énergie sont celles qui vont le plus subir les impacts financiers de cette chute, ainsi que tous les secteurs connexes, comme le marché immobilier à Calgary.
« Ce n’est pas le fait que la Chine ne consomme pas beaucoup de matières premières, explique Stéphane Rochon. Elle en consomme encore beaucoup, mais d’année en année, l’augmentation de leur consommation descend », surtout pour ce qui est des métaux de base, comme le cuivre. Le prix du pétrole est lui aussi en forte chute, bien que son prix dépende aussi des surplus de production des pays de l’OPEP et de la Russie.
« Les revenus d’impôts ou de taxes de l’Alberta vont baisser en flèche. En termes d’équilibre budgétaire, ça va faire mal au Canada, ça, c’est clair. En termes de péréquation, ça pourrait avoir un effet. »
— Stéphane Rochon
Les États-Unis, malgré des marchés à la baisse de près de 8 % par rapport à leur sommet cette année, s’en tireront mieux que le Canada parce qu’ils ont un énorme marché de consommation interne, note-t-il.
5. À quoi faut-il s’attendre sur les marchés boursiers au cours des prochaines semaines?
« On peut s’attendre à beaucoup de volatilité. Ça ne veut pas dire que ça va continuer descendre à ce rythme-ci, mais une chose qui est claire, c’est qu’il va y avoir beaucoup de volatilité », estime Stéphane Rochon.
Et comme la bourse précède souvent l’économie réelle de six à neuf mois, il est probable que l’économie chinoise continue de tourner au ralenti. « La trajectoire est à la baisse et jusqu’à nouvel ordre, c’est comme ça qu’on devrait penser à l’économie chinoise », conclut-il.
Que sommes-nous censés faire de nos vies, sachant que nous nous dirigeons vers un effondrement ?
Cet article démontre clairement l’effet des déviances comportementales psychosociales résultant de l’interaction des concepts de société avec la nature humaine.
Que sommes-nous censés faire de nos vies, sachant que nous nous dirigeons vers un effondrement?
Article original (en anglais) publié sur le site de VICE, le 28 mars 2014.
Cela devient monnaie courante de dire que nous, « les jeunes », n’avons plus d’avenir. Nous blâmons la crise financière qui entraine des taux de chômage ahurissants ; nous blâmons ces gouvernements inefficaces qui n’ont pas intérêt à nous aider ; nous blâmons les baby-boomers qui ont refusé de léguer un peu de leur richesse aux générations suivantes ; nous blâmons les corporations qui ne fournissent que des emplois à mi-temps, précaire et uniquement dans le service et l’industrie. Et nous avons raison.
Ces problèmes viennent effacer des années de progrès et ne nous laissent qu’une existence stérile et dénuée d’enfance, dont nous ne pouvons nous échapper qu’à l’aide de jeux d’alcools, de petits-dejs chez Taco Bell, de drogues qui nous font moisir de l’intérieur, et de jeux de téléphones mobiles merdiques. Mais qu’allons-nous faire lorsque tout ça nous pètera à la gueule ?
A gauche, un des passe-temps favoris des mal nommés pays « développés », et à droite, la vie de bien trop de gens dans le mal nommé « Tiers-monde », deux facettes de la même organisation humaine mondialisée.
Tout le monde prédit la fin des temps depuis la nuit des temps, manifestement. Dieu allait nous tuer. Puis le Diable. Puis la bombe nucléaire. Maintenant des astéroïdes, ou la mer, nous nos propres comportements de merde. Peu importe ce qui se passe, nous savons qu’un jour tout partira en fumée, et pour les médias, cette paranoïa est du pain béni, l’outil de marketing ultime. La plupart des gens se sont au moins un peu souciés de savoir comment et quand leur espèce s’éteindrait, c’est pourquoi les sectes religieuses apocalyptiques sont toujours à la mode. C’est l’attrape-nigaud de première classe, avec des rebondissements alléchants, le saint Graal des médias modernes.
Malheureusement, lorsque vous lisez le New York Times, ou n’importe quel autre journal, il ne s’agit pas de prophètes de l’apocalypse à la mords-moi-le-nœud avec des pancartes « la Fin des temps » — il s’agit de scientifiques sérieux. Cela donne du poids, non seulement aux histoires individuelles effrayantes sur les grippes aviaires, les pluies acides, mais aussi à l’ensemble de ce panel terrifiant, qui suggère que — à travers une combinaison d’avidité, de stupidité et de cruauté — nous avons réellement saccagé la planète au-delà de toute remédiation, et que le futur ressemble à un film catastrophe de Michael Bay.
La dernière étude que j’ai lu, qui était en partie financée par la NASA, « a souligné la possibilité d’un effondrement de la civilisation industrielle, dans les décennies à venir, en raison de l’exploitation insoutenable des ressources et de la hausse continue de l’inégale distribution des richesses. » Et cela selon le GUARDIAN, un journal respectable, qui, apparemment, ne peut se permettre d’écrire « NOUS SOMMES FOUTUS, NOUS SOMMES FOUTUS, AHHHHH! ». Quoi qu’il en soit, cet article est une lecture intéressante bien que peu réjouissante.
La vraie question, cependant, ne dépend pas du degré d’anéantissement de l’humanité, mais de savoir ce que nous sommes supposés faire de cette information. Y-a-t-il quelque chose que nous puissions faire ? Ou devrions-nous simplement sortir les chaises de la cave, mettre de la bière au frais, et attendre que les voisins commencent à passer les bergers allemands au barbecue ? Enfin, c’est une chose pour les vieux d’entendre que leur planète est foutue et qu’ils passeront leur âge d’or à boire de l’urine sur des radeaux de survie à la Kevin Costner, mais c’en est une autre pour les jeunes d’entendre qu’ils n’ont pas d’avenir.
Si vous avez 20 ans aujourd’hui, à quoi bon? A quoi bon les enfants, la carrière, l’arrêt de la cigarette, la construction d’une famille, l’éducation, ou tout ce qui requiert quelque effort que ce soit ? Pourquoi devrions-nous passer nos années post-adolescence à viser la stabilité matérielle, quand nous savons que cette stabilité commencera à s’effriter dans 15 ans, peu importe nos agissements ? Pourquoi ne pas simplement rester assis à sniffer du protoxyde d’azote, avoir des relations non-protégées avec des étrangers rencontrés sur Grindr et/ou Tinder ?
Cela ne me surprendrait pas. Je ne suis pas sûr que nous soyons une génération particulièrement bonne en ce qui concerne la confrontation de la réalité, de toute façon, et il me semble maintenant que nous sommes la génération qui se retrouve avec la pire des donnes en main. L’idée de la catastrophe environnementale mondiale est si effrayante à saisir que nous courons le risque de nous retrouver comme paralysés, dans un état d’inquiétude perpétuelle, et qu’alors nous continuions à faire ce qu’on a toujours fait avant — i.e., à tout ignorer au-delà de notre weekend.
Aucun d’entre nous ne sait comment réagir face aux sinistres prédictions qui émanent régulièrement des institutions de recherche les plus respectées du monde. Il est peut-être trop tard pour stopper les effets du réchauffement climatique, bien que nous n’ayons absolument pas l’air de vouloir ralentir cet engrenage infernal ; nous sommes trop ancrés dans nos quotidiens. Les solutions semblent soit impossible, soit ont l’air de mesures symboliques trop faibles et arrivant trop tard. Nous maudissons nos ancêtres d’avoir tout foutu en l’air pour nous, mais nous rappelons alors que nous sommes la génération qui a demandé à être emmenée à l’école en voiture, à avoir de plus en plus de consoles de jeux vidéo, de téléphones mobiles et de gadgets de merde. Nous n’avons pas allumé le feu, mais nous n’avons pas non plus exactement essayé de l’éteindre.
Nous vivons donc dans un monde où nous sommes tous responsables, et il n’y a rien que nous puissions y faire. Les nouvelles de l’imminence de l’apocalypse ne deviennent qu’une chose de plus arrivant à quelqu’un d’autre, un nouvel objet pour notre indifférence et notre apathie. A quoi bon en reconnaitre l’existence ? Nous savons que les calottes polaires fondent depuis des années, mais combien d’entre nous ont changé leur mode de vie pour autant ? Continuons tel que nous sommes, et, avec un peu chance, nous nous ficherons de mourir lorsque notre tour viendra.
Bien sûr, il y a eu tout un tas de pétards mouillés et de peurs en ce qui concerne la fin du monde, beaucoup de science-fiction vacillante et très peu de faits, mais le poids écrasant des problèmes auxquels nous faisons face nous donne vraiment l’impression d’être sur la dernière ligne droite du chemin de la destruction.
Le problème, c’est que l’ignorance est bénie lorsque la recherche de la vérité implique de se rendre compte que tous vos amis et vous-mêmes êtes sur la corde raide. Si rien ne peut être fait, il semble alors aussi bien de continuer à vivre nos vies comme nous l’avons toujours fait : avec nos réseaux, avec les mêmes fréquentations, les mêmes bavardages jusqu’à ce que le soleil s’assombrisse et qu’il se mette à pleuvoir des oiseaux.
L’apathie est certainement l’émotion caractérisant le mieux notre époque. Politiquement, culturellement, dans tous les domaines-ment. Tellement que nous semblons incapables de réagir lorsque la NASA suggère que nous ne sommes qu’à quelques décennies de l’effondrement social total, et que toutes les autres agences de renseignements scientifiques suggèrent que les conditions environnementales que nous avons façonnées auront eu raison de nous bien avant.
Tout va bien, cependant. Détendons-nous. Nous avons Angry Birds. Nous avons Drake et Rihanna. Un Starbucks ouvre bientôt à côté. Nous mourrons tous. Rien que nous puissions y faire, pas vrai ?
Clive Martin
Traduction: Nicolas Casaux
Paniquer pour le concept d’argent sans s’inquiéter de l’attrition des ressources
Voici une observation symptomatique des stratégies comportementales psychosociales induites par l’interaction entre la nature humaine et des concepts de société. Nous avons publié une analyse de Jacques Atali sur l’effondrement de l’économie mondiale (1) et les statistiques de consultation sur notre site ont explosé de 25 000%!
À première vue, cette réaction semble démontrer un attachement maladif au concept d’argent qui n’est qu’un outil virtualisé d’estimation de valeur et d’échange de produits et services (2). Cette réaction s’explique par de profondes déviances de valeurs culturelles associant l’argent et l’économie à la capacité de survie de l’espèce, alors que ce sont les ressources et infrastructures naturelles de l’environnement biophysique qui assurent cette capacité.
L’humain, superprédateur destructeur d’écosystèmes
L’analyse des stratégies comportementales de l’humain comme prédateur des autres espèces révèle que les impacts de ses activités de chasse et de pêche ne sont pas soutenables pour le maintien de la biodiversité de la planète. Sans des modifications profondes de ses habitudes, une réduction de sa population est inévitable.
Cette étude ne s’attarde toutefois pas aux Premiers Peuples et tribus isolées de la civilisation, dont les traditions ancestrales favorisaient des stratégies comportementales de chasse et de pêche plus soutenables.
L’être humain, ce superprédateur destructeur d’écosystèmes

Agence France-Presse
WASHINGTON
La surpêche industrielle et la chasse excessive menacent les écosystèmes surtout parce que les animaux adultes, au plus fort de leur potentiel de reproduction, sont les cibles de choix, estiment des chercheurs, plaidant pour une approche plus en harmonie avec la nature.
«Notre technologie très efficace pour tuer, nos systèmes économiques mondialisés et notre gestion des ressources donnant la priorité aux bénéfices à court terme de l’humanité, a favorisé l’émergence du superprédateur humain», explique Chris Darimont, professeur de géographie à l’université de Victoria au Canada. Il est le principal auteur de cette étude publiée jeudi dans la revue américaine Science.
«Les effets de cette approche sont aussi extrêmes que l’est notre comportement de prédateur dominant et la planète en fait les frais», déplore-t-il.
«Alors que les autres prédateurs s’en prennent principalement aux jeunes et aux plus faibles, les humains s’attaquent au capital de reproduction des espèces en chassant les adultes… Une pratique particulièrement marquée dans la pêche.»
Tom Reimchen
professeur de biologie à l’université de Victoria
Pour évaluer la nature et l’étendue de la prédation humaine comparée à celle des animaux, les chercheurs ont analysé 2125 espèces de prédateurs marins et terrestres.
Ils ont conclu que les humains chassent de préférence les poissons et mammifères adultes dans l’océan à un taux quatorze fois supérieur à celui des autres prédateurs marins.
Les hommes chassent et abattent également les grands carnivores terrestres comme les ours, les loups et les lions neuf fois plus que ces derniers s’entretuent dans la nature.
«Alors que les autres prédateurs s’en prennent principalement aux jeunes et aux plus faibles, les humains s’attaquent au capital de reproduction des espèces en chassant les adultes… Une pratique particulièrement marquée dans la pêche», précise Tom Reimchen, professeur de biologie à l’université de Victoria, un des principaux co-auteurs de cette étude.
Et comme le montre la théorie de l’évolution de Darwin, le fait d’éliminer les poissons les plus grands et les plus productifs favorise les individus plus petits qui se développent lentement, relèvent ces scientifiques.
Mais les chercheurs reconnaissent aussi qu’un changement fondamental soudain des pratiques actuelles de la pêche pour adopter une technique de capture de poissons plus en phase avec la nature serait impossible car cela entraînerait une réduction des prises actuelles de 80 à 90% au niveau mondial.
Toutefois, souligne Thomas Rymkin, en prenant en compte ses avantages à long terme, une telle approche pourrait être envisagée graduellement.
Dans une analyse de l’étude, publiée également dans Science, Boris Worn, biologiste de l’université Dalhousie à Halifax, abonde dans ce sens. Il relève que les sociétés humaines «sont dotées de la capacité unique d’analyser l’impact de leurs actions et d’ajuster leur comportement pour en minimiser les conséquences néfastes».
.
http://www.sciencemag.org/content/349/6250/858.full
The unique ecology of human predators
An anomalous and unbalanced predator
In the past century, humans have become the dominant predator across many systems. The species that we target are thus far in considerable decline; however, predators in the wild generally achieve a balance with their prey populations such that both persist. Darimont et al. found several specific differences between how humans and other predatory species target prey populations (see the Perspective by Worm). In marine environments, for example, we regularly prey on other predator species. These differences may contribute to our much larger ecological impact when compared with other predators.
Science, this issue p. 858; see also p. 784
Paradigms of sustainable exploitation focus on population dynamics of prey and yields to humanity but ignore the behavior of humans as predators. We compared patterns of predation by contemporary hunters and fishers with those of other predators that compete over shared prey (terrestrial mammals and marine fishes). Our global survey (2125 estimates of annual finite exploitation rate) revealed that humans kill adult prey, the reproductive capital of populations, at much higher median rates than other predators (up to 14 times higher), with particularly intense exploitation of terrestrial carnivores and fishes. Given this competitive dominance, impacts on predators, and other unique predatory behavior, we suggest that humans function as an unsustainable “super predator,” which—unless additionally constrained by managers—will continue to alter ecological and evolutionary processes globally.
Humans have diverged from other predators in behavior and influence. Geographic expansion, exploitation of naïve prey, killing technology, symbioses with dogs, and rapid population growth, among other factors, have long imposed profound impacts—including widespread extinction and restructuring of food webs and ecosystems—in terrestrial and marine systems (1–3). Despite contributions from the “sustainable exploitation” paradigm (4), contemporary humans can rapidly drive prey declines (5–7), degrade ecosystems (8, 9), and impose evolutionary change in prey (10, 11). Owing to long-term coevolutionary relationships that generally limit exploitation rates, especially on adult prey, these are extreme outcomes that nonhuman predators seldom impose. Meanwhile, whether present and future exploitation can be considered sustainable is hotly contested, especially in fisheries. Debate has been largely restricted to elements of the sustainable exploitation model, namely, a model of prey abundance and yields to humanity (e.g., 12, 13).
Here, we approach the notion of sustainable exploitation differently by asking whether humans—extreme in their impacts—are extreme in their predatory behavior (14, 15). Previous work has variously estimated exploitation by humans, nonhuman predators, or both, but systematic comparisons have focused on specific taxa or regions, have lumped all predators together, have been reconstructed indirectly, and/or did not include age classes (e.g., 14, 16, 17). We address these limitations with data spanning wildlife, tropical wild meat, and fisheries systems (data files S1 and S2). We examine variation in annual finite exploitation rates of marine fishes from every ocean (n = 1494 estimates, 282 species from 110 communities) and terrestrial mammals from every continent except Antarctica (631 estimates, 117 species from 179 communities) (fig. S1 and tables S1 and S2) by predator type (humans versus nonhuman), ecosystem (marine versus terrestrial), region, and trophic level. We focus on adult prey because hunters and fishers overwhelmingly target adults (18). We complement this quantitative assessment by identifying additionally unique predatory behaviors by humans that (i) facilitate the large differences in exploitation rates we detect and (ii) elicit the manifold consequences of humanity’s predatory hegemony.
Differences in exploitation rates between hunters and terrestrial predators varied among comparisons. Globally and pooled across trophic levels, exploitation rates by hunters (median = 0.06) did not differ from those of carnivores [median = 0.05; Wilcoxon test W = 46076, Padj(2) = 0.11] (Fig. 1A and figs. S2A and S3A). A paired comparison over shared prey within the same community, however, revealed that hunters exploit at higher rates than the highest-exploiting terrestrial predator [paired Wilcoxon test V = 929, Padj(2) = 0.03] (fig. S3B). Additionally, a similar paired comparison showed that the median proportion of mortality (an independent metric) caused by hunters (0.35) was 1.9 times that (0.19) caused by all other predators combined (paired Wilcoxon test V = 1605, P = 0.004) (Fig. 1B).

Fig. 1 Patterns of exploitation by human and nonhuman predators on adult prey.
(A) Complementary cumulative distribution functions showing the probability of predators exploiting prey at a rate (R) greater than or equal to a given annual finite exploitation rate (r), on the basis of the number of available individuals in populations (terrestrial mammals) or biomass (marine fishes). (B) Proportion of annual mortality caused by hunters and all other (i.e., aggregated) terrestrial predators consuming the same prey population. (C and D) Exploitation rates of human and nonhuman predators across trophic levels in (C) terrestrial and (D) marine systems. Whiskers represent distance from upper and lower quartiles to largest and smallest nonoutliers. [Art by T. Saxby, K. Kraeer, L. Van Essen-Fishman/ian.umces.edu/imagelibrary/ and K. Eberlins/123rf.com]
Trophic level and regional analyses (across taxa and areas with abundant data) revealed additional patterns. Although globally pooled comparisons showed that hunters and terrestrial predators exploited herbivores (artiodactyls) at similar rates [W = 14751, Padj(9) = 1.00] (Fig. 1C), hunters in North America and Europe exploited herbivores at median rates 7.2 and 12.5 times those of hunters in Africa [both Padj(9) < 0.04]; rates did not differ statistically between hunters and terrestrial predators within any of the regions (fig. S4A). Globally, hunters exploited mesocarnivores [W = 248, Padj(9) = 0.03] and large carnivores [W = 181, Padj(9) < 0.001] at higher rates than nonhuman predators by factors of 4.3 and 9.2, respectively (Fig. 1C). Remarkably, hunters exploited large carnivores at 3.7 times the rate that they killed herbivores [W = 2697, Padj(9) < 0.001] (Fig. 1C).
Fisheries exploited adult prey at higher rates than any other of the planet’s predators (Fig. 1A and fig. S2B). Among nonhuman predators across all oceans, 50% of exploitation rates were less than 1% of annual adult biomass. In contrast, fisheries exploited more than 10% of adult biomass in 62% of cases. Overall, the median fishing rate (0.14) was 14.1 times the take (0.01) by marine predators [W = 83614, Padj(2) < 0.001] (fig. S3A). In paired comparisons, median fisheries exploitation (0.17) was 3.1 times the median rate (0.06) by the highest exploiting marine predator of the same prey [V = 382, Padj(2) = 0.02] (fig. S3B). At all trophic levels, humans killed fishes at higher rates than marine predators [all Padj(9) < 0.04] (Fig. 1D), but there were no differences in take by each predator across trophic levels [all Padj(9) ≥ 0.5]. Pooling all trophic levels, the median rate of Atlantic fisheries exploitation (0.20) was 2.9 times that of Pacific fisheries [median = 0.07, W = 6633, Padj(4) < 0.001] (fig. S4B).
Although our varied data set could impose biases in both directions (supplementary text), we reveal striking differences in exploitation rates between nonhuman predators and contemporary humans, particularly fishers and carnivore hunters. Interactions between human and natural systems likely underlie patterns. For example, global seafood markets, industrial processing, relatively high fecundity among fishes, and schooling behavior could, in part, explain the particularly high fisheries take, whereas gape limitation by piscivores and a generally species-rich marine environment might explain why marine predator rates are comparatively low. Higher human densities and reduced fish biomass (from longer exploitation) likely explain higher fishing rates in the Atlantic versus Pacific oceans. Moreover, motivations to kill typically inedible carnivores for trophy and competitive reasons [intraguild predation; (7)] are evidently powerful and drive acutely high rates. Although, in terms of numbers, it is easy to exploit high proportions of (less abundant) carnivore populations, the implications remain profound (below). In addition, whereas declines in tropical wild meat (5) might predict an opposite pattern, lower hunting rates of African herbivores could relate to simpler technology, less reporting, and/or longer adaptation to human predation.
Whereas sociopolitical factors can explain why humans repeatedly overexploit (19), cultural and technological dimensions can explain how. Human predatory behavior evolved much faster than competing predators and the defensive adaptations of prey (20). Indeed, division of labor, global trade systems, and dedicated recreational pursuit have equipped highly specialized individuals with advanced killing technology and fossil fuel subsidy that essentially obviate energetically expensive and formerly dangerous search, pursuit, and capture. Moreover, agri- and aquaculture, as well as an ever-increasing taxonomic and geographic niche, leave an enormous and rapidly growing human population demographically decoupled from dwindling prey. In fact, low prey abundance can drive aggressive exploitation, because of the increased economic value of rare resources (21).
Emerging evidence suggests that the consequences of dominating adult prey are considerable. For example, human preference for large ornaments and/or large body size has fundamentally altered the selective landscape for many vertebrates. Not only can this rapidly alter morphological and life-history phenotypes (11), the resulting changes can modify the reproductive potential of populations (22) and ecological interactions within food webs [e.g., (23)]. In addition, owing to different behavior (e.g., age-class preferences and seasonality of exploitation), hunters likely cannot substitute for carnivores as providers of ecological services [e.g., regulation of disease and wildfire (7, 9), as well as mesopredator control (8, 24)]. Finally, less explored is the potentially substantial impact of prey biomass removal from ecosystems; global trade and sanitation systems shunt energy and nutrients from food webs of provenance to distant landfills and sewers.
These implications, the high exploitation rates that drive them, and the broadest taxonomic niche of any consumer uniquely define humans as a global “super predator.” Clearly, nonhuman predators influence prey availability to humans [e.g., (25)]. But overwhelmingly these consumers target juveniles (18), the reproductive “interest” of populations. In contrast, humans—released from limits other predators encounter—exploit the “capital” (adults) at exceptionally high rates. The implications that can result are now increasingly costly to humanity (26) and add new urgency to reconsidering the concept of sustainable exploitation.
Transformation requires imposing limits of humanity’s own design: cultural, economic, and institutional changes as pronounced and widespread as those that provided the advantages humans developed over prey and competitors. This includes, for example, cultivating tolerance for carnivores (7), designing catch-share programs (27), and supporting community leadership in fisheries (28). Also key could be a new definition of sustainable exploitation that focuses not on yields to humanity but rather emulates the behavior of other predators (14). Cultural, economic, and technological factors would make targeting juvenile prey challenging in many cases. Aligning exploitation rates on adults with those of competing predators, however, would provide management options between status quo exploitation and moratoria. Recent approaches to resolve controversies among fisheries scientists reveal how distant such predator-inspired management prescriptions are now. For example, although the mean “conservative” fishing rate estimated to rebuild multispecies fisheries across 10 ecosystems (0.04) is one-fourth their maximum sustainable yield rates (0.16) (13), it remains 4 times the median value we estimated among marine predators globally (0.01). Consequently, more aggressive reductions in exploitation are required to mimic nonhuman predators, which represent long-term models of sustainability (14).
Supplementary Materials
- Received for publication 24 April 2015.
- Accepted for publication 13 July 2015.
References and Notes
- ↵
- A. D. Barnosky,
- P. L. Koch,
- R. S. Feranec,
- S. L. Wing,
- A. B. Shabel
, Assessing the causes of late Pleistocene extinctions on the continents. Science 306, 70–75 (2004).
Abstract/FREE Full Text -
- W. J. Ripple,
- B. Van Valkenburgh
, Linking top-down forces to the Pleistocene megafaunal extinctions. Bioscience 60, 516–526 (2010).
Abstract/FREE Full Text - ↵
- J. B. Jackson,
- M. X. Kirby,
- W. H. Berger,
- K. A. Bjorndal,
- L. W. Botsford,
- B. J. Bourque,
- R. H. Bradbury,
- R. Cooke,
- J. Erlandson,
- J. A. Estes,
- T. P. Hughes,
- S. Kidwell,
- C. B. Lange,
- H. S. Lenihan,
- J. M. Pandolfi,
- C. H. Peterson,
- R. S. Steneck,
- M. J. Tegner,
- R. R. Warner
, Historical overfishing and the recent collapse of coastal ecosystems. Science 293, 629–637 (2001).
Abstract/FREE Full Text - ↵
- R. Hilborn,
- C. J. Walters,
- D. Ludwig
, Sustainable exploitation of renewable resources. Annu. Rev. Ecol. Syst. 26, 45–67 (1995).
CrossRefWeb of ScienceGoogle Scholar - ↵
- E. J. Milner-Gulland,
- E. L. Bennett
, Wild meat: The bigger picture. Trends Ecol. Evol. 18, 351–357(2003).
CrossRefGoogle Scholar -
- B. Worm,
- E. B. Barbier,
- N. Beaumont,
- J. E. Duffy,
- C. Folke,
- B. S. Halpern,
- J. B. Jackson,
- H. K. Lotze,
- F. Micheli,
- S. R. Palumbi,
- E. Sala,
- K. A. Selkoe,
- J. J. Stachowicz,
- R. Watson
, Impacts of biodiversity loss on ocean ecosystem services. Science 314, 787–790 (2006).
Abstract/FREE Full Text - ↵
- W. J. Ripple,
- J. A. Estes,
- R. L. Beschta,
- C. C. Wilmers,
- E. G. Ritchie,
- M. Hebblewhite,
- J. Berger,
- B. Elmhagen,
- M. Letnic,
- M. P. Nelson,
- O. J. Schmitz,
- D. W. Smith,
- A. D. Wallach,
- A. J. Wirsing
, Status and ecological effects of the world’s largest carnivores. Science 343, 1241484 (2014).
Abstract/FREE Full Text - ↵
- J. K. Baum,
- B. Worm
, Cascading top-down effects of changing oceanic predator abundances. J. Anim. Ecol. 78, 699–714 (2009).
CrossRefMedlineWeb of ScienceGoogle Scholar - ↵
- J. A. Estes,
- J. Terborgh,
- J. S. Brashares,
- M. E. Power,
- J. Berger,
- W. J. Bond,
- S. R. Carpenter,
- T. E. Essington,
- R. D. Holt,
- J. B. Jackson,
- R. J. Marquis,
- L. Oksanen,
- T. Oksanen,
- R. T. Paine,
- E. K. Pikitch,
- W. J. Ripple,
- S. A. Sandin,
- M. Scheffer,
- T. W. Schoener,
- J. B. Shurin,
- A. R. Sinclair,
- M. E. Soulé,
- R. Virtanen,
- D. A. Wardle
, Trophic downgrading of planet Earth. Science 333, 301–306(2011).
Abstract/FREE Full Text - ↵
- S. R. Palumbi
, Humans as the world’s greatest evolutionary force. Science 293, 1786–1790 (2001).
Abstract/FREE Full Text - ↵
- C. T. Darimont,
- S. M. Carlson,
- M. T. Kinnison,
- P. C. Paquet,
- T. E. Reimchen,
- C. C. Wilmers
, Human predators outpace other agents of trait change in the wild. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 106, 952–954(2009).
Abstract/FREE Full Text - ↵
- T. A. Branch
, Not all fisheries will be collapsed in 2048. Mar. Policy 32, 38–39 (2008).
CrossRefGoogle Scholar - ↵
- B. Worm,
- R. Hilborn,
- J. K. Baum,
- T. A. Branch,
- J. S. Collie,
- C. Costello,
- M. J. Fogarty,
- E. A. Fulton,
- J. A. Hutchings,
- S. Jennings,
- O. P. Jensen,
- H. K. Lotze,
- P. M. Mace,
- T. R. McClanahan,
- C. Minto,
- S. R. Palumbi,
- A. M. Parma,
- D. Ricard,
- A. A. Rosenberg,
- R. Watson,
- D. Zeller
, Rebuilding global fisheries. Science 325, 578–585 (2009).
Abstract/FREE Full Text - ↵
- C. W. Fowler,
- L. Hobbs
, Is humanity sustainable? Proc. Biol. Sci. 270, 2579–2583 (2003).
Abstract/FREE Full Text - ↵Materials and methods are available as supplementary materials on Science Online.
- ↵
- D. Pauly,
- V. Christensen
, Primary production required to sustain global fisheries. Nature 374, 255–257(1995).
CrossRefWeb of ScienceGoogle Scholar - ↵
- C. Collins,
- R. Kays
, Causes of mortality in North American populations of large and medium-sized mammals. Anim. Conserv. 14, 474–483 (2011).
CrossRefWeb of ScienceGoogle Scholar - ↵
- N. C. Stenseth,
- E. S. Dunlop
, Evolution: Unnatural selection. Nature 457, 803–804 (2009).
CrossRefMedlineWeb of ScienceGoogle Scholar - ↵
- D. Ludwig,
- R. Hilborn,
- C. Walters
, Uncertainty, resource exploitation, and conservation: Lessons from history. Science 260, 17–36 (1993).
FREE Full Text - ↵
- G. J. Vermeij
, The limits of adaptation: Humans and the predator-prey arms race. Evolution 66, 2007–2014 (2012).
CrossRefMedlineWeb of ScienceGoogle Scholar - ↵
- F. Courchamp,
- E. Angulo,
- P. Rivalan,
- R. J. Hall,
- L. Signoret,
- L. Bull,
- Y. Meinard
, Rarity value and species extinction: The anthropogenic Allee effect. PLOS Biol. 4, e415 (2006).
CrossRefMedlineGoogle Scholar - ↵
- C. N. K. Anderson,
- C. H. Hsieh,
- S. A. Sandin,
- R. Hewitt,
- A. Hollowed,
- J. Beddington,
- R. M. May,
- G. Sugihara
, Why fishing magnifies fluctuations in fish abundance. Nature 452, 835–839 (2008).
CrossRefMedlineWeb of ScienceGoogle Scholar - ↵
- N. L. Shackell,
- K. T. Frank,
- J. A. Fisher,
- B. Petrie,
- W. C. Leggett
, Decline in top predator body size and changing climate alter trophic structure in an oceanic ecosystem. Proc. Biol. Sci. 277, 1353–1360 (2010).
Abstract/FREE Full Text - ↵
- L. R. Prugh,
- C. J. Stoner,
- C. W. Epps,
- W. T. Bean,
- W. J. Ripple,
- A. S. Laliberte,
- J. S. Brashares
, The rise of the mesopredator. Bioscience 59, 779–791 (2009).
Abstract/FREE Full Text - ↵
- P. Yodzis
, Must top predators be culled for the sake of fisheries? Trends Ecol. Evol. 16, 78–84 (2001).
CrossRefMedlineWeb of ScienceGoogle Scholar - ↵
- J. S. Brashares,
- B. Abrahms,
- K. J. Fiorella,
- C. D. Golden,
- C. E. Hojnowski,
- R. A. Marsh,
- D. J. McCauley,
- T. A. Nuñez,
- K. Seto,
- L. Withey
, Wildlife decline and social conflict. Science 345, 376–378 (2014).
Abstract/FREE Full Text - ↵
- C. Costello,
- S. D. Gaines,
- J. Lynham
, Can catch shares prevent fisheries collapse? Science 321, 1678–1681 (2008).
Abstract/FREE Full Text - ↵
- N. L. Gutiérrez,
- R. Hilborn,
- O. Defeo
, Leadership, social capital and incentives promote successful fisheries. Nature 470, 386–389 (2011).
CrossRefMedlineWeb of ScienceGoogle Scholar - ↵
- V. Christensen,
- D. Pauly
, ECOPATH II — a software for balancing steady-state ecosystem models and calculating network characteristics. Ecol. Modell. 61, 169–185 (1992).
CrossRefWeb of ScienceGoogle Scholar - ↵
- D. Cressey
, Fisheries: Eyes on the ocean. Nature 519, 280–282 (2015).
CrossRefMedlineGoogle Scholar - Acknowledgments: We thank M. Arseneau, L. Grant, H. Kobluk, J. Nelson, and S. Leaver for data collection; L. Reshitnyk for creating fig. S1; and P. Ehlers and J. Ehlers for statistical assistance. S. Anderson, J. Baum, T. Branch, J. Brashares, A. Calestagne, S. Carlson, T. Davies, D. Kramer, T. Levi, J. Reynolds, and the “Ecology@UVic” discussion group offered insight on drafts. We thank the Raincoast Conservation, Tula, Wilburforce, and Willowgrove Foundations. C.T.D. and T.E.R. acknowledge Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada Discovery Grant 435683 and National Research Council Canada Operating Grant 2354, respectively. Data and R code available in Dryad (doi:10.5061/dryad.238b2). T.E.R. conceived of the idea and created the preliminary data set. C.T.D., H.M.B., C.H.F., and T.E.R. designed the research. C.T.D. led data collection and project management. H.M.B., C.T.D., and C.H.F. conducted analyses. C.T.D., C.H.F., H.M.B., and T.E.R. wrote the manuscript.


































